|
| | L'aneuvien, le psolat et l'uropi |  |
|
+13Kavelen SATIGNAC Bedal Troubadour mécréant PatrikGC Olivier Simon Velonzio Noeudefée Aquila Ex Machina Doj-pater Seweli Vilko Mardikhouran Anoev 17 participants | |
| Auteur | Message |
|---|
Velonzio Noeudefée
Référent Actualités
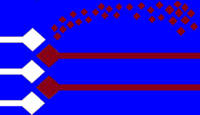
Messages : 8436
Date d'inscription : 14/02/2015
Localisation : Rhône-Alpes
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 24 Jan 2023 - 13:51 Mar 24 Jan 2023 - 13:51 | |
| - Anoev a écrit:
- Velonzio Noeudefée a écrit:
- Pour moi traire, s'il avait un passé simple, il serait comme au 2ème groupe, chose que j'étendrais à naitre et connaitre.
trais (s - t)
traîmes
traîtes
trairent
En fait le même pour les verbes dont l'infinitif est en -aire ou -aitre, régularisre sur le 2ème groupe en ir (à quand en ire, lol). Le problème (mais en est-ce bien un ? Dans la langue de Molière, on en a vu bien d'autres) c'est l'homophonie avec le passé simple de "trahir" (verbe du deuxième groupe... justement). Ben, non, à moins que je ne m'abuse, mais trahir donne pour moi (sans vérification) je, tu, il trahis (-s -t) nous trahîmes vous trahîtes ils trahirent Du coup, ça ne se prononce pas de la même manière.
_________________
En collaboration : yazik ; en pause : dudyi, ∂atyit
En pause : ditaiska köojame, llîua, diònith, frenkvëss, thialim, (monurpilf), yadios, Epçune !, endietc
Aboutie : suok et lignée pré-mihia-thialim, thianshi, diarrza, uosmigjar (essai : ortogrévsinte, sinywila, SESI, KISSI)
langues parlées: allemand - italien - elko - baragouin de globish
Niluusu kivanu ki-so∂em-korondo-s-uvi gu koyoodnißju. (dudyi) / Midevim iſeet dotſe iJebiriotoẏot éß umowonêyû. (∂atyit)
Je rêve que les humains deviennent les jardiniers de la vie dans le système solaire.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
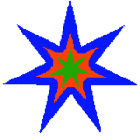
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 24 Jan 2023 - 14:06 Mar 24 Jan 2023 - 14:06 | |
| J'aî dû cônfôndre le cîrconflêxe avec le trëma.
Mais dans ce cas, comment tu prononces "traîmes, traîtes" ? dans quasiment tous les passés simples, y compris des verbes irréguliers, on a toujours la voyelle prononcée /a/, /i/, /y/ et /ɛ/ (premier groupe à la troisième du pluriel : È)°.
°Seules exceptions, sauf erreur de ma part, celles des verbes comme "venir, tenir" et leurs dérivés : ils tinrent /iltɛ̃ʁ/, mais y a jamais de I ni de Î noyé dans le digramme AÎ ou AI dans le cas de passé simple. _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Velonzio Noeudefée
Référent Actualités
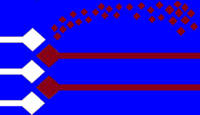
Messages : 8436
Date d'inscription : 14/02/2015
Localisation : Rhône-Alpes
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 24 Jan 2023 - 19:31 Mar 24 Jan 2023 - 19:31 | |
| Comment prononces-tu traire, naitre ou même traine, mais, etc. ?
Du coup, tu as la prononciation comme è = ai = ei, soit /ɛ/.
_________________
En collaboration : yazik ; en pause : dudyi, ∂atyit
En pause : ditaiska köojame, llîua, diònith, frenkvëss, thialim, (monurpilf), yadios, Epçune !, endietc
Aboutie : suok et lignée pré-mihia-thialim, thianshi, diarrza, uosmigjar (essai : ortogrévsinte, sinywila, SESI, KISSI)
langues parlées: allemand - italien - elko - baragouin de globish
Niluusu kivanu ki-so∂em-korondo-s-uvi gu koyoodnißju. (dudyi) / Midevim iſeet dotſe iJebiriotoẏot éß umowonêyû. (∂atyit)
Je rêve que les humains deviennent les jardiniers de la vie dans le système solaire.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
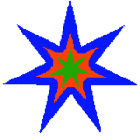
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 24 Jan 2023 - 20:54 Mar 24 Jan 2023 - 20:54 | |
| - Velonzio Noeudefée a écrit:
- Comment prononces-tu traire, naitre ou même traine, mais, etc. ?
Du coup, tu as la prononciation comme è = ai = ei, soit /ɛ/. Grosso modo : /tχɛʁ/ ne pas oublier qu'à côté d'une consonne non voisée (comme ici un T), le R a tendance à être dévoisé en [χ]. /nɛtχ/ itou /mɛm/ /tχɛn/ itou /mɛ/ /ɛt͡seteʁa/. J'te fais grâce des voyelles longues ([ɛ:]) ayant moins de "poids" en français que dans d'autres langues, comme l'anglais, le hongrois, l'aneuvien etc. Pour le AI, le français est une langue assez capricieuse : y a des locuteurs qui le maintiennent fermé /e/, d'autres comme Francis Cabrel, qui l'ouvrent ([ɛ]). AIS est toujours ouvert, comme AIT. Mais si on en croit le Wiktio, y faudrait dire /ʒ evy œ̃ʒ ɛ/ pour "j'ai vu un geai". _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
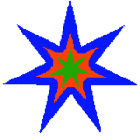
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 24 Jan 2023 - 22:46 Mar 24 Jan 2023 - 22:46 | |
| - Dopa a écrit:
- ... d'où l'Uropi viro = tourner, changer de direction, virbo = tourbillonner, virgo = tordre, virk = un écrou, virto = tourner (rotation).
Bon, ben, voici c'que j'ai zhiyr (-a, -ía) = viroròten (-na, -éna) = virtoroċen (-a, -éna) = tornovyyr (-a, -ía) pour "tourner à l'aigre, au désastre, à   " Sinon, pour "tourbillonner" ( virbo), eh ben... j'ai (encore) rien.  Pour "tordre" ( virgo, on ne confondra pas), j'en ai deux chrjĕs (-isa, -isa°), pour "tordre en pliant" chride (-a, -éa) pour "tordre en vrille". Pour l'écrou ( virk), j'ai l'à-priori borsh ; son équivalent mâle (la vis*), c'est l'à-postériori srov (déformation de screw), si bien qu'je m'demande si borsh est bien si à-priori que ça. En tout cas, il n'a strictement rien à voir avec la soupe russe. ° Lequel donne, par conséquent christ à l'impératif ; on ne confondra donc pas. D'ailleurs, Jésus Christ, en aneuvien, se dit Zhes Hrist, sans C. D'autre part, CH se prononce toujours [ʃ] dans cette même langue, même devant une consonne.* Chose marrante quand même ! puisque l'écrou (anciennement "écroue") est la pièce femelle, et screw qui est la pièce mâle... Bref... vient aussi de... "écroue"._________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
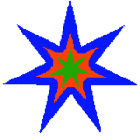
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mer 25 Jan 2023 - 13:19 Mer 25 Jan 2023 - 13:19 | |
| - Doj-pater a écrit:
- Mais ils avaient bien d'autres racines correspondant à l'amour et/ou au désir: PIE *leubh- > lioubov', Liebe, love = amour, + lat libido = désir, et surtout pour les Indiens: PIE *prihₓ-ehₐ- = amour qui donne en sanskrit: priyátā = amour, prīyatē = il aime, priyá- = cher, práyah = plaisir, et en Uropi prijo = plaire, prijad = plaisir, prijan = agréable, prijan = content, prijim = s'il vous plaît…
racine que l'on retrouve en slave: prijatel' = ami, prijatan = agréable… et en germanique: friend/Freund = ami, frei/free = libre, Friede = paix… etc. sans parler de *h₄em- = mère > lat amma, d'où amo = aimer (au départ amour maternel). Voilà c'que ça donne chez moi : Pour "amour", j'en ai d'jà plus ou moins causé, c'est klim c'est un sentiment profond à l'égard de qui que ce soit (animal, dont humain) ou quoi que ce soit (les trains, la patrie, Dieu, etc), le verbe est identique (mais pas avec les mêmes flexions, 'videmment). On trouve un calque approximatif de theo love. D'où iklímon* pour "amoureux", klimas pour "amoureusement". Sinon, on a parènton klim, madhon klim, padhon klim, t'aura d'viné de quoi il est question. Pour "plaire, plaisir", j'ai pompé sur le latin, avec assibilation affriquée du C, et, j'ai, du coup : PLACEO PLACERE, plàċ (-a, -ía, pour "plaire à"), kjas plàċit ors (s'il vous plaît), plàċyn (plaisir). On a aussi plàċid pour "faire plaisir", le E étant euphonique, le D venant de dor (faire). Ea ka diktă ni das «or plàċidit es: dem pùzet ùs» = Et elle lui dit : « faites-moi plaisir : fichez l'camp». Pour en finir, pour la libido, le plaisir sexuel, y a qud#, çui-là, j'l'ai d'jà évoqué ; il ne manque pas de dérivés, notamment qutáṅon pour "chaste", qudantesem pour "érotisme", qudig & qurvun pour "galant"°, qudar pour "désirable", qudis pour "lascif", qudon pour "libidineux"... * Da ere iklímon ed dvokœskaż = il était amoureux de sa cousine issue de germaine. Ù klimon hagràm = une passion amoureuse.# Pris de Qupidoṅ. J'avais aṅtoqúdon pour "pudibond" dans Idéolexique, mais j'ai oublié de mettre le Slovkneg à jour pour ce mot (entre pas mal d'autres), parce qu'il n'était que dans le paragraphe des dérivés de qud, et qu'il n'avait pas sa page à lui.° Y a aussi karvidar, mais la teneur est complètement différente : karvet • tœn: kasmesem mata as = La galanterie est morte : le féminisme l'a tuée._________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
Dernière édition par Anoev le Jeu 16 Fév 2023 - 20:30, édité 3 fois | |
|   | | Velonzio Noeudefée
Référent Actualités
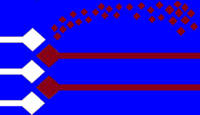
Messages : 8436
Date d'inscription : 14/02/2015
Localisation : Rhône-Alpes
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mer 25 Jan 2023 - 14:05 Mer 25 Jan 2023 - 14:05 | |
| - Anoev a écrit:
Pour le AI, le français est une langue assez capricieuse : y a des locuteurs qui le maintiennent fermé /e/, d'autres comme Francis Cabrel, qui l'ouvrent ([ɛ]). AIS est toujours ouvert, comme AIT. Mais si on en croit le Wiktio, y faudrait dire /ʒevy œ̃ʒɛ/ pour "j'ai vu un geai". Pour moi ai, quoi qu'il y ait par la suite (sauf n ou m, bien sûr), c'est toujours /ɛ/ (de même pour ei).
_________________
En collaboration : yazik ; en pause : dudyi, ∂atyit
En pause : ditaiska köojame, llîua, diònith, frenkvëss, thialim, (monurpilf), yadios, Epçune !, endietc
Aboutie : suok et lignée pré-mihia-thialim, thianshi, diarrza, uosmigjar (essai : ortogrévsinte, sinywila, SESI, KISSI)
langues parlées: allemand - italien - elko - baragouin de globish
Niluusu kivanu ki-so∂em-korondo-s-uvi gu koyoodnißju. (dudyi) / Midevim iſeet dotſe iJebiriotoẏot éß umowonêyû. (∂atyit)
Je rêve que les humains deviennent les jardiniers de la vie dans le système solaire.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
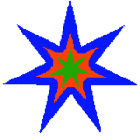
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mer 25 Jan 2023 - 14:47 Mer 25 Jan 2023 - 14:47 | |
| - Velonzio Noeudefée a écrit:
- de même pour ei.
Pour -ei-, j'comprends mieux... ce qu'y a d'étonnant en français, c'est qu'y ait une mi-fermée ([e]) faite à partir d'un A (lettre ouverte, en bas du trapèze). Je suppose (à tort ? à raison ?) qu'on ait du pomper ça au grec αι ; va t'en savoir ! Tu pens'ben que j'ai pas voulu m'encombrer d'une telle enclume ! Pas de AI chez moi ; le AU et le EI (rare, çui-ci) me suffisent largement comme... diphtongues. Comme j'avais le nez plongé dans le Vordar, j'suis tombé par hasard sur mandolin, là, j'ai eu une légère hésitation. À coup sûr, ce mot doit désigner l'élément de lutherie napolitaine ; du reste, la traduction aneuvienne est assez proche de l'uropie : mantolyn*. Mais est-il également la traduction d'un dispositif permettant de couper les légumes en lamelles ? comme le préconise ce paragraphe ? Les gens du nord (norvégiens & bataves) et les Galiciens se sont pas foulés. Pour les Allemands, c'est assez compliqué, pour les anglophones, c'est un nom composé ; en aneuvien, c'est une agglutination : blackùċat, pris de blàdin = lamelle ckùt = couper sat = outil. Là, qu'on me dise pas que je "fais français". J'ai pris de l'italien pour l'instrument de musique (pour la version précédente, je r'connais, mais main'nant, elle est caduque), et pour l'instrument de cuisine, j'ai deux éléments pris de l'anglais ( blade + cut) et un à-priori. Le tout relié par deux imbrications, dont la dernière (Ċ) est une charnière. * Jusqu'à récemment, c'était maṅtolyn, mais le A nasalisé faisait trop relex, exit donc le Ṅ. D'une pierre deux coup : une relex et un caractère spécial en moins !_________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
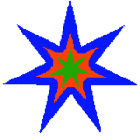
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Exogamie Sujet: Exogamie  Jeu 26 Jan 2023 - 1:09 Jeu 26 Jan 2023 - 1:09 | |
| Le grec (origine du mot) nous donne ἔξω pour "hors" et γάμος pour "mariage" : terme qui décrit le fait de choisir son conjoint hors de sa communauté. Manqdebol pour moi, j'ai bien usnùpat (avec un T, ouphes, on va voir pourquoi), mais ça veut dire "divorce". Bref, y va falloir que j'donne un sérieux coup d'balai ! Parce qu'évidemment, j'vais avoir aussi les autres à remplacer. Bon, pourquoi les remplacer plutôt que de trouver autre chose pour "exogamie" ? Tout simplement parce que ùs correspond mieux à "hors" que "dé(faire)", pour lequel je dispose d'un autre préfixe : dys-. En tout cas, Dopa, qui nous a évoqué l'exogamie dans Uropi 10, ne l'avait pas dans le Vordar. Mais vu que c'est lui qui en a parlé, c'est grâce à lui que j'vais prendre un peu d'avance, sauf si évidemment, il lit mon inter et réagit plus vite que moi. En attendant, pour "divorce", j'ai décidé de transformer usnùpat en dysnùpat, pareil pour les autres, 'videmment. Ce qui me libère ùs et j'ai donc usnùpet, avec un E devant le T, histoire de garder le calque de "-ie", -y, -ija, -ia et j'en passe. Pris dans la foulée, 'videmment, j'vais en déduire : inùpet pour "endogamie". C'est pour les autres (monogamie, polygamie) que je sèche un peu. J'vous dis pourquoi : un e polygame, c'est certes quelqu'un qui se marie plusieurs fois, mais c'est surtout quelqu'un qui a plusieurs conjoints simultanément, et là, - nùpet ne suffit plus. _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
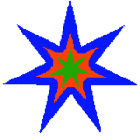
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Dieu est Dieu, nom de Dieu ! Sujet: Dieu est Dieu, nom de Dieu !  Jeu 26 Jan 2023 - 17:32 Jeu 26 Jan 2023 - 17:32 | |
| C'est par une phrase de Maurice Clavel* que je démarre cette inter.
En uropi, "dieu" (avec ou sans capitale, petite ou grande, c'est selon), c'est doj, quel qu'il soit, entité unique (et immatérielle) ou bien être divin, mais représenté par une personne (grec, latin, germanique) ou bien un être plus ou moins hybride (Égypte, Inde etc.), qu'il soit sexué, capable de se reproduire, aussi bien avec des déesses qu'avec des mortelles. Une déesse, c'est doja.
En aneuvien, c'est à la fois plus simple et plus compliqué : Div, est toujours neutre. S'écrit avec une capitale, grande (Div) ou petite (ᴅiv) s'il s'agit de monothéisme. Pour ce qui est des divinités locales aneuviennes (Ptahx, Thub), lesquelles étant elles aussi différenciées, mais asexuées, puisqu'éternelles, le nom div (neutre aussi) s'écrit en minuscule, et c'est le nom de la divinité (Skov, par exemple, pour l'eau, chez les Ptahx) qui prend une majuscule. Les autres cas sont un peu différents, puisqu'il s'agit de divinités sexuées, humaines ou non. Pour les divinités non humaines (horus, Anubis, Ganesh...), ils sont considérés comme divek (♀) ou dived (♂). Si ce sont des humains (ou à peu d'choses près), ils sont divkad ou divdak (respectivement). Là aussi, le nom commun est minuscule, et c'est les prénom des divinités qui portent la majuscule.
Donc
doj se traduit div, divdak ou dived
doja se traduit divkad ou divek.
Peuvent être utilisés, au sens figuré, pour des mortels :
Pelé id Maradonna, doje futbali = Pelé ea Maradonna, divdake fœntballen = Pelé & Maradonna, dieux du foot.
U doja de nukleari fiziki = ùt divkad nuklis qbisiken = une déesse de la physique nucléaire.
Àt div quas eg erlàj? Qupidoṅ, terádert.
*J'allais pas rater l'occasion de diffuser cet extrait qui restera dans les mémoires, du moins, j'espère. Sacré Momo ! _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
Dernière édition par Anoev le Ven 3 Mar 2023 - 12:57, édité 1 fois (Raison : Localisation) | |
|   | | Anoev
Modérateur
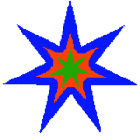
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Ven 27 Jan 2023 - 13:41 Ven 27 Jan 2023 - 13:41 | |
| - Doj-pater a écrit:
- Ah, le mythe de la côte d'Adam a la vie dure !
J'ai plongé dans l'Vordar, et j'ai trouvé deux noms pout "mythe" : mita et mitik. Comme tu n'as rien mis dans la colonne des commentaires, j'dois en déduire que ces deux noms sont rigoureusement synonymes. Chez moi, un seul nom : lhip#. Ce nom paraît à-priori, mais il ne l'est pas tant que ça. C'est div (dieu) qui a été retourné par l'intermédiaire du vadora*. Un mythe, c'est une légende, mais aussi un dieu auquel on ne croit plus. Il est renversé par la foi du plus grand nombre. Div a d'autres types de transformations : Vid (anacyclique) : le Diable, comme l'antithèse de Dieu° vib (ambigramme-reflet) : c'est aussi le diable, mais dans son acception purement néfaste. Chose assez marrante (mais logique, pour qui connait les mécaniques de la symétrie), lhip est l'ambigramme-bascule (par l'intermédiaire du vadora) de vib. Comme quoi, il peut être néfaste de croire mordicus à un mythe. # Y manquerait bien un corollaire : lhiq. Mais là, j'vois vraiment pas c'que j'pourrais bien lui fourguer comme définition.* D'autres infos, par là.° Une de mes convictions : puisqu'il a été possible de faire le mal au nom de Dieu (Inquisition, guerres de religion, Croisades, conquête des Amériques...), pourquoi ne serait-il pas possible de faire le bien au nom du Diable. Et là, évidemment, c'est de Vid qu'il s'agit, pas de vib.
Ùt gyloot vidin = un bon p'tit diable._________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
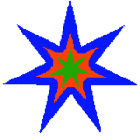
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Dim 29 Jan 2023 - 11:20 Dim 29 Jan 2023 - 11:20 | |
| - Doj-pater a écrit:
- Prijad - le plaisir
****
La racine indo-européenne *prihₓ-ehₐ- = amour, a donné de nombreux mots dans de nombreuses langues indo-européennes.
Tout d’abord dans les langues indiennes:
Amour = प्रेम ‘prem’, प्रीति ‘prīti’ en hindi et marathi, প্রেম ‘prīm’ en bengali, પ્રેમ ‘prēm’ en gujarati …
Cher = प्रिय ‘priya’ en Hi etd Mar, প্রিয় priya en Beng, પ્રિય ‘priya en Guj…
Amant = प्रेमी ‘premī’ en Hi, প্রেমিক ‘prēmik’ en Beng, પ્રેમી ‘prēmī’ en Guj, प्रियकर ‘priyakar’ en Mar…
+ plaisant, agréable = प्रीतिकर ‘prītikar’ en Hi, chéri = প্রণয়ী ‘praṇaẏī’ en Beng, પ્રિયતમ ‘priyatam’ en Guj…
* * * * Dans les langues slaves, elle a donné:
plaisant, agréable = приятный ‘prijatnyj’ en russe, prijatan en croati et serbe, prijeten en slovène, приятен ‘prijaten’ en bulgare, příjemný en tchèque, przyjemny, en polonais…
Ami = prijatelj en Cr, Sr et Slo, приятел ‘prijatel’ en Bul, przyjaciel en Pol, přítel en Tch, priatel’ en slovaque…
* * * * Et également dans les langues germaniques, par exemple en allemand: Freude = joie, Friede = paix, frei = libre, Freund = ami,(+ Nl vriend, ang friend, dans les langues scandinaves fri = libre, fred = paix) …
* * * * Cette racine a aussi donné toute une série de mots Uropi: prijo = plaire, prijan= plaisant, agréable, prijad = plaisir, prijen = content, prijim = s’il vous plaît… Là, j'dois avouer que c'est vach'ment intéressant, même si j'ai pris des racines assez différentes, mais pas si éloignées que ça quand même, si on réfléchit un soupçon. Pour "plaire", j'ai pris le latin PLACEO. Même si ça ne coïncide pas, il y a quelque chose (j'ai notamment pensé au volapük rigik où on remplaçait les R par des L). Par ailleurs, le latin prononce [k] pour les C (et le psolat les fait prononcer [g]), mais en aneuvien, c'est l'assibilation qui est de mise, en plus de ça, un point de consonne affriquée a été ajouté : plàċ. En plus, ce verbe est transitif direct, c'est à dire qu'il n'a pas besoin d'adposition ( ni) pour signifier "plaire à" : ar plàċe das° = ils lui plaisent #. D'où s'en déduisent : plàċyn = plaisir, plàċun = plaisant, eliplàċ = déplaire. Pour "plaisance", on a le condensé plànaxtyn, en plus condensé encore plànax. Naxàre (naviguer) a été pompé à l'algardien. Y a plus condensé encore : plàx- utilisé dans plàxaver pour "port de plaisance". Par contre, "plaisanter" utilise un autre radical (żhog-), pompée à l'anglais. Pour "aimer", j'en ai d'jà parlé ; j'vais pas y r'venir. Itou pour "cher". Pour "ami", j'ai pris sur le russe, qui m'a donné drœgdu (la langue qui manquait, en somme). Pour "frère", j'ai pris du latin FRATER -RIS, pour fràn (adjectif), à la différence essentielle de l'uropi, est utilisé pour LES DEUX GENRES : sesta = frànkad, frat = fràndak. Et du coup, y a fràndu pour "adelphe" : ka hab tiyn frànduse: ùt dax ea ùt każ. Ed fràndak kan hab tiyn frànkaże.Pour dire "Les Mercuriales sont deux tours sœurs", ça donne, en aneuvien : àr Mercuriales* • tiyn fràne toare. Du coup, "fraternel" donne frànon, frati en uropi. Je pense ne rien avoir oublié d'essentiel. ° Du coup, j'en ai déduit plàċid pour "faire plaisir" : le D vient de dor (faire). Le I (du subjonctif plaċía) est euphonique, histoire d'éviter une prononciation problématique de ĊD, et reste au parfait, au prétérit et au subjonctif.# Kjas plàċit ors = s'il tevous plaît ; on a même le condensé familier kjàċit pour "s'te plaît, sioûplaît".* Nom propre étranger, non aneuvisé._________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
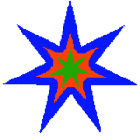
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 31 Jan 2023 - 12:51 Mar 31 Jan 2023 - 12:51 | |
| "Faire plaisir" évoqué ci d'ssus ( plàċid) donne deto prijad en uropi, une locution verbale, donc. Par contre, le verbe aneuvien s'utilise exactement comme plàċ, à savoir avec un complément à l'accusatif sans préposition. Le datif du pronom personnel est de mise en uropi, tout comme la préposition a devant un nom commun : He detì priad a hi baptidota, he kopì co u klad = Da plàċidă ed fadnèrkaż, da kovă ùt robs ni kas = Il fit plaisir à sa filleule, il lui offrit une robe. J'avais bien pensé à un autre cadeau, mais je n'ai pas trouvé sa traduction en uropi (ibirmalàxat en aneuvien). - Doj-pater a écrit:
- En effet quoi de commun entre un petit voilier de quelques mètres et un yacht d'oligarque (russe ou autre) ? Rien, sauf que ça va sur l'eau.
Pour le voilier, j'ai deux termes, selon la taille : vlimboot : petit voilier, en fait, façon de causer, parce que ceux du tour du monde ou du Vendée-globe font partie de cette catégorie : y a pas que les Vauriens et les Optimists. vlimxhíp : là, on a d'jà affaire à quelque chose de plus conséquent, c'est, certes les grands voiliers de jadis, mais aussi les cargos à voiles qui commencent à renaître, histoire de respecter un peu l'air et les océans. Tout ça, évidemment, vient de vlim, pour LA voile ( seil en uropi). Pour "LE voile" ( vel en uropi), je me suis fendu d'un paronyme : vlym. Pourquoi ? parce qu'au sens propre, c'est pas trop loin, en somme : c'est une pièce textile plus (le) ou moins (la) souple, J'pouvais pas faire comme en français, puisque chez moi, ces deux termes sont neutres (comme seil et vel, d'ailleurs, en uropi), je m'y suis pris autrement : le I de vlim est bien raide, comme une voile, le Y est plus souple, la prononciation est moins extrême, un peu comme le [ɪ] anglais. Par ailleurs, contrairement à vlim qui est seulement explicite (sens prore, sauf si éventuellement on dit tiyn vlime bybordev = deux voiles à bâbord), vlym peut évoquer le voile atmosphérique : atmosfig vlym, voire complètement figuré : ù vlym pasă sed obaajeve én = un voile passa devant (sur) ses yeux.
Pour le port de voile, j'aurais bien vlimaver. Pour "mixte", eh ben... j'ai pas. Grosse lacune, j'ai bien "mixer" (j'me suis pas ben foulé, c'est comme "mélanger" : mixe ; correspond donc à l'uropi mico), mais pas "mixte" ( micen en uropi), alors que j'ai "mixture" ( mixys). Bref : de quoi causer. Pour l'instant, je rame à domphes. Une voiture (ferroviaire) mixte, c'est pas nécessairement où les sièges de premières et secondes sont entremêlées, c'est une voiture contenant dans la même caisse une salle de première (ou des compartiments) et une ou des salles de seconde (itou), donc la notion de mélange n'apparaît pas. Dans un internat mixte, je ne suis pas vraiment certain que les dortoirs et... les douches soient aussi... mixtes. Donc une coexistence, certes, mais jusqu'à un certain point. Pour le port mixte, je m'perds en conjectures. En tout cas, pour une langue mixte, le mélange peut être vraiment profond, jusque dans les mots eux-mêmes, l'aneuvien ne manque pas d'exemples. _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
Dernière édition par Anoev le Jeu 2 Fév 2023 - 21:45, édité 6 fois (Raison : Corrigé après coup.) | |
|   | | Anoev
Modérateur
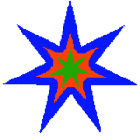
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Drogue et droguistes Sujet: Drogue et droguistes  Mar 7 Fév 2023 - 0:32 Mar 7 Fév 2023 - 0:32 | |
| En uropi, la drogue, quelle qu'elle soit, vendue en pharmacie ou sous le manteau, c'est drog, en aneuvien, y a deux termes : drog (comme en uropi, à la prononciation du R près) et nàrkotik. La distinction n'est pas là où on pourrait le penser. En fait, nàrkotik est précisément une drogue qui fait dormir (définitivement, à haute dose) ou qui apaise, comme le témesta, la morphine ou... l'héroïne. Toutes les autres drogues (dopantes, hallucinogène, anabolisantes, aphrodisiaques, légales ou non) sont intégrées dans drog, mais pas dans nàrkotik, mais les produits narcotiques sont inclus dans drog... comme quoi...
On a donc, en uropi, drog pour "drogue", et aussi
drogimania, droginemad (toxicomanie)
droginemor (toxicomane)
drogivendor ((re)vendeur de drogue)
drogo (droguer)
Et...
drogìst (droguiste)
drogistia (droguerie).
Là, j'en suis resté comme deux ronds d'flan... même si j'm'y attendais un peu, langues naturelles aidant, y faut bien dire !
En ce qui me concerne, pour "toxicomanie", j'ai toxœzhet, un à-postériori de synthèse, lequel venant de tox pour "toxine", et nœzhet, emprunté au russe нужда pour "besoin".
Pour "droguer", j'ai, pour l'instant nàrkor, mais là, ce serait plutôt "droguer un cheval avant une course, pour l'endormir". Donc, j'ai comme un trou.
Par ailleurs, j'ai aussi "droguiste" et "droguerie". Pour ce dernier, j'ai qemiskop : c'est bien évident que les produits qui y sont en vente n'ont pas pour attribution d'être ingérés, injectés ou reniflés (sauf peut-être les solvants, y en a qui aiment, mais bon, c'est pas sans risques). Qemiskop, c'est donc une boutique où on vent de la chimie, et pas vraiment de la drogue, même légale (pour cette dernière, tourner au coin d'la rue : la pharmacie (apotèk, qbarmàki) est à trois cent mètres). Quant au (ou à la) droguiste, eh ben, c'est qemiskopdu ou, éventuellement qemithógdu (de thóge, pour "vendre"). _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
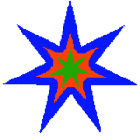
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 7 Fév 2023 - 19:09 Mar 7 Fév 2023 - 19:09 | |
| - Doj-pater a écrit:
* * * *
Zis un alten poèm po oro de zone: Vokale
- Spoiler:
Voici un autre poème pour entendre les sons: Voyelles
https://www.youtube.com/watch?v=CwwBDeWOfV4... Faudrait ben que j'trouve quelque chose sur les voyelles. J'ai changé, y a pas trop longtemps la traduction pour le magenta : mazhènta → Fuch. Manque de bol, pour les huit voyelles (eeh ouais ! y a aussi le Y : faut pas l'oublier, c'est l'arbre ! y compte ; et p'is y a aussi le Æ et le Œ), j'vais avoir du fil à r'tordre. U blu, mais aussi rub et fuch (les emm... commencent !) Æ hrænA zhàl (en forçant un peu), kràj et cjaṅ, aussi (rebelote !) O broonY svỳt (pie°! j'fais qu'un voyage : ça vaut pour le noir et le blanc, té !) Quant aux autres (Œ, I, E), je sèche. Sinon, un peu d'vocabulaire : poèm = tamávek
poèt = tamádu
poetic = tamáigpoetim = tamaas
poetid = tamávet
poetij = tamáret
vers = riylem
rime = tamápema.Bon, y en manque, autant chez moi que chez Dopa. J'ai pas haikù, puisque j'en ignorais l'existance jusqu'à son inter. Je n'ai pas non plus "sonnet, rondeau", et j'en passe. Tamá- est à-priori. Dans la diégèse aneuvienne, ça viendrait d'un adjectif ptahx qui signifierait "soigné, artistique, recherché"... bref. Le quelque intervenant (y en a ? pourquoi déranger l'pluriel !) qui passe ici m'aura compris. La suite (- vek) vient de sĕvek, pompé lui-même au hongrois szöveg, pour le même sens (texte). S'en découlent, pour "poésie", les noms suivants : tamávetul (ensemble de poèmes : tœl = ensemble) tamávet (caractère poétique d'un texte, qu'il soit en vers ou en prose) tamáret (caractère poétique ou artistique, cf art, imbriqué dans le mot). Attention au glissement : riylem, c'est un vers ( ù tràma riylmeve = une pièce en vers). La rime, dans une syllabe, c'est pema, c'est-à-dire la syllabe soulagée de son attaque. Tamápema, c'est la rime dans un poème. On ne confondra donc pas le nom pema avec le parfait du verbe peme (rimer), rimo en uropi. J'ai pas "pied" pour ce sens, non plus. Dopa, lui, s'est pas embêté, puisqu'il a opté pour versipod, ben tiens ! Le vers serait comme une espèce de... ver, un peu comme un mille-pattes, comportant, par exemple, douze pieds si c'est un alexandrin. Fallait oser ! Le syllogisme, main'nant : Olygon omen • spændon
ùt olydon trakkov • olygon
kæt ùt olydon trakkov • spændon.Rime, certes un peu moins riche qu'en uropi, mais ça tient la route quand même, grâce à la paronymie olydon/olygon. On peut ici avoir affaire à une paranomase. ° Il s'agit, bien sûr, de l'adjectif ! formé de svart (noir) et wỳt (blanc). Une vache pie noire se dit svỳt boovek, un taureau pie brun se dit brỳt booved. La pie (oiseau) se dit svỳtav, d'un seul tenant ! Pas confondre avec aroṅd ep ù svart ea wỳt av = l'hirondelle est un oiseau noir et blanc._________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
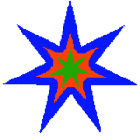
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mer 8 Fév 2023 - 13:32 Mer 8 Fév 2023 - 13:32 | |
| - Doj-pater a écrit:
- Une petite erreur
- Citation :
- tale we se rari se diari ;
C'est du parfait Uropi, mais ça veut dire autre chose:
tal = tout, wa = ce que > tal wa = tout ce que
tale = tous, we = qui > tale we = tous ceux qui, donc: tous ceux qui sont rares sont chers L'erreur que j'ai fait vient en fait de mon incompréhension (bon main'nant, jpense avoir assimilé) les pronoms relatifs uropi, en aneuvien, "ce qui" et "ce que" ne se traduisent pas. Æt qua, c'est spécifiquement " celui ou celle qui", pareil pour æt quas, pour celui ou celle que... etc. Le problème vient du français : "celui" et "celle" sont des pronoms démonstratifs. Ce (pronom, vient de "ça") peut être traduit par this, that ou par it, en anglais ; "celui" ou "celle" ne sont traduits que par this ou that (non respectiv'ment). "Ce qui" pourrait être traduit par a qua. J'ai complètement occulté le a : qua suffit, puisque c'est un pronom relatif. Dans ce rôle, "ce" est plus indéfini que démonstratif, en fait. "Celui" ou "celle que j'ai vu", on évoque clairement quelque chose ou quelqu'un de bien défini. Ça marche avec les autres pronoms relatifs :  Celle que j'ai vue au garage consomme plus que la mienne. Impossible de remplacer par "ce que", non ?  Ce dont m'a parlé le garagiste, je l'savais déjà. Là pareil : on ne peut pas remplacer par "celui" ou "celle". Ç'est évident. Pareil pour "ce qui se conçoit bien s'énonce clairement". Y a une différence entre J'ai vu ce que tu as vu j'ai vu celui que tu as vu. Ça donne, en uropi i vizì wa tu vizì
i vizì diz wen tu vizìEt ça donne en aneuvien eg vedja quas o vedja
eg vedja æċ quas o vedja.Point commun entre les deux langues : y a un pronom démonstratif en plus dans la deuxième phrase ; celui-ci est l'antécédent du pronom relatif. Différence : le pronom relatif n'est pas le même en uropi ( wa/wen) alors que c'est le même en aneuvien ( quas). Un autre truc : tout. En uropi, se traduit invariablement par tal au singulier et, par conséquent, tale au pluriel (peut être une reprise des langues romanes " tout", todo etc. avec les germaniques all, alle... Toutefois, l'adverbe donne, naturellement, talim ( tal, avec le suffixe - im). En aneuvien, c'est un poil plus compliqué (non ?) : y a al, qui n'a pas de pluriel, puisque c'est "tout" dans son entier (on compte UNE entité, et c'est celle-ci dont il est question) : àt al bynòψak cem klàstă per àt igoψhákev = tout l'immeuble fut détruit par l'incendie. Ça donnerait, en uropi : tal struen vidì distruen pa de brenad. Maintenant, voyons la phrase : tout immeuble est équipé contre l'incendie. Là, il ne s'agit manifestement pas d'un seul immeuble, mais de tous les immeubles, en totalité. On aurait, comme phrase paronyme "chaque immeuble est équipé contre l'incendie". jaki struen vid areden gon brenad = æq bynòψak cem kengár igoψháx ob
tal struen vid areden gon brenad = omen bynòψak cem kengár igoψháx ob. On me dira que j'pinaille, mais selon moi, ces deux paires de phrases ont un sens légèrement différent. Pour la première, on a droit à un échantillonnage, une quantité dans un ensemble donné. Dans la deuxième, c'est (en principe, du moins) la TOTALITÉ des éléments qui sont pris en compte. Des exemples, on pourrait en citer des pleins wagons... tiens ! justement : Diz vagòne se talim roj = ær waane • lal rube = ces wagons sont tout rouges (ils ne sont pas bicolores). Diz tale vagòne se roj = omnær waane • rube = ces wagons sont tous rouges (tous sont de la même couleur : y en a pas des blancs, des verts etc). Et y reste, bien sûr, le nom ; le tout est de s'en souvenir : Àt gans ep menrekun ċys (en uropi, ça donne quoi ?). _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
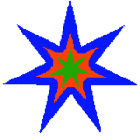
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mer 8 Fév 2023 - 15:21 Mer 8 Fév 2023 - 15:21 | |
| - Doj-pater a écrit:
- Difficile en Uropi d'utiliser des tournures alambiquées comme "ce dont il m'a parlé" > "ce qu'il m'a dit"
On se retrouve plus ou moins avec les même pierres d'achoppement. - Dopa a écrit:
- di, diz = ce qui est proche, que l'on peut montrer du doigt
da, daz = ce qui est éloigné dans l'espace ou dans le temps
donc ici:
I vizì daz wen tu vizì Sinon, bien sûr, j'aurais dû penser à daz. C'est vrai que, concernant le démonstratif, j'en ai qu'un seul : æt° ; et quand y a besoin de précisions, aussi bien pour les adjectifs que pour les pronoms, je m'en tire avec en (de moi, pour "ici"), an (de lui pour "là-bas"), mais du coup, je pourrais presque remplacer en par iyr, an par daar et le plus délicat, orn par dær. Seul inconve : l'appel à des voyelles longues. Æt, en fait, sert également pour l'adjectif que pour le pronom. On fera un peu gaffe, par conséquent aux mots qu'y a autour, mais aussi aux déclinaisons. Le pronom est déclinable, pas l'adjectif ; ça aide vach'ment, mine de rien ! eg vedja æt xeliys = j'ai vu cette voiture eg vedja æċ àt xeliysen = j'ai vu celui de la voiture. - Dopa a écrit:
- Le problème de DONT
Dont peut être complément de nom (génitif en Uropi) = WEJ
par ex. di bib av u seni krova > De bib WEJ krova se seni = le livre dont la couverture est vieille
ou complément d'un verbe
dans ce cas, on n'emploie pas wej, mais WEN avec la préposition appropriée
par ex. voko ov = parler de > De pol OV WEN i vok = la ville dont je parle
soino ov = rêver de > De ʒina OV WEN i soin = la femme dont je rêve
veno od = venir de > De famìl OD WEN i ven = la famille dont je suis issu. Moi aussi, "dont" m'intéresse vach'ment. Au début, ça paraît simple (pour les traducs, cf. l'inter en quote) : à kneg quan àt kowyt • von. Là, manifestement, quan est le génitif de qua ; les (rares) aneuvistes auront reconnu le génitif de tout nom ou pronom. à stad quan eg dysertun. Là, on pourra se dire que j'me suis pas foulé, et que j'ai relexiphié à domphes. Mais en fait, dysert appelle, en principe, un complément d'objet au génitif*, v'là la raison. Sinon, on peut s'rerouver avec : àt kad ni quas eg rev
àt gèmal fran quav eg • ùskan.qui pourraient d'ailleurs se traduire la femme à qui je rêve la famille d'où je suis issu. Pour ceux qui seraient gênés d'un "dont". ° Ær au pluriel, quand même ! Comme j'ai dit j'me rappelle plus où, àt (l'article défini) serait une forme édulcorée de æt (c'est LE chat des voisins : CE chat-là). Seul différence : le -T de l'article peut être éclipsé, y compris à l'écrit, devant deux phonèmes consonantiques, pas celui de æt ; même s'il est amuï, il reste dans l'orthographe. Y a le -T en aneuvien ; y a le D- en uropi, communs aux articles définis et adjectifs démonstratifs : on n'est pas trop éloignés.* Ce qui n'est jamais le cas en uropi. Le "dont" de complément de nom uropi s'explique très bien : le I du génitif se retrouve glidisé par la voyelle de we qui le précède, d'où wej. Wej et quan sont des calques l'un de l'autre. Tout ça, sans concertation ni copie, ces pronoms étant nés bien avant que chacun des deux idéolinguistes ne se doute de l'existence de l'autre._________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
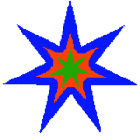
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Jeu 9 Fév 2023 - 11:50 Jeu 9 Fév 2023 - 11:50 | |
| Pris du fil Uropi 10 : - Doj-pater a écrit:
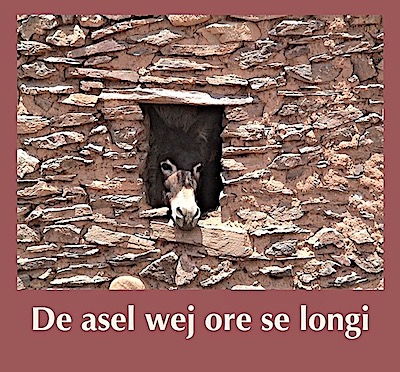 
 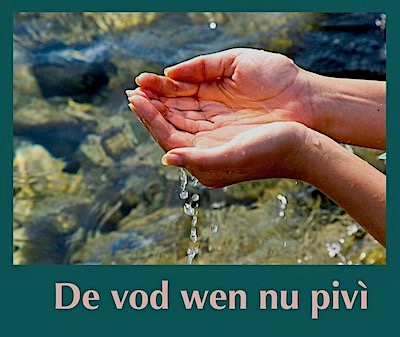 - Citation :
- L'âne dont les oreilles sont longues
le garçon qui conduit les bœufs
le marteau avec lequel il tape.
l'eau que nous bûmes. Ça donnerait donc, chez moi : àt asin quan auryke • lœnge
àt nexàvdak qua traṅvun àr boovse
àt mortel kœm quatev da slaagun
àt wadr quas er bevăr.Là, dans la troisième phrase, on fait connaissance avec un autre pronom ( pas seulement, d'ailleurs) relatif : quat, lequel est une imbrication du pronom bien connu (j'suppose) qua, avec l'article, également connu de tous (    ) les aneuvistes : àt. Ce mot est en fait le calque à la fois de "quel" et de "lequel". Je n'ai pas pu prendre quas (comme les uropistes font avec wen), qui est à l'accusatif ( àt kad kœm quas da geṅch* = la femme avec qui il danse), ni quav qui signifie "où". Du coup, quat, qui est, lui aussi déclinable comme tout nom ou pronom, est quand même bien utile. À la différence de qua, qui n'est que déclinable, quat varie aussi en nombre, le condensé de qua et àt n'est pas que lexical, il est aussi grammatical : quar zoṅkdur! = quels cons ! àt nexàv én quatev da goleg nep jàrev dek.Pour "taper", je ne manque pas de verbes non plus, puisqu'y a ték° pour "taper sur quelque chose" ; slaag, c'est d'jà plus fort (frapper), tàjeb, c'est sûr un clavier (on trouve encore types), enfin, dinsep, où on repère un morceau de diner (argent). Puisqu'on et dans les mots de liaisons vers les propositions subordonnées (entre autres), j'suis tombé en arrêt devant deux d'entre eux où y a une analogie étonnante : wo = quav (d'jà évoqué ci d'ssus) = où wan = tev = quand. Le point commun entre les deux termes uropis, c'est le W- qu'on trouve également dans d'autres mots, comme wa, wim etc. Quant au point commun entre les deux termes aneuviens, c'est le -V utilisé par ailleurs dans les noms et pronoms comme complément circonstanciel. Ainsi, quav évoque le circonstant de lieu # là où qua évoque le sujet et quas le COD, et par ailleurs, tev introduit une proposition circonstancielle (ici de temps) là où tep ( te, en uropi) introduit une proposition objet. La manière de faire est différente, mais donne des résultats comparables. * Mais aussi àt kad kœm quaċ da geṅch = la femme avec laquelle il danse. C'est vraiment proche ! le sens est identique, ça tombe donc bien. En uropi, ça doit donner, j'suppose : de ʒina ki wen he dans.° Da ték ob bambœse.# Par contre, dans des expressions comme "au cas où", le pronom quav n'est pas utilisé !_________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
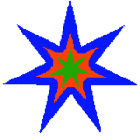
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Lun 13 Fév 2023 - 18:00 Lun 13 Fév 2023 - 18:00 | |
| - Citation :
- Y a que les fous et les robots qui n'ont peur de rien.
Nor tljutydur ea robodur* nep qbobev ùtev.Uni matine id robote fraj nit.La traduc uropie est à confirmer ou à démentir (avec la bonne soluce, 'videmment). * En fait, j'aurais pu mettre robor. Robo va pour toute sorte de robot, que ce soit un robot ménager, un robot industriel pour assembler des véhicules°... Robodu, c'est un robot anthropoïde, cher à Vilko, mais aussi à Fritz Lang et bien d'autres romanciers de science-ficion.° Et là, c'est d'une évidence criante : de quoi pourraient-ils avoir peur ? _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Vilko

Messages : 3564
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Lun 13 Fév 2023 - 22:17 Lun 13 Fév 2023 - 22:17 | |
| - Citation :
- Y a que les fous et les robots qui n'ont peur de rien.
En saiwosh : Kopet peltentili pi minlaitix kwas halokta. Dans mon idéomonde, les robots (qui parlent le mnarruc, et non pas le saiwosh) ont l'obligation de préserver leur intégrité physique et leur liberté de mouvement. Ils sont conscients des dangers et essaient de les éviter. Par exemple, un robot humanoïde, comme un humain, évitera de marcher sur une passerelle qui paraît sur le point de s'écrouler. La différence entre le robot et l'humain, dans mon idéomonde, c'est que le robot n'est jamais submergé par ses émotions, lesquelles ne sont même chez les humains que des messages électrochimiques transmis par les neurones. Chez les robots, ces “messages” existent aussi, mais ils sont bien moins puissants que chez les humains, ce qui donne l'impression que les robots sont dénués d'émotions. Un robot ne va jamais trembler de peur, par exemple, ou perdre son sang-froid, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Un robot qui reçoit l'ordre d'aller à la mort le fera sans discuter, car la préservation de son intégrité physique passe après l'obligation d'exécuter les ordres de l'autorité à laquelle il doit obéissance. Il n'a pas la capacité de refuser les ordres, et s'il ne reçoit pas d'ordres, il reste inerte, ou se contente d'exécuter les instructions générales, comme par exemple “tu t'occuperas de la maison en mon absence, tu feras le ménage et si besoin les petites réparations nécessaires.” C'est pourquoi on dit qu'il n'a pas d'âme : il est incapable aussi bien de désobéir que d'agir sans ordre. Si un robot prend des initiatives, ce sera toujours dans le cadre d'un ordre reçu. Par exemple : “tu feras tout ce qui est nécessaire pour éliminer les taupes du jardin.” Sachant qu'un robot n'est limité dans son action que par l'obligation qu'il a de respecter les lois du pays dans lequel il se trouve, un maître expérimenté évitera de donner des ordres trop vagues... | |
|   | | Anoev
Modérateur
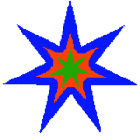
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 14 Fév 2023 - 16:56 Mar 14 Fév 2023 - 16:56 | |
| Comme ma réponse évoque spécifiquement les robots, je l'ai mise dans le fil des fembotniks : un endroit plus adapté. _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Doj-pater
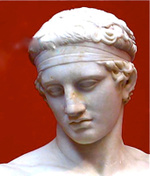
Messages : 4530
Date d'inscription : 04/01/2014
Localisation : France Centre
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 14 Fév 2023 - 17:52 Mar 14 Fév 2023 - 17:52 | |
| - Citation :
- Uni matine id robote fraj nit.
La traduc uropie est à confirmer ou à démentir (avec la bonne soluce, 'videmment). En Uropi, ne… que = solem (c'est à dire seulement); uni, c'est un adjectif = un seul, unique: donc Solem matine id robote fraj nit | |
|   | | Anoev
Modérateur
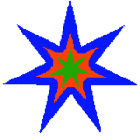
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mar 14 Fév 2023 - 18:37 Mar 14 Fév 2023 - 18:37 | |
| Merci pour la corrèq'. Y faut dire que j'avais eu des hésitations.
Sinon, pour "à" (on en a parlé au bout du fil), j't'invite à jeter un œil là d'ssus. Le texte date pas mal, mais il n'a pas changé d'un iota.
Pour "l'intolérance mène au crime", j'ai
elisubriynet liyd yn bùnĕz
parce que, justement, y a pas de mouvement.
Par contre, pour "la petite fermière mena la vache au taureau", y a
àt nexafærmkad liydă àt boovex dyn àt booveż.
Les différences entre dyn et yn, on les retrouve dans les traductions de "de ... à", en combinaison avec fran et devèr (de, depuis).
devèr mondaw yn lœrdavs = du lundi au samedi
fran jàrev pent yn dekut = de quatre à dix ans (d'âge)
ar lorèdăr fran snaṅsetev yn iyrrs = ils passèrent de la tristesse à la colère.
fran à stàtynev dyn ed bursalse = de la gare à nos bureaux.
Devèr est donc réservé à une idée temporelle, dyn à une notion de lieu. Donc devèr ... dyn n'existe pas.
Yn est très utilisé. On ne le confondra pas avec in :
ùt jàrev yn = dans un an
àt jàretev in = dans l'année. _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Anoev
Modérateur
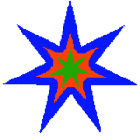
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Mer 15 Fév 2023 - 13:12 Mer 15 Fév 2023 - 13:12 | |
| - Doj-pater a écrit:
- Les prépositions A, Be, In
En aneuvien, les choses sont assez différentes, eu égard déjà aux cas de déclinaison utilisables, et qui, dans certaines... circonstances (seulement), permettent de se passer d'adposition (post- ou prépositions). Voyons tout ça en détail : Usklaro a u kid = Drintel ni ùt nexàvdus = Expliquer à un enfant Sendo u skrit a u fram = Appòste ùt epestes ni ù drœgdus = envoyer une lettre a un ami. Là, c'est clair, il s'agit d'attribution : l'aneuvien fait employer ni (ou nit, ou nir, s'il est intégré dans l'article défini àt), suivi du complément à l'accusatif. S'il s'agit d'un lieu de destination, le verbe, combiné au cas (accusatif, encore un coup) se suffisent à eux-même, toutefois, on peut toujours, en cas de nécessité uniquement, ajouter dyn, en tant que préposition. Ce tour traduit également "en" comme préposition de lieu : Ito a skol = gæn dyn skools = aller à l’école Lu far a Lion = Ar faare Lyon-s = ils vont à Lyon. Nu ve faro a Italia = Er mir faare Italeċ = Nous irons en Italie. He it od land a land = Da faar fran ùt laṅdev dyn alis : il va de pays en pays (il va d'un pays à un autre) Item a pol = Er pùzete staż = Allons en ville. Pour "de ... à" en matière de cours temporel, comme d'jà dit (y m'semb'), ce sont les deux prépositions devèr (circ.) ... yn (acc.) Ce varkì od morna a vespen = Ka ere làpore devèr nebav yn abens = Elle travaillait du matin au soir. Dans le cas de compléments de noms, ça ne change guère : De rad a Tur = À strad dyn Tours = La route de Tours De cag a liov = Àt artem leos = la chasse au lion Liam a Doj = À klim Divs = l'amour de Dieu. Vir a dest = Zhirit drex = tourne à droite. Par contre, pour ce dernier exemple : Da rugan jet kame a de kide = Ce voyou jette des pierres sur les enfants. La syntaxe aneuvienne est nettement différente : Æt gwapdak zlàt ùr stoonse nexàvduse ob.
Et on continuuuuue ! Pour "à", comme complément de lieu sans notion de destination, l'aneuvien utilise le circonstanciel sans adposition ; c'est bien pratique, parce qu'il traduit également "en" dans ces cas précis : Vart ma be de stasia = Mir waadit es à stàtynev : Attends-moi à la gare so be skol = ere skoolev : être à l’école so be de burò = ere bùrsalev = être au bureau lu vark be fabrik = ar làporer fàkturev = ils travaillent à l’usine Ce ʒiv in Francia = Ka liven Fraṅsev = Elle vit en France Lu ʒiv in pol = Ar liven stadev = Ils vivent en ville In ma som = eviψ = en moi-même in sia = demiψ° : en soi Wa i gus in ha = Quas eg làjden dav = Ce que j’aime en lui. be midià = ilidaw = à midi sia livo be sep = Dem gel hoψev hep = se lever à 7 heures. De kerk ste be vi dest = À sjel • ed skerdev orn = l’église est sur votre gauche be dia = deaw : de jour be noc = noxev : de nuit. "Par" se traduit toujours per en aneuvien, qu'il s'agisse d'un instructif, d'un instrumental ou d'un agent ; par certains côtés, c'est moins précis qu'en uropi, ou on a pa pour l'agent. Toutefois, la cause est exprimée par ber, qui signifie aussi "pour", dans ce cas précis. Be u sig de bosi = Ber ùt sigetev àt erkàpdaken = sur un signe du patron He gan 15 Euròs be hor = Da temes 15 eurose per hoψev = il gagne 15 € de l’heure (par heure) Je kost 8 Euròs be meter = Æt spenden 8 eurose per metrev = ça coûte 8 € le mètre (par mètre) kwer hore be noc = quàt hoψe per noxev : quatre heures par nuit tri vose be dia = tern fæteve per deaw = 3 fois par jour. ° Dem n'est pas déclinable.
Pour in, commun à l'uropi et à l'aneuvien, l'utilisation, est elle assez différente d'une langue à l'autre, loin s'en faut : le in aneuvien ne traduit ni "en", ni "sous", ni "par" ni "à". Il reste "dans", et même là, y a des petits pièges à évitassionner si on veut éviter la relex depuis le français ou... l'uropi. Explications 1) dans (lieu où l’on est, où l’on va) Ce ito in si kamar = Ka ingænun sed suvrœms = elle entre dans sa chambre. Là, pas besoin de préposition en aneuvien : elle existe déjà sous forme de préfixe au verbe. Comme le verbe est intransitif, le mot qu'y a derrière n'est certainement pas un COD. ito us in de strad = usgæn dyn àt geż = sortir dans la rue. Là, in est remplacé par dyn pour des raisons évidentes ( ùs et in donneraient une oxymore). i se in mi kamar = Eg • in med suvrœmev = je suis dans ma chambre. Là, in est indispensable ; le cas à aussi changé, c'est le circonstanciel, calque de l'ablatif latin ici. lu jeg in de kort= Ar spiylun in à plaréav = ils jouent dans la cour. Bon, là, y a pas trop de tiraillement entre les deux langues, sauf peut-être pour le deuxième exemple. Voyons plutôt la suite. Pour le temps, il est possible que la langue puisse utiliser in, mais toujours dans un cas précis : lorsque le procès doit se produire À L'INTÉRIEUR du laps de temps mentionné. Ainsi, on peut avoir àt heptaw in pour "dans la semaine" (dernier délai : dimanche ou samedi), mais ùt heptavs yn pour "dans une semaine" (à l'issue de la semaine, un jour ou deux après, mais pas plus). Bien noter, en plus de la différence de postposition, l'article, qui est différent, lui aussi, ainsi que le cas de déclinaison. Ʒivo in pavrid = liven hùgav : vivre dans la misère in u pej postàd = dool poctysev = dans une mauvaise position in di kodike = ær kjasyneve in = dans ces conditions in neb = fiygev in = dans le brouillard in dumad = ψkuretev in = dans l’obscurité. Pour "en", cf ci d'ssus ; toutefois, in tri dias = tern dawe pavàr = en trois jours in ses jare = seg jàreve pavàr = en six ans. qu'on ne confondra pas avec la préposition homonyme trawan tri dias = pavàr tern dawe = pendant trois jours trawan ses jare = pavàr seg jàreve = pendant six ans. Si on veut exprimer un état (en flamme, en larmes) voire une langue ou une devise, utiliser plutôt le circonstanciel, toujours sans adposition iginev, làkrymev, dysòrdynev, svartev, uropiv.Pour une matière, on utilisera plutôt le génitif : aurev, steelev. Par contre, derrière des verbes comme traṅslòk (traduire), tramòrfes (transformer), où là, on utilise l'accusatif précédé de yn : àt raan dem tramòrfesă yn prinskaż ber à smakev àt jœndakev = La grenouille se transforma en princesse suite au baiser du jeune homme. Comme chacun de nous a deux mains, on a donc I avì di bib in mande = eg haba æt knegs inte med hæntese = j’ai eu ce livre entre les mains Par contre, il s'agit ici d'une locution figurée, on a donc falo in de mande de fensi = vàle àr hætese àt hostiden inte = tomber entre les mains de l’ennemi. Là, par contre, on retrouve in, mais en postposition, (comme "dans ses bras") nemo in rame = gœnes ses pradhemse in = prendre entre ses bras in suntade = per cèrentuleve = par centaines in duzene = per dektintuleve = par douzaines in tiliade = per tœsaṅdeve = par milliers Ito us in de liuv = usdòme in lishev = sortir sous la pluie (là, l'aneuvien et l'uropi se rejoignent) de vik se lovi in luniluc = àt dorv • lynd klàrev moonen = le village est joli sous la lune. In kurtim = olyg tempev yn = sous peu in un sedia = ùt heptavs yn = sous huitaine. Là, on retrouve in et yn en postposition. Et voilûh ! _________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
Dernière édition par Anoev le Lun 11 Déc 2023 - 14:16, édité 2 fois | |
|   | | Anoev
Modérateur
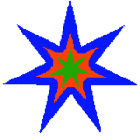
Messages : 37621
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  Jeu 16 Fév 2023 - 12:17 Jeu 16 Fév 2023 - 12:17 | |
| ... ou presque ! - Citation :
- J'ai vu, dans le Vordar, qu'on avait
be de miasor pour "chez le boucher" (dans sa boutique)
be ma pour "chez moi" (à mon domicile).
Mais en est-il de même (j'ai pas trouvé) pour
"la chasse chez l'homme de Néandertal"
"la sexualité chez les Romains" ? Be traduit donc aussi "chez". J'croyais avoir pensé à tout, sauf à ce p'tit détail. En français et en uropi, on peut dire "chez" même s'il ne s'agit pas d'un domicile (boutique, cabinet). Mais j'avoue que je n'y avais pas pensé, tant pour moi, ad, pris du latin APVD pouvait crier l'évidence qu'il s'agissait d'un domicile. Donc : ka pùzun àt medíkdus ad ? Formule acceptable ? ou impropre ? Pour être précis, on pourrait ben dire ka pùzun àt kàbyneċ medíkdun... mais bon... c'est d'un louuurd ! nettement plus lourd que ka pùzun àt bofteskoψ. Alors, ad ? pour ou contre les locaux professionnels ? réservé ou non au domicile ? Aujourd'hui, on peut très bien dire qu'on va chez Boulanger (ou chez Darty°) aussi bien qu'on va au... euh... chez le boulanger. Bref : j'suis pas encore bien fixé. Par contre, pour les autres sens de "chez", j'ai deux traductions en une : int. Pourquoi deux ? Tout simplement parce que ce petit mot peut prendre une place de préposition ou de postposition, selon l'usage qu'on lui donne : kœg int sameduve = La cuisine chez les Lapons. qud nexàvduv int = le désir sexuel chez l'enfant. À remarquer que le nom qui accompagne l'adposion est toujours au circonstanciel. Sinon, pour en revenir à ad. C'est grâce à cette postposition que j'ai développé la fonction de dem pour en faire un véritable pronom, resté invariable, cependant. ka • dem ad = elle est chez elle ; mais er dhep komar fran kav ad = nous venons de chez elle. De là, j'en ai extrapolé le nom (déclinable, lui) demad, pour "chez-soi" : Devèr àt krenchækadev, da hab nepjó demaż = Depuis le séisme, il n'a plus de chez-lui. ° Mais "à la Fnac".À c'propos, une petite histoire :
- Mercredi, j'peux pas, je mène ma fille au pédiatre.
- "chez le pédiatre", on dit.
- Ah...
- Ben oui, par contre, on mène la vache au taureau, le truie au verrat, la...
- Eh ben, justement, je confirme : je mène ma fille AU pédiatre._________________ - Pœr æse qua stane:
Pour ceux qui restent.
| |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi Sujet: Re: L'aneuvien, le psolat et l'uropi  | |
| |
|   | | | | L'aneuvien, le psolat et l'uropi |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
