|
| | Comment Vincent apprit le dibadien |  |
| | |
| Auteur | Message |
|---|
Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 27 Fév 2010 - 13:30 Sam 27 Fév 2010 - 13:30 | |
| - Nemszev a écrit:
- Vilko a écrit:
- L'inscription est en alphabet Deseret (mormon), j'ai réalisé un équivalent de l'inscription sur Paint avec la police "Huneybee"...

Certaines lettres ressemblent à celles de mon alphabet ba gai dun (exemple en signature)... L'aphabet Deseret a pourtant été inventé au milieu du 19e siècle... http://www.omniglot.com/writing/deseret.htm 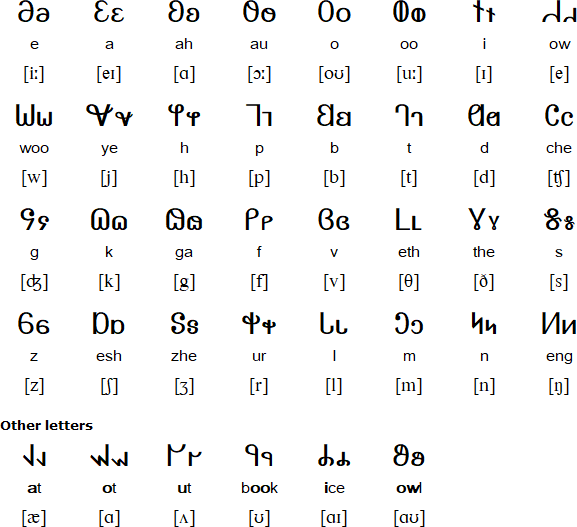 Le dibadien n'utilise pas toutes les lettres de l'alphabet deseret, sa phonologie étant plus simple que celle de l'anglais. Certaines lettres ont une valeur différente en dibadien : f = ph (prononcé pf ou f), le zhee = kh, et z est une lettre muette. Le dibadien écrit n'utilise pas les majuscules non plus, et se contente de tirets bas pour la ponctuation. Comme l'alphabet des Mormons leur est venu par inspiration divine, je suppose qu'il y a aussi une part d'inspiration divine dans le ba gai dun  Pour moi, l'intérêt de l'alphabet deseret était quadruple : 1. Dépaysant mais facile à apprendre. 2. Assez esthétique et pratique. 3. Toutes les lettres sont de même format, sans accent ni diacritique (c'était mentionné dans "Épépé", mais vu les descriptions du roman cela correspond plutôt à une écriture runique de plusieurs centaines de signes - comme le " kimrunnabo" de Ziecken). 4. Il entrait assez facilement dans "l'histoire externe" du dibadien : une langue inventée comme un code par des Américains du Nord, dont certains connaissaient le jargon chinook et d'autres (ou les mêmes) connaissaient l'alphabet des Mormons... | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 20 Mar 2010 - 18:07 Sam 20 Mar 2010 - 18:07 | |
| Un nouvel épisode des aventures de Vincent. Il n'y a pas beaucoup d'action, désolé, ce sera pour bientôt...
--------------------------------
Vincent avait pris l'habitude d'aller lire dans la bibliothèque de la rue Sopinayet, proche de la caserne. Située dans un immeuble mal entretenu qui devait dater d'une trentaine d'années, elle n'était pas très grande, composée seulement de trois pièces mal éclairée en rez-de-chaussée. Les livres provenaient surtout de dons des services municipaux et de donateurs privés. À Dibadi le papier est très cher, et donc les livres aussi. Pour cette raison il est très mal vu de jeter un livre usagé : on le revend ou on le donne. La bibliothèque de la rue Sopinayet héritait ainsi de livres qui ne trouvaient pas preneur sur les marchés du dimanche. Notamment, des vieux livres techniques périmés et des ouvrages tapés à la machine à écrire par des étudiants, pleins de fautes de frappe et reliés artisanalement.
C'est dans un volume soporifique intitulé Tilikëmquanën nanukhachyezda (Études Démographiques) que Vincent avait eu la confirmation de ses doutes : la population francophone originelle de Dibadi avait entièrement disparu à la fin de la guerre. Déportée ou massacrée par les robots de Pupong. Les chiffres étaient clairs, pour qui savait - et voulait - les trouver.
Diletyet accompagnait parfois Vincent à la bibliothèque, mais uniquement pour emprunter des livres illustrés. Il y en avait tout un rayon, résultat du travail individuel de collégiens qui avaient ainsi montré leur talent de calligraphes et de dessinateurs. Les histoires ainsi illustrées avaient toujours l'air de sortir des officines de propagande des cyborgs.
Ce jour-là, Vincent s'était assis à la grande table de la salle principale, en compagnie d'une douzaine de lecteurs habituels, des garçons et des filles portant l'uniforme bleu du lycée local, et deux hommes d'âge mûr, vieux garçons aigris, angoissés par leur clochardisation possible, un type humain fréquent à Dibadi. Diletyet était rentrée à la caserne, avec dans son sac de paille tressée les livres qu'elle avait empruntés.
C'était un jour de semaine, en fin de matinée. Vincent aimait venir à la bibliothèque lorsqu'il y avait peu de monde.
Un homme vêtu d'un costume de toile brune, une grosse sacoche de toile bleue en bandoulière, entra dans la pièce. Vincent le reconnut aussitôt : c'était Chon Khuchëk, avec qui il avait eu une longue conversation dans le train qui l'avait amené de son pays natal jusqu'à Dibadi.
Khuchëk avait peu changé depuis deux ans. Il était toujours aussi petit, maigre et chauve, avec des yeux bleus dans un visage ridé. Il ne sembla pas reconnaître Vincent, qui se replongea dans sa énième relecture des Tilikëmquanën nanukhachyezda, prenant des notes dans un carnet, et cherchant, derrière les chiffres arides et souvent approximatifs, à reconstituer la véritable histoire du peuple dibadien.
Khuchëk discuta longuement, à voix basse, avec la bibliothécaire, une grosse femme aux manières brusques, puis il s'approcha de la table où se trouvait Vincent :
"Chetenche, vous devez rendre ce livre" dit-il à voix basse.
"Comment cela, chetenche ?" rétorqua Vincent.
"Je travaille pour les services culturels du gouvernement. Ce livre contient des erreurs, nous allons le remplacer par une version corrigée" dit Khuchëk d'une voix fatiguée. S'il reconnaissait Vincent, il n'en disait rien.
"Une version corrigée... Je vois ce que vous voulez dire."
"Vous avez remarqué des erreurs dans le livre, vous aussi ?" demanda Khuchëk avec un sourire triste.
"Non. Et vous comprenez ce que je veux dire."
Vincent était satisfait, autant de tenir tête au vieux Khuchëk que de parler dibadien aussi bien que lui.
Khuchëk s'assit à côté de Vincent, et lui dit, en le regardant droit dans les yeux :
"Chetenche, vous ne voudriez pas vous faire expulser de la bibliothèque, n'est-ce pas ? Vous avez l'air d'être un bon citoyen. J'ai un travail à faire, et je dois le faire."
Vincent se rappela qu'il était milicien. Un incident avec un employé du gouvernement serait très mal vu à la caserne. Il ferma le livre et le donna à Khuchëk.
"Merci" dit ce dernier avec un sourire. "Mais je crois que je vous reconnais. Vous êtes arrivé ici il y a deux ans, n'est-ce pas ? Vous êtes francophone d'origine ? Je me souviens d'une longue conversation dans un train..."
"Oui, c'est moi, Mantolo Haiakkhuch" dit Vincent, qui préféra utiliser son nom dibadien.
Ils se mirent à bavarder, ce qui attira l'attention de la bibliothécaire, qui leur jeta un regard courroucé. Khuchëk invita Vincent à faire un tour dans le quartier avec lui.
Ils sortirent de la bibliothèque et se dirigèrent vers le parc Sidni Pëchakh, que Vincent connaissait bien : en tant que milicien, il y allait souvent, la nuit, pour arrêter des clochards.
Vincent se dépêcha de dire à Khuchëk ce qui lui tenait à coeur :
"Vous me surprenez, citoyen Khuchëk. Vous avez commencé votre carrière en créant des mots pour la langue dibadienne, vous avez peut-être inventé certains des mots que nous utilisons dans cette conversation, et vous vous retrouvez à courir les bibliothèques pour récupérer des livres, sous prétexte qu'ils contiendraient des erreurs. Vous savez bien que vos chefs vous ont demandé de récupérer des livres parce qu'ils mettent en danger la mythologie qu'ils ont inventée, l'histoire du général Pupong et des quatre vieillards ?"
Khuchëk hocha la tête.
"Mantolo" dit-il à voix basse, "Je vais te révéler un secret. Un tout petit secret, et tu comprendras pourquoi je fais ce que je fais. Les cyborgs qui nous gouvernent ne sont pas seuls. Les cerveaux des cyborgs sont faits de yeksootch, comme tu le sais."
"Oui, bien sûr, yeksootch le gaz pensant" dit Vincent, qui se demandait où Khuchëk voulait en venir.
"Eh bien, il n'y a pas que les cerveaux des cyborgs qui sont faits de yeksootch. Certains robots ont des cerveaux de yeksootch, également. On voit rarement ce genre de robots à Dibadi, mais plutôt à la campagne, où ils travaillent la terre, et construisent d'autres robots dans des usines loin de chez nous."
"Je suppose également que les dirigeables bleus, à peine visibles dans le ciel, mais dont on voit les lumières la nuit, ont aussi des cerveaux de yeksootch" dit Vincent.
"Oui, c'est cela... Eh bien, les vrais dirigeants du pays, ce sont des robots. Pas les robots que l'on peut voir dans les champs, dans les usines ou dans le ciel, non, des robots cachés, connectés au réseau informatique planétaire."
"C'est un secret, ça ?" demanda Vincent, incrédule.
"Pas vraiment, mais les cyborgs sont très imbus de leurs fonctions. Ils sont ministres, gouverneurs, sénateurs, et ils tiennent à ce qu'on pense que ce sont eux qui gouvernent. Alors qu'ils ne sont que des bouches dont la fonction est de transmettre les décisions prises par d'autres."
Ils étaient arrivés dans le parc. Il y avait peu de monde sur les bancs et dans les allées, quelques femmes dont les jeunes enfants jouaient dans l'herbe, et les inévitables demi-oisifs mal vêtus que l'on trouve partout à Dibadi.
"Et alors ?" demanda Vincent.
"Réfléchis un peu. Les cerveaux des robots sont mille fois plus rapides que les nôtres. Le travail intellectuel ne vaut presque plus rien. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de moi comme linguiste : des robots font le travail beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et sans demander de salaire."
Khuchëk s'assit sur un banc, tout en continuant de parler :
"Une intelligence artificielle, c'est l'équivalent de mille cerveaux humains travaillant à plein temps. On ne sait pas combien elles sont, mais il y en a suffisamment pour gérer les neuf millions de dibadiens. Maintenant, elles font même les traductions. C'est pour ça que j'ai été transféré à la sous-direction des bibliothèques, on n'avait plus besoin de moi ailleurs comme linguiste."
"Vous avez toujours du travail" objecta Vincent, qui s'était assis à côté de Khuchëk.
"Oui, heureusement. Les cerveaux artificiels ont besoin de bouches : ce sont les cyborgs. Ils ont aussi besoin de mains : ce sont les petits travailleurs comme toi et moi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?"
"Je suis milicien" répondit Vincent.
"Bien, bien... Je récupère les livres inutiles pour qu'ils soient brûlés, et toi tu récupères les humains inutiles, les clochards sans ressources, les handicapés que personne ne veut prendre en charge, pour qu'ils soient... mis à l'écart, c'est bien comme ça qu'on dit ?"
"Si on veut." Vincent se sentit rougir.
"Tu vois, Mantolo, c'est ça qui est horrible, ici, quand on y pense. On brûle les livres, on fait disparaître les gens... Mais c'est fait proprement, et la grande majorité des habitants vit modestement mais normalement, travaille dans les ateliers ou dans les bureaux, prend des transports en commun bondés, mange une nourriture bon marché pleine de produits chimiques, et n'a peur que d'une chose, c'est de tomber dans la pauvreté et de rejoindre les hordes de clochards que tu pourchasses la nuit."
"On ne peut rien faire" dit piteusement Vincent. "Presque toute notre nourriture est produite par des robots. Le savoir technique est contrôlé par des robots. Nous sommes neuf millions de prisonniers dans une ville de quarante kilomètres de diamètre."
"Je ne te le fais pas dire..." dit Khuchëk avec un sourire. "Tiens regarde cette montre" dit-il en montrant sa montre à affichage numérique, fixée par un bracelet de bioplastique à son poignet pâle et velu. "Elle vaut cher, bien qu'elle utilise une technologie déjà ancienne et des composants bon marché. Pourquoi ? Parce qu'elle a été assemblée à la main par des humains dans un atelier, ici à Dibadi. Mais les composants électroniques ont été faits par des robots. Les Dibadiens ne savent pas les faire, mais les robots, si. Sans les robots, il n'y a plus de montres à Dibadi. Et ça ne s'arrête pas là. Sans les robots, il n'y a plus d'emplois dans les ateliers où l'on assemble les montres, ni dans les boutiques où on les répare et où on change les piles."
"Je vois" l'interrompit Vincent. "Les robots contrôlent Dibadi parce qu'ils contrôlent la technologie. Y compris la technologie militaire."
"C'est ça. Dans le fond, c'est simple. Toutes ces révoltes, ces émeutes qui éclatent de temps en temps, ne servent à rien, vraiment à rien. Si elles réussissaient, le peuple mourrait de faim en un mois."
"On pourrait détruire les robots et récupérer les champs, les cultiver nous-mêmes !" dit Vincent d'une voix farouche.
"Tu plaisantes, j'espère. Sans outils, sans semences, sans savoir-faire agricole ? Et même s'il était si facile que ça de tuer les robots, comment tenir jusqu'à la première récolte, alors que les dépôts de nourriture sont à la campagne, gardé par des robots, ou par des cyborgs, ce qui revient au même ?"
Vincent se sentit soudainement mélancolique. Il regarda une femme en longue jupe brune et veste marron, les cheveux noirs et le teint mat comme une gitane, qui jouait à la balle avec une petite fille qui avait l'air d'avoir trois ou quatre ans, et il se sentit un peu mieux. Au moins, la plupart des Dibadiens mangeaient à leur faim et vivaient en paix. Ce n'était pas nécessairement vrai dans les autres pays. | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 29 Mai 2010 - 21:42 Sam 29 Mai 2010 - 21:42 | |
| Un nouvel épisode dans la vie de Vincent. Une scène ordinaire dans un monde futur...
-------------------------
Un matin, Vincent apprit par son chef qu'il était convoqué par le capitaine Baltë dans le gymnase, avec une dizaine d'autres miliciens. Il s'y rendit, un peu inquiet.
Le capitaine Baltë était un grand et gros moustachu qui avait tendance à s'essouffler en parlant. Il les reçut debout, une feuille de papier à la main, et leur fit un bref discours:
"Patlisztada, chetencheda. Comme vous le savez, notre pays le Niémélaga est un protectorat du Padzaland, notre grand voisin francophone du nord-ouest. Ces gens-là respectent les droits de l'homme, et ils veulent nous en faire profiter. Une commission d'enquête padzalandaise va venir demain inspecter le Sëkukyakha. Les rumeurs selon lesquelles des clochards y seraient exterminés sont arrivées jusqu'à Padza."
Baltë sourit. Apparemment, les rumeurs l'amusaient. Les gens racontaient que les clochards - hommes, femmes, enfants - étaient envoyés dans les étages supérieurs de l'immeuble pour y être exécutés, après avoir langui pendant des années dans les étages inférieurs. On racontait des choses affreuses et contradictoires. Personne ne savait vraiment ce qu'il fallait croire. Ces ragots imbéciles irritaient les gens sérieux, qui savaient que des milliers de gens vivaient depuis des années dans le Sëkukyakha aux frais du contribuable et sans fournir le moindre travail.
Le capitaine reprit la parole :
"Les autorités ont décidé que des miliciens assureraient la sécurité des membres de la commission, c'est pour cela que je vous ai sélectionnés. Je vais vous résumer brièvement ce dont il s'agit : les Padzalandais sont arrivés à Dibadi en train hier soir. Des agents du ministère des affaires étrangères leur ont fourni des véhicules avec chauffeurs et des interprètes. J'ai désigné l'adjudant Kalatayi comme chef pour l'opération de demain. Vous disposerez d'un car de la milice, j'y ai veillé. Votre travail consistera à accompagner les Padzalandais, leurs interprètes et le haut fonctionnaire qui sera là pour les assister. C'est tout. Soyez corrects, vous représentez Dibadi, et les membres de la commission ont tout pouvoir, vous serez à leur service. Je répète : vous serez à leur service. L'adjudant Kalatayi sera le chef de l'opération et prendra les initiatives nécessaires pour que tout se passe bien. Rendez-vous ici tout à l'heure, à quatorze heures."
L'adjudant Kalatayi, un grand costaud au sourire mielleux qui avait une solide réputation de faux-cul et de lèche-botte, hocha la tête pour marquer son approbation.
Baltë recommença sont discours, en changeant quelques mots. Cela faisait des années qu'il commandait des miliciens, dont très peu avaient le dibadien comme langue maternelle, et il avait pris cette habitude pour être sûr d'être bien compris.
Avant de mettre fin à la réunion, Baltë prit Vincent à part :
"Chetenche Haiakkhuch... Vous êtes francophone de naissance, n'est-ce pas ? J'ai des instructions particulières pour vous. Vous ferez comme si vous ne compreniez pas le français, c'est clair ? Je ne veux pas de discussion entre vous et les membres de la commission d'enquête. Ces gens-là sont nos ennemis, ne l'oubliez pas, ils essayent de faire condamner le Niémélaga pour crimes contre l'humanité ! Vous ne leur parlerez pas ! Mais vous écouterez, et ce soir, dès que vous serez rentré à la caserne, vous me téléphonerez chez moi pour me faire un petit compte-rendu. Tlush patitap wik... Vous avez bien compris ?"
"Parfaitement. A vos ordres, mon capitaine."
Quelques heures plus tard, un car emmena Vincent et ses collègues devant le Sëkukyakha. Après une heure d'attente ils virent arriver une demi-douzaine de grosses voitures noires, chacune d'elles contenant, outre le chauffeur, un ou deux officiels padzalandais et un interprète dibadien. Contrairement à ce qui était prévu aucun haut fonctionnaire dibadien n'était là. Ce genre de dysfonctionnement était courant à Dibadi et n'étonnait personne.
Toutefois, Matësh, le directeur du Sëkukyakha, était là, vêtu de son plus beau costume gris et cravaté de bleu, décontracté et souriant.
Les Padzalandais étaient six, quatre hommes et deux femmes, et discutaient entre eux en français. Ils serrèrent la main de Matësh en faisant ostensiblement la grimace. Vincent se dit avec une joie perverse que l'après-midi commençait mal pour Matësh.
Les six interprètes dibadiens, qui étaient tous des femmes, papillonnaient et riaient en passant avec aisance d'une langue à l'autre. A Dibadi, les interprètes sont toujours des cyborgs. Vincent se demanda si les Padzalandais le savaient. Peut-être pas.
Le temps était gris, annonciateur de pluie prochaine. Les vingt étages de béton gris du Sëkukyakha et ses centaines de fenêtres de verre dépoli se dressaient au dessus d'eux, un spectacle familier pour Vincent, qui avait souvent l'occasion d'y amener des clochards capturés dans les jardins publics.
Matësh emmena la petite troupe - miliciens compris, il y avait plus d'une vingtaine de personnes - à l'intérieur du bâtiment, dans le grand hall d'entrée aux murs bleu clair. Comme d'habitude, une hôtesse et deux miliciens étaient assis derrière le comptoir.
"Où sont les résidents ? Nous voulons accéder à tous les étages," demanda une Padzalandaise, une grande femme corpulente aux longs cheveux rouges et bouclés qui contrastaient fortement avec ses yeux sombres et son visage basané.
Matësh indiqua les ascenseurs. L'adjudant Kalatayi dit à Vincent : "Tu suis la grande rousse, d'accord ?"
Après avoir discuté de nouveau entre eux les Padzalandais décidèrent de se diviser en trois groupes de deux et d'explorer séparément le bâtiment tout en restant en contact par téléphone-radio. Les employés permanents du Sëkukyakha leur serviraient de guide.
Vincent se retrouva dans un groupe constitué de Matësh, de la grande femme rousse, d'un petit Padzalandais fluet aux yeux clairs, de deux femmes-interprètes et d'un autre milicien. Ils étaient sept, ce qui était à peu près la capacité d'un ascenseur.
La femme rousse semblait avoir un rang important; elle parlait haut et fort et prenait des décisions sans consulter personne. Elle décida de commencer directement par le dernier étage. Matësh, qui faisait des efforts visibles pour ne pas avoir l'air trop servile, appuya sur le bouton du vingtième étage.
L'ascenseur était vieux et le trajet parut interminable à Vincent. Il remarqua que le petit fluet le regardait avec des yeux fixes et une expression crispée. Visiblement, il le prenait pour un tueur, à cause de son uniforme marron de milicien.
La porte de la cabine s'ouvrit. Ils pénétrèrent dans une toute petite pièce surveillée par des caméras. Matësh sortit un trousseau de clés et ouvrit une porte blindée, derrière laquelle se trouvait une salle immense mais plutôt basse de plafond, avec des colonnes de béton brut.
Une odeur forte, tiède et musquée prit Vincent à la gorge.
Il comprit pourquoi : la salle était remplie de centaines, voire de milliers de cages contenant des rats, de toutes tailles et de toutes les nuances de noir, de gris et de blanc. Les litières étaient sales, encombrées de morceaux de viande pourrissante à demi dévorée et de crottes séchées. Il devait y avoir là plusieurs milliers de rats, peut-être même plusieurs dizaines de milliers.
A la suite de Matësh, le groupe s'avança prudemment dans un couloir entre les cages. Le petit fluet prit des photos.
Vincent prit bien garde à ne pas s'approcher de certaines grandes cages, occupées par des rats géants, monstrueux, qui tremblaient de façon convulsive, s'accouplaient ou se battaient en faisant voler la paille de leurs litières.
"D'où vient la nourriture de ces animaux ? Et à quoi servent-ils ?" demanda la grande rousse d'une voix aigre.
"Nous achetons des aliments avariés, périmés, à prix réduit," expliqua Matësh. "Ces rats sont modifiés génétiquement. Certains d'entre eux, par exemple, ont un sang identique au sang humain. Ils nous sont fournis par le laboratoire Tagi-Bophin..."
"Je veux voir vos livres de comptes."
"Comme il vous plaira, Madame."
Matësh était certainement un cyborg : son sang-froid était parfait. La femme insistait :
"Nous irons consulter ces livres dans votre bureau, monsieur Matësh. En attendant, je veux tout voir dans cette salle..."
Derrière une cloison faite d'armoires métalliques placées les unes à côté des autres, ils découvrirent une dizaine de robots-araignées, d'environ un mètre cinquante de haut, totalement inertes. Ils étaient debout sur leurs huit pattes raidies, leurs quatre bras d'aluminium articulé pendant sur les côtés. Leur tête était une simple boule hérissée d'organes divers dont Vincent ne connaissait pas l'usage.
"Qu'est-ce que c'est que ça ?" hurla la grande rousse.
"Des robots, Madame. Ce sont des robots. Ils travaillent ici. Ils sont contrôlés par radio" expliqua Matësh. "L'intelligence artificielle qui les contrôle est située ailleurs, je ne sais pas où. Je communique avec elle par ordinateur. Aujourd'hui il n'y a rien à faire, donc les robots sont désactivés."
Après avoir longuement parlé dans son radio-téléphone la femme rousse décida de visiter le dix-neuvième étage. Matësh emmena le groupe jusqu'à un escalier menant à l'étage inférieur.
Au dix-neuvième étage une odeur douce, un peu écoeurante, flottait dans l'air. Une odeur du sang refroidi. Ils étaient arrivés dans un endroit aménagé comme une boucherie, avec des cloisons à hauteur d'homme, auxquelles pendaient des hachoirs de différentes tailles, et de grandes tables carrelées.
La femme rousse remarqua des cylindres creux d'environ un mètre de haut et cinquante centimètres de diamètres. L'intérieur de ces cylindres était obscur.
"Ce sont des vide-ordures" expliqua Matësh. "Les déchet tombent directement dans les bennes du sous-sol."
"Eh bien, on va examiner ces déchets."
"Les bennes ont été vidées la nuit dernière" dit Matësh d'une voix douce.
"On va vérifier... A quoi sert cet endroit ?"
"A écorcher et découper les rats. Comme je vous l'ai dit beaucoup de ces animaux sont génétiquement modifiés; leur chair est saine et comestible."
"Vous faites manger de la viande de rat aux gens ?"
"Non, pas du tout, jamais. Nous nourrissons les rats avec la viande de leurs congénères. Ce n'est pas vraiment de la viande de rat, d'ailleurs, elle est génétiquement modifiée pour avoir le goût et la consistance du lapin. Nous travaillons pour le laboratoire Tagi-Bophin, comme je vous l'ai déjà dit."
"Expliquez-moi, Monsieur Matësh, en quoi cette activité, disons agro-industrielle, est-elle de la compétence d'un centre d'accueil social comme le Sëkukyakha ?"
Matësh attendit que l'interprète ait fini de traduire les paroles de la femme rousse pour répondre :
"Nous avons besoin de nous autofinancer. Notre contrat avec Tagi-Bophin nous est nécessaire, financièrement parlant. Sinon, nous ne pourrions pas couvrir nos frais de fonctionnement."
"Je vois que vous avez réponse à tout, Monsieur Matësh" dit la grande rousse avec une ironie appuyée.
Matësh ne répondit rien.
Un peu plus loin, ils trouvèrent, comme ils s'y attendaient, d'autres robots-araignées désactivés.
"Il n'y a pas d'armoires frigorifiques, c'est surprenant pour un endroit où l'on travaille la viande" remarqua la grande rousse.
"Les rats aiment la viande faisandée" rétorqua Matësh.
A l'autre bout de l'étage ils remarquèrent de grandes armoires métalliques contenant des vêtements de toutes tailles, pour la plupart usés ou déchirés. Juste à côté ils virent des machines à laver et des séchoirs, des déchiqueteuses et des broyeuses, et des piles de cartons pliés.
"C'est notre laverie" dit Matësh. "Je récupère tout ce que je peux auprès d'associations caritatives, mais je suis obligé de faire le tri, on nous donne vraiment tout et n'importe quoi. Nous avons environ quinze mille pensionnaires dans cet immeuble, comme vous le savez."
"Il faudra aussi aller visiter ce laboratoire Tagi-Bophin..." dit la grande rousse.
"Il est à la campagne" dit Matësh. "Et puis, que verrez-vous ? Des rats, des ordinateurs, des robots et des cyborgs dans une ferme au milieu des champs."
"Monsieur Matësh, c'est à moi de décider de ce que fait la commission, pas à vous."
Le petit fluet avait dessiné le plan de l'étage sur un bloc-notes. Ce fut lui qui remarqua une pièce passée inaperçue.
Elle était assez grande et avait deux portes, l'une donnant sur le vestibule où se trouvait l'ascenseur, et l'autre sur la boucherie. Faiblement éclairée, elle n'avait ni fenêtres ni meubles, à part deux grands coffres de bois, l'un contenant des cordes et des lanières, l'autre des sacs de toile.
"Tiens tiens, un autre mystère" dit la grande rousse. "Quelle explication allez-vous nous donner cette fois-ci, Monsieur Matësh ?"
"Une explication toute simple et évidente, Madame" répondit Matësh sans se démonter. "Cette pièce est inutilisée, comme vous le voyez. On y stocke des cordes et les sacs, dont on a parfois besoin pour faire des paquets."
Vincent avait pensé à autre chose, mais il préféra ne rien dire. A son avis, les clochards qui devaient mourir étaient amenés dans cette pièce, individuellement ou par petits groupes, depuis l'ascenseur. Là, ils étaient ligotés et des sacs de toile étaient mis sur leur tête pour les empêcher de voir ce qui leur arrivait. Arrivés à la boucherie, ils étaient mis à la disposition des robots-araignées, étranglés et dépecés. Leurs vêtements étaient récupérés et lavés, le reste était détruit au moyen des déchiqueteuses et des broyeuses, pour finalement être jeté dans les vide-ordures. Leur chair nourrissait les rats dans les cages.
Les Padzalandais avaient moins d'imagination que Vincent. Ils se contentèrent de noter l'existence de la pièce et son contenu.
La grande rousse décida de passer au dix-huitième étage.
Vincent avait envie de vomir, son visage était couvert de sueur. Combien de personnes étaient ainsi tuées chaque année ? Tout dépendait, en fait, de la quantité de chair humaine que les rats pouvaient manger. Le Sëkukyakha hébergeait environ un millier de personnes par étage, et les résidents changeaient d'étage en moyenne une fois par an. Les rats pouvaient-ils manger mille cadavres par an ? Mille fois cinquante kilos de viande, disons. De quoi nourrir dix mille rats, à raison de cinq kilos de viande par an pour chaque rat ? Il n'avait aucune idée de la quantité de viande qu'un rat pouvait manger en un an. Et il y avait bien dix mille rats au vingtième étage...
Le groupe descendit un escalier pour atteindre le dix-huitième étage. Matësh ouvrit une porte blindée avec une des clés de son trousseau, et ils se retrouvèrent dans un vestibule sans fenêtre, équipé de caméras de surveillance.
"Ces caméras sont reliées à une intelligence artificielle" expliqua Matësh. "En cas d'incident la milice est automatiquement prévenue."
Matësh ouvrit une deuxième porte, et le groupe se retrouva dans un long couloir blanc et relativement propre, dont les deux côtés étaient bordés de portes numérotées.
"Ce sont les chambres des résidents" expliqua Matësh. "Il y a aussi des sanitaires, une cuisine, un réfectoire et une salle de jeux."
Une dizaine d'hommes vinrent à leur rencontre. C'était visiblement des résidents, vêtus de haillons, maigres et l'air apathique, les joues creuses et les dents en mauvais état. Aucun d'eux n'était jeune.
"Nous sommes obligés de leur donner des médicaments pour éviter les bagarres" dit Matësh tranquillement. "L'inconvénient, c'est que ces médicaments diminuent fortement l'appétit. Ils diminuent aussi la libido, ce qui est une bonne chose quand des hommes vivent entassés les uns sur les autres."
La grande rousse s'emporta : "Est-ce que c'est une façon de traiter les gens ? Vous n'avez pas honte ?"
"Si vous voulez emmener tous nos pensionnaires au Padzaland avec vous, pour moi il n'y a aucun problème" répondit Matësh avec un grand sourire.
La grande rousse répondit quelque chose d'une voix sifflante, que Vincent entendit mal et que l'interprète ne traduisit pas.
Au fond du couloir, Vincent remarqua un petit groupe de miliciens. Il les reconnut : c'étaient des cyborgs affectés au Sëkukyakha. Ils étaient tous de haute taille et puissamment musclés, mais seulement armés de matraques, avec des menottes passées dans leurs ceinturons.
Le petit fluet était déjà en train de tracer un plan de l'étage sur son bloc-notes pendant que la grande rousse discutait avec les résidents par l'intermédiaire de l'interprète.
De plus en plus de résidents arrivaient, et au bout d'un moment le couloir en fut rempli. Les miliciens-cyborgs les firent dégager, poliment mais fermement. Les résidents s'exécutèrent sans protester. Dix ou quinze ans de Sëkukyakha les avaient détruits psychologiquement et physiquement.
Au bout d'une heure, le groupe descendit au dix-septième étage derrière Matësh. Ils retrouvèrent les deux autres groupes.
"C'est pas l'idéal ici mais nous n'avons rien vu d'illégal" dit l'un des Padzalandais à voix basse. Les membres de la commission ne savaient pas que Vincent parlait français et ils s'exprimaient librement devant lui, comme s'il n'était pas là.
"On aurait dû faire une visite surprise" dit la grande rousse d'un ton rageur.
"C'est ça, ils nous auraient laissé entrer rien qu'en voyant nos passeports padzalandais et nos lettres de mission" rétorqua une jeune femme sur un ton sarcastique.
"Tirons-nous d'ici, j'étouffe" dit le petit fluet entre ses dents, tout en surveillant du coin de l'oeil les interprètes, qui s'étaient éloignées pour discuter entre elles.
Soudainement, un flot de paroles s'échappa de la bouche du petit fluet : "Je ne supporte pas les Dibadiens, non, vraiment pas. On ne sait jamais qui sont les cyborgs et qui sont les humains. De toute façon, il faudrait tous les éliminer, tous les Dibadiens, et pas seulement les cyborgs. Les humains d'ici parlent la langue des cyborgs, ils pensent comme les cyborgs, ils ont adopté la religion des cyborgs. Pour moi ce sont... des rats, c'est ça, oui, des rats. Regardez-moi ces idiotes d'interprètes... Je suis sûr qu'elles savent la vérité sur le Sëkukyakha, et elles sont bien contentes que nous n'ayons rien trouvé."
"Serge, tu dis ce que nous pensons tous" murmura la grande rousse d'une voix grave.
Vincent, qui se sentait de plus en plus mal, était outré. C'était donc ça, ce que pensaient ses anciens compatriotes ? Il en avait presque les larmes aux yeux.
"Je dois vérifier la comptabilité" dit la grande rousse.
Tout le monde descendit par les ascenseurs jusqu'au premier étage, où se trouvait le bureau de Matësh. La grande rousse s'y enferma pendant une heure avec le petit fluet, une interprète et Matësh lui-même, pour vérifier les livres de comptes pendant que les autres membres de la commission d'enquête et les Dibadiens descendaient dans le hall.
Vincent était censé rester avec la grande rousse, dont il assurait la protection, mais Matësh lui fit signe de ne pas entrer dans son bureau. Il s'appuya contre le mur du couloir et au bout d'un moment il se sentit mieux.
Finalement la grande rousse et le petit fluet sortirent presque en courant du bureau de Matësh, descendirent vers le hall au pas de charge et se dirigèrent vers la sortie, suivis des autres Padzalandais et des interprètes.
"Mon adjudant, je n'ai plus besoin de vos hommes" dit Matësh à Kalatayi d'un ton joyeux. "Vous pouvez rentrer dans votre caserne."
Ce fut le capitaine Baltë qui eut le mot de la fin, lorsque Vincent lui téléphona le soir :
"Vous voyez, Haiakkhuch, l'avantage avec les cyborgs, les robots et les intelligences artificielles, c'est qu'ils n'ont pas d'état d'âme et qu'ils ne parlent pas. Je doute fort que l'on puisse faire faire par des humains le travail que font les robots-araignées à la boucherie..." | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 6 Juin 2010 - 14:49 Dim 6 Juin 2010 - 14:49 | |
| Un nouvel épisode, écrit sous l'inspiration du moment. Comme quoi ce qui nous paraîtrait monstrueux peut, dans un contexte particulier, devenir, sinon acceptable, du moins tolérable...
Les prix indiqués sont extraits, ou déduits, du roman de Ferenc Karinthy.
Les pensées de Vincent peuvent choquer, mais n'oublions pas le contexte : un monde appauvri qui n'arrive plus à nourrir toute sa population. Dibadi est une exception, mais on n'a rien sans rien...
--------------------------
Le lendemain de sa visite au Sëkukyakha avec la commission d'enquête, Vincent se sentit plutôt déprimé. Il préférait ne pas faire part de ses états d'âme à Diletyet, pour ne pas l'inquiéter, et il sortit pour marcher seul dans les rues.
A Dibadi les salaires de la très grande majorité des habitants sont faibles. Le salaire minimal est d'un ducat par heure de travail. Les clochards qui louent leurs services comme portefaix pour décharger les camions reçoivent un ducat pour une heure et demie de travail. La semaine de travail est de six jours de huit heures. Un travailleur de base travaillant à temps plein gagne donc au minimum quarante-huit ducats par semaine. Tout ce qui est subventionné est bon marché : un ticket de métro coûte cinquante sous (un demi ducat), un repas pour une personne dans une cafétéria (entrée, plat principal, café) coûte un peu moins d'un ducat. Le logement dit social est très bon marché, la médecine est gratuite dans les hôpitaux publics, l'enseignement est gratuit jusqu'à l'age de quinze ans. Même les uniformes d'écoliers sont fournis par l'Etat. Les vêtements de drap marron que portent beaucoup de Dibadiens sont fabriqués dans des entreprises publiques et très bon marché. D'ailleurs, l'uniforme des miliciens en est une variante.
Il n'y a pas vraiment de système de retraite, bien que les banques proposent divers systèmes de "comptes bloqués" qui sont censés être l'équivalent. Les gens âgés de plus de soixante-cinq ans et les invalides touchent une pension d'une vingtaine de ducats par semaine et sont dispensés de loyer dans les appartements publics. A condition, bien sûr, d'en trouver un dans cette ville géante et surpeuplée.
Tout ce qui n'est pas subventionné, est très cher: une carte routière coûte douze ducats, un trajet en taxi, cinquante sous la minute.
Il fallut un certain temps à Vincent pour comprendre comment le système maintenait les gens sous contrôle : pour ne pas glisser dans la misère, avec le Sëkukyakha ou l'un de ses équivalents comme ultime horizon, il faut travailler. Quarante-huit heures de travail par semaine sans congés payés, et juste de quoi vivre. Economiser sou par sou pendant des mois pour se payer une paire de chaussures de bonne qualité plutôt que les souliers de toile fournis par l'Etat. Faire les marchés où tout se vend et se revend. On ne jette rien, à Dibadi. Un pantalon archi-usé, reprisé tellement de fois qu'on ne voit plus le tissu originel, fera le bonheur d'un pauvre qui l'achètera un ducat sur un marché.
Vincent s'aperçut avec amusement qu'à Dibadi les teinturiers font vraiment de la teinture : vous leur donnez un vêtement constitué de rapiéçages de couleurs diverses, un vrai manteau d'Arlequin, et ils le teignent dans la couleur de votre choix - en général noir ou gris sombre - afin que le vêtement ait l'air neuf.
Ceux qui ont la chance de porter un uniforme - et cela fait beaucoup de monde à Dibadi : écoliers, pompiers, miliciens, agents des transports publics - ont tendance à le porter même lorsqu'ils ne sont pas en service. C'est souvent leur seul vêtement en bon état et ils montrent en le portant qu'ils ont un travail stable. De plus, ils peuvent compter sur la solidarité quasi-automatique des autres porteurs d'uniformes.
Toutefois, comme beaucoup de miliciens, Vincent préférait porter une tenue anonyme lors de ses promenades en ville : son premier uniforme, dont il avait enlevé les insignes et qu'il avait fait teindre en noir, le transformant ainsi en un costume d'allure très dibadienne. Mais il gardait ses solides godillots de cuir, bien commodes pour la marche à pied. De toute façon, il n'en avait pas d'autres, à part une paire de sandales en bioplastique qu'il portait chez lui.
Malgré la pauvreté généralisée - et Vincent savait que les miliciens faisaient presque partie des privilégiés - un grand nombre de gens possèdent des voitures. D'où vient l'argent ? Vincent estimait que 10% seulement des Dibadiens avaient les moyens d'acheter une voiture : chirurgiens, hauts fonctionnaires, commerçants, hommes d'affaires... Comme la plupart des femmes travaillent et qu'il y a relativement peu d'enfants et de vieillards, cela doit faire, disons, cinq cent mille voitures, les gens riches se mariant plutôt dans leur milieu et beaucoup de couples, même riches, se contentant d'un seul véhicule. Il faut y ajouter les taxis, les camions, les bus, qui sont très nombreux. Les camions tirent parfois d'immenses remarques, les bus sont souvent surdimensionnés.
Voilà pourquoi il n'y a pas d'autoroutes à Dibadi, se dit Vincent : il n'y en a pas vraiment besoin. Voilà aussi pourquoi il y a sans arrêt des embouteillages dans les quartiers centraux : tous les véhicules sont obligés de passer par un nombre relativement restreint de grands axes de circulation.
Après une heure de marche sous un ciel orageux Vincent arriva dans un quartier qu'il ne connaissait pas. Il repéra toutefois une station de métro, reconnaissable aux rampes jaunes de l'escalier qui menait vers le sous-sol. Le nom de la station, Pil-Emus, ce qui signifie la vache rouge, écrit au-dessus de l'entrée, ne lui disait rien. Il aurait au moins un changement à faire pour rentrer chez lui.
Avec ses immeubles de béton gris, ses petites boutiques, ses rues encombrées de voitures et la foule anonyme qui se pressait sur les trottoirs, le lieu aurait pu être situé n'importe où à Dibadi. Comme les autres, les gens n'avaient certainement que peu d'espoir d'améliorer leur sort, ils n'étaient motivés que par la peur de la clochardisation.
Dans le pidgin amérindien d'où le dibadien est issu, le mot "kwas" signifie à la fois "peur" et "domestiqué." Les cyborgs ont affiné la notion : quas signifie peur, et quasën, qui en est dérivé, signifie domestiqué, dressé. Mais le lien étymologique reste présent. Comme en français, se dit Vincent, qui avait lu quelque part, avant de venir à Dibadi, lorsqu'il était encore au lycée, que "mener" vient du latin "minari", menacer. Souvenir de l'époque lointaine où l'on "menait" les vaches à grands cris menaçants...
Evidemment, cette peur, permanente et omniprésente comme une musique d'ambiance, n'est que rarement mentionnée. On parlera plutôt d'éthique du travail (hanyet tlushgonin) et de civisme (hotilikëmnin). Il faut travailler pour mériter sa nourriture, c'est la base de la morale publique.
Si cela ne suffisait pas, les intelligences artificielles, dont l'emplacement est secret, cerveau collectif du grand corps de Dibadi, peuvent couper l'électricité, le téléphone ou l'eau à tout moment, dans un quartier donné ou sur toute la ville.
Dans ces conditions, la contrainte pure, exercée par la police, la milice et l'armée, n'est qu'un complément, la partie émergée de l'iceberg. La liquidation des clochards devient alors un acte responsable, et même indispensable, comme lorsqu'un garde-chasse abat un certain nombre de cerfs et de sangliers dans une forêt pour les empêcher de devenir trop nombreux et de ruiner l'environnement. Ce n'est pas de la cruauté, simplement la gestion normale, routinière, des ressources. De l'écologie appliquée.
Après avoir vainement cherché un banc pour s'asseoir, Vincent entra dans un café. Il ne savait trop s'il avait trouvé la vérité, ou s'il était parvenu à se convaincre que ce qui se passait au Sëkukyakha - et qu'il n'était pas censé savoir - était juste et nécessaire.
Il commanda une bière sucrée, une otlakhya. Allons, la vie était belle : les idiots et les malchanceux tombaient dans la trappe - le Sëkukyakha - pour que les autres, la majorité des autres, puissent manger à leur faim et vivre normalement. Et lui, Vincent Chafrichetaine, devenu Mantolo Haiakkhuch à Dibadi, il faisait partie des gagnants : il avait un travail stable et relativement bien payé, une femme, un logement, et de quoi se payer une otlakhya de temps en temps.
Une serveuse très maigre, aux traits marqués, vint lui apporter sa boisson. L'otlakhya était excellente : agréablement fraîche, assez sucrée pour être douce, mais sans que le sucré n'arrive tout à fait à dissimuler le goût piquant de l'alcool et l'amertume de l'herbe fermentée.
Dernière édition par Vilko le Sam 12 Juin 2010 - 12:16, édité 1 fois | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 12 Juin 2010 - 0:53 Sam 12 Juin 2010 - 0:53 | |
| Vilko, j'adore tes écrits, tu arrives à nous faire réfléchir avec tes textes tout en nous transportant dans un autre monde. |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 12 Juin 2010 - 12:18 Sam 12 Juin 2010 - 12:18 | |
| - Manildomin a écrit:
- Vilko, j'adore tes écrits, tu arrives à nous faire réfléchir avec tes textes tout en nous transportant dans un autre monde.
Merci !  Moi qui avais peur de choquer avec cette histoire... | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 21 Aoû 2010 - 14:02 Sam 21 Aoû 2010 - 14:02 | |
| Joie et bonheur ! Hier mon plus jeune fils m'a demandé d'écrire un nouvel épisode des aventures de Vincent. C'est fait  Quelques détails : les lumières qui clignotent la nuit dans le ciel de Dibadi sont mentionnées dans Épépé, mais le héros, Dubaï, n'en comprend pas la signification. Quand au capitaine Baltë, il est hélas inspiré d'un personnage réel...  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Un matin, vers la fin de l'été, le capitaine Baltë rassembla dans le gymnase de la caserne la centaine de miliciens qui constituait sa compagnie. Il avait, disait-il, "un message important" à leur transmettre. Vincent et ses collègues sortirent des chaises pliantes et des bancs d'un hangar adjacent et s'assirent dessus. Le gymnase servait souvent de salle de spectacle et de conférence. Le capitaine Baltë était grand, massif, rougeaud et moustachu. Malgré sa bedaine proéminente il avait fière allure dans son uniforme marron bien coupé. Lorsque tous les miliciens se furent assis, il prit la parole, un micro sans fil à la main : "Messieurs, je ne vous ai pas rassemblés seulement pour le plaisir de vous voir. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons devoir faire usage de nos armes pour défendre le Niémélaga, notre pays. Les renseignements obtenus par le gouvernement sont clairs : plusieurs millions de réfugiés de la faim s'apprêtent à passer notre frontière orientale. Certains disent qu'ils sont une dizaine de millions, voire davantage. Nous n'avons pas les moyens de les nourrir, d'autant plus que derrière eux il y a des centaines de millions de leurs congénères, tout aussi désespérés. Le ministère des Affaires Etrangères estime qu'il faudra peut-être faire face l'année prochaine à une deuxième vague qui compterait cent millions de personnes... Du jamais vu dans cette partie du continent. De plus, dans les pays d'origine des réfugiés la famine touche aussi les militaires et les policiers. Ils sont partis avec leurs armes, et souvent ils ont vendu les armes et les munitions qu'ils étaient censés garder dans des arsenaux. Un fusil-mitrailleur vaut un sac de blé, un pistolet automatique vaut une tablette de chocolat. Parmi les millions d'envahisseurs que nous attendons, plusieurs centaines de milliers sont armés. Nous devrons faire face à des gens qui auront des fusils de guerre, des pistolets et des grenades, et qui savent qu'ils devront nous marcher sur le corps pour trouver à manger." Le capitaine parlait une langue simple, à la prononciation rapide, le dibadien standard du Eikanem ye Tlatayetgo, auquel il ajoutait des termes techniques mais supposés connus de son public, avec de temps en temps un mot ou une expression du rude argot milicien. La plupart des miliciens parlent comme ça, au moins entre eux. Avec les non-miliciens ils évitent l'argot particulier et les termes techniques, qui permettent de deviner leur profession même lorsqu'ils ne portent pas l'uniforme. La plupart des Dibadiens détestent et méprisent les miliciens, et ces derniers ont appris à être discrets au milieu des civils. Vincent avait appris à la bibliothèque de la rue Sopinayet l'argot passe-partout des lycéens et des étudiants et c'était devenu sa façon préférée de parler à l'extérieur de la caserne. La langue dibadienne, conçue pour exprimer un maximum de concepts avec un minimum de mots différents, facilite la tâche des orateurs occasionnels comme le capitaine Baltë. L'expression "s'apprêtent à passer" se traduit très simplement en dibadien : dilet chaiki chako dihu, c'est-à-dire, littéralement "direct bientôt venir à travers". Vincent, qui écoutait religieusement ce que disait le capitaine, eut une pensée pour les centaines de traducteurs (ou bien était-ce une seule intelligence artificielle hyper-rapide ?) qui avaient fait de leur mieux pour traduire le plus simplement et clairement possible les expressions idiomatiques des langues naturelles. Il était bien connu que Baltë avait des problèmes pulmonaires. Après s'être arrêté pour retrouver son souffle, respirant lourdement et rouge comme une pivoine, il reprit son discours : "Le mal, dirais-je, est planétaire. Nous étions huit milliards d'êtres humains il y a encore cinquante ans. Depuis, la nourriture s'est faite rare. En fait, elle a commencé à manquer bien avant, lorsque la planète a atteint le chiffre de sept milliards d'habitants, il y a environ un siècle. Depuis un siècle, les pénuries deviennent des famines et les guerres ravagent la planète. Les cyborgs sont apparus dans un monde qui s'effondrait et ils ont fondé le Niémélaga, dont nous avons l'honneur et la chance d'être à la fois les citoyens et les défenseurs. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du dernier siècle, vous la connaissez tous, au moins dans ses grandes lignes. Des nations entières ont été massacrées, d'autres se sont constituées lorsque les survivants se sont regroupés et ont entrepris de rebâtir ce qui pouvait l'être. Nous les Dibadiens, nous faisons partie des nations qui sont nées des guerres des cent dernières années. Des dizaines de peuples ont disparu, quelques uns sont nés pendant les grandes turbulences. Comme disait un historien, lorsqu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, soit la natalité diminue soit la mortalité monte, et pour faire monter la mortalité il n'y pas trente-six méthodes. Il faut tuer. Nous les Dibadiens, nous sommes les descendants des vainqueurs. Les vaincus sont morts, où ont été assimilés par les vainqueurs. Dans le monde entier nous ne sommes plus que cinq milliards d'humains maintenant, à survivre sur une planète qui produit de moins en moins de nourriture chaque année. Il faudra descendre à moins de deux milliards et demi, paraît-il, pour retrouver un équilibre entre la population et les ressources. Je sais que, même maintenant, il y a encore des gens parmi nous qui se demandent comment une planète qui a pu nourrir huit milliards d'hommes il n'y a pas si longtemps n'arrive pas à en nourrir cinq. C'est pourtant évident. Pour produire de la nourriture, il faut de l'énergie. Sans énergie, pas de tracteurs pour labourer, pas de transports non plus. Pas d'électricité pour chauffer et éclairer les serres. Sans énergie, pas d'industrie pour fabriquer les tracteurs. Tout se tient, dans une société industrielle. C'est comme un moteur, si une courroie lâche, le moteur cale. Il se trouve que depuis un siècle, le pétrole, le charbon, et même l'uranium, s'épuisent. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, la géothermie, les remplacent de façon imparfaite. Cela veut dire moins d'engrais, moins d'énergie pour extraire l'eau du sous-sol ou pour dessaler l'eau de mer, moins de tracteurs pour labourer. Les transports coûtent plus cher, beaucoup plus cher qu'autrefois. La nourriture est devenue plus chère, trop chère, parfois elle manque et les pauvres meurent de faim. Et il y a des nations entières de pauvres, sur tous les continents. En fait, l'humanité, c'est quatre-vingt-dix pour cent de pauvres, même à Dibadi. Autrefois, il y a un siècle, il y avait des pays riches, où un pauvre, c'était quelqu'un qui n'avait pas de voiture. Les pauvres étaient minoritaires dans beaucoup de pays, c'est tout dire. Ce monde d'une richesse inouïe, que nous avons du mal à imaginer tellement notre réalité quotidienne est différente, a disparu et ne reviendra jamais. Il y a beaucoup de voitures dans nos rues à Dibadi, mais il y a au moins dix fois plus de piétons, qui se déplacent à pied et dans des transports en commun chroniquement bondés et inconfortables, parce qu'ils n'ont pas le choix. Oh, il y a bien une solution, c'est le yeksootch, cette substance mystérieuse, mi-gazeuse mi-liquide, qui permet de stocker l'énergie dans des batteries d'un poids très faible et de créer des cerveaux artificiels. Mais seuls les cyborgs connaissent la formule du yeksootch, et bien sûr ils veulent en garder le secret pour eux. Et les humains ne veulent pas être dominés par les cyborgs, ils préfèrent crever de faim. A Dibadi, nous mangeons à notre faim, à part les clochards, et nos appartements sont chauffés l'hiver et éclairés la nuit, parce que nous profitons de la technologie des cyborgs, basée sur le yeksootch. Dans les campagnes autour de Dibadi des robots, dont certains sont des humanoïdes, cultivent la terre et produisent tout ce dont nous avons besoin, et des champs de panneaux solaires captent la chaleur et la lumière pour la transformer en électricité. C'est pour cela, parce que le Niémélaga est un îlot de prospérité relative dans un monde à l'agonie, que nous devons faire face à cette invasion. Il y a des gens qui meurent de faim chez nous, mais ils sont une minorité. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ennuie avec toutes ces histoires... Ou plutôt, vous vous en doutez. Dix millions de crève-la-faim munis d'armes à feu vont nous envahir, et notre devoir est de les empêcher de piller nos zones agricoles et d'arriver jusqu'à Dibadi." Baltë s'était tu. On aurait entendu une mouche voler. Les miliciens étaient silencieux et graves, comme des soldats dans les moments qui précèdent une bataille, lorsqu'on attend l'ordre de monter à l'assaut. Un sergent se leva pour faire une remarque : "Le Niémélaga est un protectorat du Padzaland. C'est aux Padzalandais d'assurer notre défense !" Baltë secoua la tête : "Les Padzalandais comptent sur nous pour empêcher les réfugiés d'arriver jusque chez eux, mais ils ne feront rien pour les cyborgs, qu'ils craignent et détestent, et ils ont bien raison. Le Niémélaga a une petite armée, composée de cyborgs en uniforme blanc. Elle est censée être suffisante pour assurer la défense du pays, mais les Padzalandais ont été féroces dans les négociations qui ont conduit les cyborgs à accepter de passer sous leur protectorat, il y a une cinquantaine d'années. L'armée niémélagane officielle est minuscule. C'était ça, ou mener une guerre perdue d'avance contre le monde entier." Le sergent ricana : "Les cyborgs ont appris aux robots à tirer au fusil, et il y a des millions de robots dans les campagnes." "Je sais, et je vais même vous montrer quelque chose qui n'entre pas dans les effectifs militaires." A ce moment-là, Vincent ne put s'empêcher de se lever et de dire ce qu'il pensait : "Est-ce que ces réfugiés, même s'il en vient dix millions, ou cent millions, sont des ennemis ? Vous l'avez dit vous-même, ce sont des gens qui ont faim. On ne va quand même pas leur tirer dessus ! Ce sont nos frères humains !" Le visage du capitaine tourna au rouge brique. Les mots jaillirent de sa bouche, rapides et méchants comme des petits serpents blancs : "Haiakkhuch, vous avez raté votre vocation, vous auriez dû devenir prêtre, et passer vos journées à prier les dieux. Vous êtes un drôle de milicien. Ces gens-là vont bousculer nos garde-frontières et voler notre nourriture. Il faudra leur faire de la place dans nos maisons, s'ils arrivent jusqu'ici. Ils vont couler le bateau, et nous avec. Nous sommes en état de légitime défense. S'ils viennent jusqu'ici, à Dibadi, c'est la famine pour nous tous... Tlët..." Baltë semblait faire un effort énorme pour garder son sang-froid et ne pas se mettre en colère. Lorsque ça lui arrivait, il perdait toute mesure et devenait violent et grossier envers ses subordonnés. De plus, sa méchanceté était proverbiale. Les mains tremblantes, il fit un geste saccadé du bras pour inviter Vincent à se rasseoir "Bon, j'en viens au deuxième point de mon discours" dit-il d'une voix lasse et hargneuse. Il sortit d'une sacoche posée à côté de lui un modèle réduit d'avion, d'une trentaine de centimètres de long, peint en bleu terne. "Ceci, messieurs, est peut-être ce qui va nous sauver. Un micro-avion robot. Vingt-neuf centimètres de long, quarante centimètres de large. Ses hélices fonctionnent grâce à des batteries au yeksootch, il peut rester en l'air pendant des semaines. Il est armé d'un micro-canon à balles perforantes, avec un chargeur de quinze cartouches." Baltë fit tourner le micro-avion à bout de bras au-dessus de sa tête. "Les balles perforantes, si elles sont tirées à courte distance par le micro-avion, peuvent trouer un casque ou un gilet pare-balle. En traversant le corps humain elles créent des hémorragies internes, et l'agonie peut être longue. Le micro-avion a un minuscule cerveau de yeksootch qui lui donne l'intelligence d'un chien d'attaque. Il perçoit l'infrarouge, il peut donc repérer un corps humain la nuit ou sous les feuillages. Il communique par radio, dans un code spécial. Si les communications radio sont brouillées, il peut faire clignoter ses lumières en code Morse." "Qui contrôle les micro-avions ?" demanda quelqu'un. "Des intelligences artificielles. Les micro-avions opèrent en essaim. Chaque essaim est contrôlé à distance par un kusapish, un dirigeable d'environ deux mètres de long qui contient un cerveau de yeksootch. Les micro-avions participent aussi à notre défense anti-aérienne, ils peuvent détruire un avion ou un hélicoptère en se précipitant contre lui. Les kusapishda communiquent avec les micro-avions par radio, mais aussi en faisant clignoter leurs lumières." Vincent se souvint des lumières qu'il voyait la nuit au-dessus de Dibadi, des lumières blanches, rouges, et de couleurs plus incertaines, haut dans le ciel. Parfois, les lumières clignotaient, parfois elles étaient fixes. Au bout d'un moment, elles se déplaçaient dans le ciel, lentement ou à grande vitesse. C'étaient des kusapishda, presque invisibles le jour avec leurs faibles dimensions et leur couleur gris-bleu. Baltë regardait avec satisfaction le micro-avion qu'il tenait devant lui : "Nous sommes en train de produire des millions de ces beautés, dans des usines secrètes à la campagne. Ensuite, il sera temps de renégocier le protectorat..." En ayant l'air de s'arracher d'un rêve, il ajouta : "Les micro-avions et les robots n'interviennent qu'à plus d'un kilomètre des frontières et des grandes routes. On considère que si les gens s'en éloignent de plus d'un kilomètre, ils ont montré leurs mauvaises intentions. A moins d'un kilomètre autour des frontières et des routes, c'est l'armée qui contrôle le pays. Ailleurs, ce sont les kusapishda, les klelwaks, les robots. Et à Dibadi, c'est nous, les miliciens, et c'est là que nous intervenons. Dès la semaine prochaine nous devrons arrêter et remettre à l'armée les étrangers qui essayeront d'entrer illégalement dans Dibadi. Vous patrouillerez à la périphérie de la ville, là où la banlieue se transforme en zone agricole. Je ne sais pas ce que l'armée fera des gens que nous arrêterons. Il est prévu de les interner dans des camps loin de Dibadi. Les petits hommes verts de la campagne, les klelwaks comme on les appelle, se chargeront de les garder. Mais j'ai assez parlé. La semaine prochaine nous aurons beaucoup de travail, et en attendant je vous offre à tous un café. J'ai demandé que les cuisiniers nous en apportent." Trois cantinières en tablier blanc étaient debout dans un coin du gymnase, à côté d'une table à roulettes sur laquelle trônait un cylindre de métal muni d'un robinet. Les miliciens firent la queue pour recevoir chacun une tasse de café synthétique dibadien, si chargé en produits chimiques qu'il est inutile de le sucrer. Vincent se retrouva en train de boire un café tiède au goût bizarre. Il fut surpris de voir le capitaine se diriger vers lui et lui parler d'une voix faussement amicale : "Dites donc, Haiakkhuch, qu'est-ce qui vous a pris tout à l'heure ? Vous n'êtes pas comme ça d'habitude. Expliquez-moi ce qui se passe dans votre tête." Vincent s'était aperçu depuis longtemps que Baltë était un triste sire, odieux envers ses subordonnés et lâche devant ses supérieurs, et il n'aimait pas trop lui parler. "Mon capitaine, il y aura des femmes et des enfants parmi les réfugiés. Et dix millions de personnes, ça fait beaucoup." "Ah, c'est donc ça. Ne vous inquiétez pas. Les klelwaks enterreront les cadavres. Attention, je parle des cadavres des réfugiés qui seront tués dans les affrontements, pas des réfugiés qui seront internés dans des camps, où bien sûr on essaiera de les nourrir. Je ne sais pas en fait ce qui a été prévu pour les camps, et franchement je préfère ne pas le savoir, mais pour les cadavres de ceux qui seront tués dans les combats, les cyborgs ont pensé à tout. Les vêtements seront récupérés, ce qui peut être réutilisé sera nettoyé, on a trouvé un usage même pour les cheveux. On fera du feutre industriel avec. On peut faire beaucoup de choses avec du feutre. Avec un peu de chance on récupérera aussi des armes pour les klelwaks et des objets qu'il sera possible de vendre à Dibadi." "Qui va s'enrichir en faisant ce commerce, mon capitaine ?" "Des sociétés qui appartiennent à des cyborgs. Le marché des vêtements et des chaussures d'occasion est important à Dibadi. Mais la milice sera prioritaire pour les achats en gros, c'est sympa, non ? La viande... je veux dire la chair des défunts, sera mélangée à des graines et à des légumes pour nourrir les cochons. Ça fera baisser le prix de la viande de porc, une bonne nouvelle pour nos enfants qui ont besoin de protéines. Si les klelwaks travaillent aussi bien que prévu il ne restera que les os des cadavres. Ils les casseront en petits morceaux avant de les enterrer dans le sol. Les os, c'est plein de sels minéraux, et les sels minéraux, c'est bon pour les récoltes." "Je vois, mon capitaine, qu'une catastrophe humanitaire peut aussi être une opportunité." "Oui bien sûr, il suffit de réfléchir et de se préparer. Il faut avouer que les cyborgs sont très forts pour ça. Ils pensent à tout. Les Padzalandais sont terrifiés à l'idée d'être envahis par les crève-la-faim. Ils vont nous laisser gérer le problème, en pleurnichant en public sur la dureté de notre époque. Quand ils verront comment nous gérons le problème, ils vont avoir encore plus peur et ils vont étudier sérieusement une option militaire contre nous. Mais il sera trop tard, nous sommes déjà les plus forts, mais ils ne le savent pas encore. Le protectorat sera renégocié." "Renégocié ?" "D'après mes sources, nos dirigeants veulent rester sous protectorat padzalandais pour éviter le risque d'avoir le monde coalisé contre eux, comme il y a cinquante ans. Mais ils feront en sorte que le traité soit une coquille vide." "Eh bien, on peut dire que nous vivons une époque historique. On pourrait même presque dire que nous avons de la chance" dit Vincent pour clore la conversation. | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 22 Aoû 2010 - 15:55 Dim 22 Aoû 2010 - 15:55 | |
| C'est la guerre à Dibadi... Comme toutes les guerres, son déroulement est imprévisible.
-------------------------------
Le lundi suivant, avant l'aube, Vincent se retrouva dans un fourgon, avec une dizaine d'autres miliciens, en train de garder une route au sud-est de Dibadi. La route à deux voies s'étendait dans le lointain, à travers un paysage silencieux, qui se révéla à Vincent dans sa tranquille beauté verdoyante lorsque le soleil se leva.
Le sol était peu fertile à cet endroit, et le terrain était constitué de prés où paissaient des moutons gardés par des bergers silencieux, vêtus de longs manteaux sombres et coiffés de grands chapeaux qui dissimulaient leur visage. Par endroit, des arbres rabougris coiffaient des collines aux formes irrégulières. Vincent se souvint d'avoir lu qu'autour de Dibadi ce genre de collines était généralement constitué d'amoncellements de débris, voire de cadavres. L'héritage des guerres du siècle passé, se dit-il avec philosophie.
Les limites de la ville étaient marquées par une haie d'arbustes, dense et infranchissable, de trois mètres de haut et dont la largeur variait de trois à cinq mètres, suivant les endroits. La haie s'étendait à perte de vue, et Vincent supposa qu'elle jouait le rôle d'une muraille isolant la ville et la campagne.
Vincent identifia les arbustes comme étant des pyracanthas. C'était la première fois qu'il en voyait depuis qu'il vivait à Dibadi. Les pyracanthas portent de jolis fruits rouges, malheureusement toxiques, et sont hérissés d'épines. En s'approchant de la haie, Vincent vit qu'elle était envahie de pucerons. Par endroit des traces noires sur le sol révélaient d'anciennes combustions. Tous les cinquante mètres environ, la haie était coupée perpendiculairement par un mur de cinq mètres de haut, apparemment destiné à empêcher la propagation des incendies, accidentels ou volontaires.
La haie n'était qu'une muraille symbolique. Il était certainement possible de la franchir en moins d'une heure en creusant un tunnel végétal avec un sécateur ou une machette, mais il fallait être sûr de ne pas se faire repérer. Difficile, avec les kusapishda qui flottaient dans le ciel et dont Vincent avait remarqué pendant la nuit les clignotements colorés.
Vers huit heures du matin une camionnette apporta le petit déjeuner, à la grande joie des miliciens. Le café, très chaud, les ragaillardit et les petits pains leur remplirent agréablement l'estomac. Un tonneau d'aluminium contenait de l'eau potable _ quoquayet chëk _ vu l'inscription peinte dessus. Vincent but un verre d'eau jaunâtre. Dans la milice, il ne faut pas faire le délicat ni se poser trop de questions.
Il y avait peu de circulation sur la route, seulement des camions, presque tous surdimensionnés, qui amenaient dans la ville les produits de la campagne et de l'étranger et repartaient à vide. La ville de Dibadi consomme beaucoup mais ne produit que pour elle-même. Tout ce qui est exporté du Niémélaga vers l'étranger provient des fermes et des usines rurales, où ne travaillent que des robots et des cyborgs.
À mesure que le soleil montait dans le ciel, l'ennui devint insupportable. Les conversations roulaient sur la possibilité d'une invasion, qui paraissait bien invraisemblable dans un endroit aussi paisible.
Vincent emprunta une paire de jumelles à l'adjudant Chim et scruta les alentours. L'un des bergers qu'il avait vus le matin était toujours là, gardant ses moutons, debout, appuyé sur un long bâton, le chapeau à larges bords baissé sur les yeux. Un moment il releva la tête, et Vincent tressaillit : l'homme avait le visage verdâtre, presque pas de nez ni de lèvres, et deux ovoïdes noirs à la place des yeux. Un klelwak... C'était la première fois que Vincent en voyait un.
"Le berger, c'est un klelwak" dit Vincent à l'adjudant.
"Ça ne m'étonne pas" répondit Chim. "Non, vraiment pas. Si on allait lui parler ?"
"C'est peut-être dangereux."
Chim toisa d'un air ironique son jeune subordonné :
"Nous sommes des miliciens, et en plus, armés."
"Alors allons-y."
Ils marchèrent en direction du berger, qui était à environ cinq cent mètres d'eux et ne bougeait pas. Lorsqu'ils arrivèrent près de lui, ils virent qu'il était très grand, plus de deux mètres, avec une tête assez grosse par rapport à sa taille. Son manteau en peau de chèvre exhalait une odeur de vieux cuir mouillé.
"Patlisztada, tlelwak" dit Vincent.
"Patlisztada répondit courtoisement le berger, d'une voix grave, un peu nasillarde.
Vincent ne savait pas quoi dire, Chim non plus, et ce fut le berger qui leur parla :
"Chetencheda, j'ai du travail. Il serait bon que vous retourniez à vos postes. Vous allez recevoir un appel radio qui va vous rappeler vos instructions, qui sont de garder la route, et rien d'autre. Il ne fait pas partie de vos attributions, notamment, de perturber le travail des ouvriers agricoles."
La bouche du klelwak s'ouvrait et se refermait au rythme de ses paroles, mais il était visible qu'il n'articulait pas. Sa voix provenait sans doute d'un appareil électronique caché dans sa cavité buccale. En fait, c'était rassurant : le klelwak était un robot, pas un extraterrestre.
"Comment sait-il tout ça ? Il est en contact avec une intelligence artificielle !" rugit Chim. "Allons-nous-en !"
Ils retournèrent au fourgon aussi vite qu'ils le pouvaient sans avoir l'air de fuir.
Ils ne reçurent aucun appel radio.
Une demi-heure plus tard, la relève arriva. Vincent et ses collègues repartirent dans le fourgon vers leur caserne, située dans le centre-ville. La haie de pyracantha était interrompue par une usine composée de quelques bâtiments entourés d'un mur de pierre et d'une très grande cour. Le fourgon entra par un portail, qui s'ouvrit automatiquement à leur approche, et sortit côté ville par un autre portail, qui s'ouvrit après qu'un employé en uniforme bleu eut brièvement discuté avec le chauffeur.
Lorsque le fourgon avait traversé l'usine dans l'autre sens pendant la nuit, Vincent n'avait pas remarqué les camions garés dans la cour, ni les allées et venues des chauffeurs. Apparemment, les chauffeurs qui conduisaient les camions à la campagne ne pouvaient pas les conduire dans la ville et vice-versa. Cela pouvait vouloir dire que les chauffeurs qui étaient autorisés à traverser la campagne étaient des cyborgs, mais ce n'était qu'une supposition de sa part.
Dans l'après-midi, après être rentré à la caserne, Vincent sortit en ville pour acheter un journal, qu'il décida d'aller lire tranquillement dans un café.
Il fut surpris d'apprendre que l'invasion avait commencé la veille. L'article citait un communiqué du Premier Ministre, qui indiquait que plusieurs centaines de milliers d'étrangers étaient entrés de force et sans visas sur le territoire, commettant des dégradations (muwimyezda) dans des exploitations agricoles, ce qui avait entraîné des heurts avec les forces locales de défense. L'article n'en disait pas plus et se perdait dans des hypothèses sur l'ampleur réelle des dégradations, sur le sens du mot qualëkhyezda (heurts) et sur l'éventualité de nouvelles intrusions.
Le soir même, Vincent apprit qu'il ne retournerait pas garder la route du sud-est : le haut commandement de la milice avait décidé qu'il était plus utile de veiller à ce que la population garde son calme que de garder une route déserte.
Plusieurs semaines passèrent, et Vincent, fasciné, suivit en direct le changement de ton des articles : les journalistes recopiaient toujours mot pour mot les communiqués du gouvernement, qui parlaient toujours de muwimyezda et de qualëkhyezda et déploraient le chaos qui régnait à la frontière sud-est. Mais ils citaient aussi la presse padzalandaise, qui parlait de massacres. Une carte, notamment, horrifiait et fascinait Vincent : on y voyait le Niémélaga, avec Dibadi en position vaguement centrale, et une grosse tache grise qui recouvrait tout le sud-est, avec ce commentaire :
"Cette tache grise sur la carte, c'est la zone où sont venues mourir deux millions de personnes, mitraillées sans relâche par les micro-avions des Niémélagans, égorgées sans pitié par les humanoïdes à la peau verte lorsqu'elles sont blessées ou trop épuisées pour se défendre. Là où les micro-avions ne vont pas, près de la frontière, trois millions de personnes sont en train de mourir de faim dans des camps de fortune. Le gouvernement padzalandais s'est déclaré conscient de ses responsabilités et projette d'envoyer une force d'intervention dans le cadre du protectorat. Le Premier Ministre niémélagan s'est opposé à cette mesure et demande une renégociation du traité."
À la caserne, le capitaine Baltë semblait particulièrement bien renseigné sur les réalités des combats et il ne se faisait pas prier pour raconter ce qu'il savait :
"Soixante-quinze mille micro-avions, c'est pas suffisant pour stopper trois millions de personnes. Les micro-avions ont un tir très imprécis, ils peuvent disperser un groupe compact, mais il leur faut du temps pour tuer un individu isolé au milieu des arbres. Beaucoup d'envahisseurs ont des fusils et ils tirent nos micro-avions comme les chasseurs tirent les perdreaux. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que nous en avons perdu plusieurs centaines."
Il fit la grimace et reprit son récit :
"Les micro-avions agissent plutôt la nuit, leur vision infrarouge leur permet de repérer les humains endormis sous des couvertures et de leur tirer dessus à courte distance. Des micro-avions porteurs de grenades sont en train d'être fabriqués, mais il faudra plusieurs semaines pour qu'ils soient opérationnels. On a aussi de bons résultats avec les snipers klelwaks embusqués. En attendant, les cadavres des envahisseurs pourrissent dans la nature et les rats prolifèrent. Un huitième du pays est envahi par des étrangers armés, les stocks de grain et de légumes sont pillés, le bétail et la volaille sont dévorés sur place. Bref, un huitième de notre production agricole est perdu. Il faudra se serrer la ceinture."
Il ajouta en hochant la tête :
"Lorsqu'ils seront prêts, les micro-avions largueurs de grenades attaqueront les camps situés près de la frontière. Ce sera peut-être suffisant pour dissuader les réfugiés de passer, je l'espère mais je n'en sais rien. En mettant les choses au pire, d'après le haut commandement, les réfugiés pourraient envahir tout le quart sud-est. Pas plus, parce que des gens qui n'ont rien à manger ne peuvent pas marcher longtemps. Les klelwaks et l'armée défendront les stocks de vivres jusqu'à la mort. Les réserves qui ne peuvent pas être défendues sont brûlées, le bétail abattu. Ceci étant, si cet hiver les Dibadiens doivent se passer d'un quart de la nourriture qu'ils consomment habituellement, il faudra s'attendre à des émeutes, et la milice sera en première ligne. Il ne faut pas se leurrer, il y aura de la casse."
La guerre occupait les esprits et les conversations. Diletyet était particulièrement angoissée. Dans son enfance et son adolescence elle avait vu son pays dévasté, des gens tués dans les rues, des atrocités sans nombre qu'elle ne voulait même pas décrire. Elle n'avait plus d'appétit et dormait mal.
Vincent était inquiet, comme tout le monde, mais il était aussi excité par l'idée d'aller au combat.
À l'autre extrémité du pays, au nord-ouest, la situation se dégradait aussi, même si aucun coup de feu n'avait encore été tiré. Le Padzaland avait rappelé ses réservistes. L'idée dominante, là-bas, était qu'il fallait profiter des difficultés présentes des cyborgs pour les éliminer une fois pour toutes. Mais les prudents dirigeants padzalandais attendaient de voir dans quel sens le vent allait tourner. La prospérité padzalandaise dépendait largement du tribut, en électricité et en produits alimentaires, que payait le Niémélaga, et ils le savaient.
Un matin, une cinquantaine de jeunes hommes se présentèrent devant la caserne. Vu leurs vêtements bon marché, c'étaient des ouvriers, la fraction de la population réputée la plus hostile à la milice.
"Le pays est en danger, nous sommes volontaires pour aller nous battre" dit l'un d'eux.
Mis au courant, le colonel en personne sortit de la caserne pour les rencontrer, accompagné d'une demi-douzaine de miliciens qu'il trouva sur son chemin, et dont Vincent et l'adjudant Chim faisaient partie.
"Mes amis" dit le colonel aux volontaires. "Quelle joie de voir que le patriotisme existe à Dibadi. Qui l'aurait cru... Je n'ai rien à vous proposer, si ce n'est de me donner vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. On fera appel à vous lorsque nous aurons des uniformes et des armes pour vous. Pour l'instant on n'a rien. Je..."
Sa voix se brisa, et Vincent vit qu'il avait les larmes aux yeux.
À sa grande surprise, Vincent aussi se sentit les yeux humides. C'était donc ça, la guerre ? Une formidable fraternité entre les hommes, mais dont l'objectif est la mort et la destruction ?
Le colonel sortit un calepin de sa poche et commença à noter le nom et l'adresse de chaque volontaire. Ensuite, il leur serra la main à tous.
"Je peux leur donner un rudiment d'instruction militaire tous les dimanches, mon colonel" dit l'adjudant Chim.
"Moi aussi" s'entendit dire Vincent, un peu inquiet quand même en pensant à la réaction de Diletyet lorsqu'il lui annoncerait la nouvelle.
C'est ainsi que la guerre commença pour Vincent. | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 22 Aoû 2010 - 16:26 Dim 22 Aoû 2010 - 16:26 | |
| - Citation :
- Joie et bonheur ! Hier mon plus jeune fils m'a demandé d'écrire un nouvel épisode des aventures de Vincent. C'est fait Very Happy
je le comprends, moi j'adore ce que tu as écrit jusqu'à présent. - Spoiler:
Je sens que les ouvriers vont trahir les miliciens.
|
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 22 Aoû 2010 - 17:23 Dim 22 Aoû 2010 - 17:23 | |
| - Manildomin a écrit:
- Spoiler:
Je sens que les ouvriers vont trahir les miliciens.
- Spoiler:
C'est pas sûr. Je suis en train d'écrire la suite...
| |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 22 Aoû 2010 - 19:02 Dim 22 Aoû 2010 - 19:02 | |
| - Spoiler:
Ah, si ça se trouve, j''ai influencé ton scénario !
 J'ai beaucoup apprécié ce que tu as écrit, et j'attends la suite avec impatience. |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 26 Sep 2010 - 21:37 Dim 26 Sep 2010 - 21:37 | |
| Vincent et l'adjudant Chim se retrouvèrent seuls pour donner quelques heures d'entraînement militaire tous les dimanches à la cinquantaine de volontaires, dont le nombre descendit rapidement à trente. Certains de ceux qui quittèrent le groupe n'étaient pas préparés à accepter la stricte discipline de la milice, d'autres n'étaient pas en assez bonne condition physique.
L'entraînement comprenait de la gymnastique, de longues marches vers la banlieue et retour, avec un sac de dix kilos sur le dos, et quelques cours pratiques : reconnaître les grades, saluer, marcher au pas, s'orienter avec un plan et une boussole, et l'essentiel du règlement de la milice. Au bout d'un mois, le colonel accepta que les volontaires, baptisés "adjoints-miliciens" apprennent à tirer au fusil. Encore s'agissait-il de vieilles pétoires sorties de l'armurerie.
Les nouvelles du front étaient toujours les mêmes : la famine qui était en train de dépeupler tout le sud-est du continent continuait d'envoyer des populations entières de réfugiés et des pillards au Niémélaga, et les cyborgs en tuaient autant qu'ils le pouvaient. Il n'y avait pas de front au sens militaire du terme, juste une zone, qui couvrait maintenant entre un sixième et un septième du pays, où erraient des groupes d'humains en haillons, souvent armés et toujours dangereux, vivant de ce qu'ils pouvaient voler dans les champs, les vergers et les élevages. Cette "zone rouge" (pil hi) ne produisait presque plus rien, même les panneaux solaires étaient détruits par les pillards.
"Tout va bien, tout va bien" disait le capitaine Baltë en se frottant les mains. "Nous fabriquons plus de klelwaks et de micro-avions qu'ils n'en détruisent, et nos usines d'armements tournent à plein. Évidemment, il ne reste plus grand chose pour les civils, la guerre accapare toute la production industrielle, c'est pourquoi les temps sont durs à Dibadi, mais c'est juste un mauvais moment à passer."
Vers le milieu de l'automne, Vincent et l'adjudant Chim furent convoqués chez le colonel. Il n'était pas seul dans son bureau. Un homme très grand et maigre, d'une quarantaine d'années, les cheveux bruns coupés courts et le visage marqué de rides profondes, se tenait debout à côté de lui, les mains dans les poches de son manteau marron de milicien. L'inconnu avait des galons de commandant sur ses épaulettes et sur sa casquette, qu'il avait gardée sur sa tête.
Le colonel, debout au milieu de la pièce, leur dit tout de go : "Messieurs, je vous présente le commandant Quamis Mindi. J'ai décidé, en accord avec le haut-commandement, de faire de nos trente volontaires une section de combat. Les volontaires, qui sont toujours adjoints-miliciens, sont embauchés à temps plein par la milice, à compter de ce jour. Ils seront envoyés, dès la semaine prochaine, pour six mois dans la zone rouge, jusqu'au printemps. Si leur comportement donne satisfaction ils seront intégrés comme miliciens. En attendant, ils restent sous votre autorité, adjudant Albët Chim. Vous êtes promu sous-lieutenant à compter de cet instant, le haut-commandement a donné son accord. Vous, milicien Mantolo Haiakkhuch, vous êtes promu sergent. C'est sympa, non ? Vous passerez cet après-midi tous les deux au secrétariat pour signer les documents. Les six meilleurs volontaires de votre unité sont nommés caporaux. Nous allons leur annoncer la bonne nouvelle tout à l'heure, lorsque la section sera rassemblée."
Sergent ! Vincent n'en revenait pas. Il fallait normalement des années pour atteindre ce grade, dans la milice. Et lui, il avait simplement passé une dizaine de dimanches à travailler. Bien sûr, il y avait les six mois pendant lesquels il serait dans la zone rouge, mais apparemment le risque d'être tué ou blessé serait faible pour son unité, après tout il s'agissait d'une sorte de stage de perfectionnement, le rôle des miliciens était de seconder la police dans la ville, pas d'épauler les militaires à la campagne.
Chim était tout aussi surpris et heureux que Vincent de sa promotion inattendue. Il se tenait tout droit, un sourire béat sur le visage.
Le commandant Mindi prit la parole :
"Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Quamis Mindi. J'ai cinq d'unités semblables à la vôtre sous mon commandement. Au total, un bataillon de 197 hommes, y compris votre section, que j'appelle la section Chim. À terme, j'aurai plusieurs milliers d'hommes avec moi, si la guerre se prolonge. Je ne sais pas s'il y aura autant de volontaires, mais nous avons déjà des plans pour recruter dans les prisons et les refuges pour clochards. J'en ferai des guerriers. Cette guerre est une opportunité et nous ne la laisserons pas passer. Mais je suis venu ici pour une raison précise. Vous êtes des cadres de la milice, je vais donc vous expliquer, rapidement, quel sera notre travail."
Vincent se mordit la langue pour ne pas sourire. "Mindi" signifie jeton métallique en dibadien. Un drôle de nom. Min-di : littéralement, métal-rondelle. Di se trouve dans de nombreux mots composés, comme daladi, pièce de monnaie, et quolandi, lobe d'oreille. Quamis est un prénom dibadien banal.
Cela rappela à Vincent un rêve qu'il avait fait récemment. Deux rondelles grisâtres luisaient dans l'obscurité totale, et il entendait des bruits étranges et inquiétants, comme si des objets métalliques s'entrechoquaient derrière des rideaux. Un sentiment d'angoisse insupportable l'avait étreint et il s'était réveillé.
Plus tard, il avait compris le sens de son rêve. Le mot ba signifie "rien" en dibadien. Il est plutôt moins fréquent que son synonyme haluszta, mais on le trouve dans des phrases courantes comme nai chi mung ba, "je n'ai rien fait". Dibadi, c'est di-ba-di, rondelle-rien-rondelle. C'est un hasard, bien sûr, l'étymologie de "Dibadi" est inconnue, le nom provient de la langue des anciens habitants de la région. Dans son rêve, Vincent avait vu deux rondelles séparées par du vide, et il avait ressenti de l'angoisse. Un message de son inconscient, peut-être, lui révélant ses véritables sentiments.
Il fut tiré de ses rêveries par la voix perçante du commandant :
"Ces volontaires sont des patriotes. C'est bien. Mais politiquement, ils ne sont pas fiables. Après la guerre ils retourneront dans leurs usines et dans leurs appartements délabrés, et on les retrouvera contre nous pendant les grèves et les émeutes. Avec cette différence qu'ils sauront faire la guerre. Ça ne se fera pas, c'est trop dangereux pour le Niémélaga. Mon travail, et le vôtre, Chim et Haiakkhuch, consistera à en faire de vrais miliciens, et pas des ouvriers en uniforme. Nous ferons le nécessaire pour qu'ils restent des miliciens après la guerre."
Quamis Mindi regarda Chim et Vincent droit dans les yeux : "Le colonel Kaiushtayi vous a parlé d'un séjour de six mois en zone rouge. Il a eu raison. Mais si la guerre n'est pas finie d'ici là, le séjour en zone rouge deviendra permanent, et le recrutement des volontaires sera intensifié. Mon bataillon deviendra un régiment, et s'il le faut une brigade. Vous ne serez pas oubliés, messieurs, vous monterez en grade beaucoup plus vite que les miliciens qui resteront à Dibadi."
Chim leva timidement la main :
"Et quand la guerre sera finie, mon commandant ? Est-ce que nous rentrerons tous chez nous ?"
Quamis Mindi ricana : "En ce qui me concerne, lieutenant, j'aimerais bien vous faire plaisir. Mais lorsque nous aurons vidé les prisons, ce ne sera pas pour les remplir de nouveau avec les mêmes. Ils seront encore plus dangereux qu'avant, parce que nous leur aurons appris à tuer. Non Messieurs. Après la guerre, nous resterons mobilisés. Nous serons stationnés en permanence sur la frontière, pour la sécuriser."
Le commandant ricana en voyant le visage dépité de Chim et Vincent. Il leur dit d'une voix joyeuse :
"Je vois que vous faites la grimace. Alors, voila la bonne nouvelle... Nous vivrons comme des seigneurs. Nous aurons des femmes, autant de femmes que nous pourrons en capturer, et nous serons riches. Mais ceci, je vous le dis à vous en tant que cadres de mon bataillon. Laissez vos hommes penser ce qu'ils veulent. Ce que je viens de vous dire n'est pas un secret, mais je ne veux pas que vos hommes pensent qu'ils ne rentreront jamais chez eux. Tout le monde ne restera pas mobilisé, voila ce qu'il faut dire. Et d'ailleurs, c'est la vérité."
Vincent et Chim quittèrent le bureau du colonel la gorge serrée, malgré leur promotion, car ils venaient d'apprendre que pour eux la guerre ne finirait jamais. Désormais, ils étaient sous les ordres de Quamis Mindi, pour le meilleur et pour le pire.
Diletyet prit très mal la nouvelle du départ de Vincent, et il crut un moment que leur liaison était terminée, mais elle finit par sécher ses larmes et elle sembla se faire une raison.
La semaine suivante, un autobus loué par la milice emmena la section Chim du bataillon Mindi vers la zone rouge. Le trajet fut long, toute une journée. Vincent et Chim, assis côte à côte, n'étaient pas pressés d'arriver : plus Dibadi était loin de la zone rouge, mieux c'était.
À la nuit tombante, ils arrivèrent dans un village agricole. Avant de repartir le chauffeur leur dit qu'ils étaient à Tosztihi.
Deux klelwaks de deux mètres de haut, longilignes et vêtus de pantalons et vestes de toile verte, la tête nue, les accueillirent dans une cour de ferme. L'un des klelwaks, qui portait des galons de lieutenant, se présenta sous le nom de Mohawequaï.
Chim et ses hommes déposèrent leurs paquetages dans deux granges que Mohawequaï leur attribua comme campement.
"Pour ne pas avoir froid la nuit il vaut mieux monter les tentes, même à l'intérieur des granges" dit Mohawequaï. "Je tiens aussi à ce qu'on dépose les armes à l'armurerie. Je vous y conduirai."
Le premier repas à Tosztihi des hommes de la section Chim fut constitué de viande de porc froide et de fruits secs, préparés par des klelwaks. L'eau qui accompagnait le repas avait le même goût douceâtre, chimique, qu'à Dibadi.
Le lendemain matin, après une nuit tranquille, Chim et sa brigade prirent dans un hangar hâtivement transformé en réfectoire un petit-déjeuner composé d'ersatz de café à base de chicorée et de plantes sauvages, que Vincent trouva bien meilleur que le café chimique dibadien, et de tranches de pommes de terre tièdes. Inhabituel, mais nourrissant.
Il y avait des klelwaks partout, des peaux-vertes dont la taille variait d'un mètre vingt à deux mètres, tous vêtus de vert, certains armés de pistolets et de fusils, d'autres pas, vaquant en silence à leurs occupations.
"Je n'avais jamais vu de klelwaks avant hier soir" dit Akohi, le plus jeune des adjoints-miliciens, qui avait tout juste dix-sept ans. "Et les copains non plus."
"Bien sûr" répondit Vincent. "Le sous-lieutenant et moi, on n'en avait vu qu'un, et c'était il y a deux mois."
"Vous croyez que ce sont des démons ?"
"Non. Seulement des robots, connectés par radio à un cerveau artificiel de grande puissance, qui peut gérer un millier d'entre eux à la fois. C'est ce que j'ai lu."
Akohi parut satisfait de la réponse.
Le commandant Mindi passa les voir en fin de matinée, accompagné de son chauffeur, et leur tint un petit discours dans la cour de la ferme, en présence du lieutenant Mohawequaï :
"Chetencheda, nous sommes en guerre. Le travail commence donc tout de suite. Nous sommes des gens civilisés, nous respectons le droit de la guerre. Les envahisseurs capturés les armes à la main ne sont pas des soldats, ce sont des francs-tireurs, voire même de simples brigands. C'est ce que dit le droit de la guerre. Il est donc légitime de les exécuter immédiatement. Toutes les armées le font, dans tous les pays. Et vous allez le faire, ici à Tosztihi, parce que c'est votre devoir."
Il y eut des murmures parmi les volontaires, mais Mindi ne se laissa pas impressionner :
"J'ai cru entendre quelque chose... On en discutera tout à l'heure, pendant le repas. Bon, je continue... Pendant les combats, l'immigration continue à Dibadi. La plupart des candidats à l'immigration sont des hommes, c'est pourquoi le gouvernement est obligé de laisser entrer des femmes illettrées, qui parlent à peine le dibadien. Il se trouve que parmi les envahisseurs, il y a des femmes. Beaucoup de femmes, et c'est normal, puisque les femmes essayent autant que les hommes d'échapper à la famine en envahissant le Niémélaga."
Mindi grimaça un sourire :
"Vous voyez où je veux en venir ? Non, pas vraiment ? Alors je vous explique. Le gouvernement a décidé d'envoyer les jeunes filles âgées de dix à douze ans, capturées parmi les envhisseurs, dans des camps près de Dibadi, pour qu'elles apprennent notre langue et les rudiments de notre religion. Le but de la manoeuvre est d'en faire de bonnes épouses pour les jeunes hommes qui viennent s'installer à Dibadi, de les marier dès l'âge de quatorze ou quinze ans. Si on essaye de les former après douze ans il est trop difficile de leur apprendre à lire et à écrire en dibadien et de leur faire oublier leurs traditions, et avant dix ans elles sont trop jeunes, il faut attendre trop longtemps pour qu'elles soient épousables, et en attendant il faut les nourrir, les soigner et les éduquer, ça coûte de l'argent."
Les volontaires, et même Vincent et Chim, se demandaient ce que Mindi voulait dire. Vincent commençait à se demander si le commandant n'était pas tout simplement fou.
Mindi parlait toujours :
"Tosztihi est un centre de tri. Les jeunes filles âgées de dix à douze ans, en bonne santé et exempte de tares physiques ou mentales, sont envoyées dans des camps d'accueil. Les hommes à partir de quinze ans sont fusillés, pour eux on applique la loi sur les francs-tireurs. Le reste, les femmes et les enfants, est confié à des unités klelwaks et repart rapidement de Tosztihi, pour aller dans un autre centre de tri."
"Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces femmes et ces enfants ?" demanda quelqu'un.
"Ils entrent dans une sorte de circuit administratif. On les éloigne de la zone rouge. Le gouvernement négocie leur expulsion, pour ce que je peux en savoir à mon niveau."
Vincent était pétrifié. Il ne s'était pas douté que la guerre aurait cet aspect-là.
Le midi, le commandant resta avec la section Chim pour déjeuner. Il avait apporté dans sa voiture de l'otlakhya et de l'eau-de-vie. Le repas fut particulièrement arrosé. Tout le monde avait envie de noyer sa peur et ses doutes. Mindi buvait comme un trou et encourageait tout le monde à en faire autant. Akohi, qui était le plus jeune de tous, sortit du hangar-réfectoire pour aller vomir.
Avant de partir, Mindi, sur qui l'alcool semblait n'avoir aucun effet, leur adressa une dernière parole :
"C'est la guerre, je vous le rappelle. La désobéissance est punie de mort, vous comprenez tous, chetencheda ? Punie de mort. C'est moi qui décide des punitions, et je condamne à mort très facilement. Très facilement. À mort. Ceux qui refusent d'obéir aux ordres sont étranglés par les klelwaks. Étranglés. Votre premier ordre, vous devrez l'exécuter cet après-midi. Au revoir."
Il partit en conduisant lui-même sa voiture, son chauffeur étant allongé ivre mort sur la banquette arrière.
Vincent était ivre comme les autres. Il aurait bien aimé continuer à boire, mais il ne restait plus rien, ni eau-de-vie ni otlakhya. Il s'endormit sur une chaise, les bras et le visage posés sur la grande table de bois.
Quelques heures plus tard, Mohawequaï passa dans le hangar-réfectoire, où régnait un désordre fort peu milicien. Il expliqua à Chim que pour tester la motivation des volontaires le commandant avait décidé de les faire participer à des pelotons d'exécution.
La première exécution eut lieu le jour même, juste avant la tombée de la nuit. Mohawequaï demanda à Chim de désigner cinq hommes. Chim désigna les quatre adjoints-miliciens les plus âgés, et Vincent.
"Nous les klelwaks, on étrangle les condamnés avec une corde" dit Mohawequaï, "mais pour vous, c'est différent. Il faut faire les choses selon les règles."
Les exécutions avaient lieu dans un pré rectangulaire, avec un mur de pierres sèches à une extrémité. Une grille de fil de fer, d'environ deux mètres de haut et un mètre de large avait été fixée au mur. Deux klelwaks amenèrent un homme barbu et chevelu, vêtu de haillons. Il était si maigre qu'il tenait à peine debout. Ils l'attachèrent à la grille avec des cordelettes, lui bandèrent les yeux et fixèrent une demi-feuille de papier blanc sur sa poitrine, là où se trouve le coeur.
"Normalement il devrait y avoir un religieux près de lui pour le préparer à mourir," dit Mohawequaï, "mais il ne parle pas le dibadien."
L'homme semblait marmonner dans sa barbe. Peut-être récitait-il une prière.
Vincent et les quatre adjoints-miliciens allèrent chercher leurs fusils à l'armurerie et se placèrent à environ dix mètres du condamné, selon les instructions de Mohawequaï. Ils étaient encore sous l'effet de l'alcool et cela se voyait à leurs gestes, à la fois mécaniques et maladroits.
Mohawequaï se plaça à côté du peloton et donna les ordres réglementaires, d'une voix forte et ferme :
Lipigoda ! (soldats)
Quan emuskezda.. Sakhali! (les fusils... levés)
Mutagehe tom... Mupaya ! (visez le coeur... feu)
Cinq détonations claquèrent. L'homme s'écroula avec une sorte de hoquet. Du sang coulait sur ses vêtements crasseux, lentement, jusque dans l'herbe fraîche et drue.
Toute la brigade avait regardé.
Vincent avait visé au coeur, et il était sûr d'avoir touché. C'était la première fois qu'il tuait quelqu'un de ses propres mains, et il en tremblait. Mais il était sergent, il devait montrer l'exemple aux autres.
"Maintenant, mes klelwaks vont aller enterrer le corps" dit Mohawequaï. "Normalement on récupère les vêtements, mais les siens sont en si mauvais état et infestés de poux qu'ils nous serviront de combustible."
"Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui ?" demanda Chim d'une voix hésitante.
"Oui" répondit Mohawequaï. "Il y en a trente-sept autres à fusiller. Il faudrait les exécuter aujourd'hui, parce qu'ils n'ont rien mangé depuis leur capture. Le village produit beaucoup moins qu'avant à cause de la guerre, et toute la nourriture disponible est envoyée à Dibadi. Il ne reste rien pour nourrir les prisonniers. Mais je vois que vos hommes sont fatigués... Je propose qu'on exécute cinq autres condamnés demain matin, comme ça, tous vos hommes auront participé. Je commanderai la prochaine exécution, et vous commanderez les quatre autres. Le sergent et les caporaux devront aussi commander des exécutions, au moins occasionnellement. S'il y a un problème, si vos hommes sont fatigués par exemple, mes klelwaks étrangleront les condamnés, comme nous faisons d'habitude. Mais le commandant vous punira s'il y a un problème."
Les hommes de la section Chim se regardèrent mutuellement sans rien dire. Le repas du soir fut triste et presque silencieux, ce qui était très inhabituel chez les volontaires, qui étaient tous, en temps normal, de jeunes et joyeux patriotes pleins de vie.
Le lendemain matin, en regardant les exécutions, Vincent craignit que l'un des adjoints-miliciens craque et ne tourne son arme vers les klelwaks. Mais rien de fâcheux ne se passa. Même Akohi, le plus émotif de tous, épaula, visa et appuya sur la détente. Toutefois, Vincent remarqua qu'il avait fermé les yeux au moment de tirer et que le coup était parti en l'air.
Ses camarades n'avaient pas osé en faire autant. Ils étaient à des centaines de kilomètres de chez eux, dans un environnement inhabituel, qu'ils ne comprenaient pas et qui les perturbait. Chim et Vincent, qui étaient leurs chefs et en qui ils avaient confiance, participaient à cette affreuse mise en scène, et cela achevait de les déstabiliser.
Il y avait aussi, peut-être, une autre raison pensa Vincent : ils étaient trente, au milieu de plusieurs centaines de klelwaks. Il aurait été suicidaire de refuser d'obéir aux ordres, et tous le savaient, même si personne ne le disait.
La section Chim procéda à plusieurs centaines d'exécutions dans les semaines qui suivirent.
Heureusement pour le moral des volontaires, il y avait à Tosztihi tout ce qu'il fallait pour faire de l'otlakhya : de l'eau, de l'alcool industriel, du miel (en l'absence d'édulcorant chimique), et des herbes sauvages. Le résultat, savamment dosé, était d'ailleurs meilleur que tout ce que l'on pouvait trouver à Dibadi même. Le jeune Akohi ne participait presque plus aux exécutions, il passait la plus grande partie de son temps à préparer de l'otlakhya pour ses camarades. Il avait trouvé une formule remarquable : 20% d'éthanol, environ 5% de miel, et suffisamment de décoction d'herbes sauvages bouillies pour donner à la mixture une belle couleur dorée avec des reflets verts et un goût inimitable.
Les klelwaks partaient souvent en opération dans les environs, surtout la nuit, et ils ramenaient presque toujours des prisonniers, dont des femmes et des enfants que l'on entendait pleurer dans les enclos où ils étaient enfermés sans nourriture, avec juste un peu d'eau dans des seaux. Le matin qui suivait la capture des prisonniers, les klelwaks les emmenaient, poignets liés et chevilles entravées, dans des remorques tirées par des tracteurs, vers un endroit qu'ils appelaient Ishdahi. Interrogé par Vincent, Mohawequaï lui dit qu'Ishdahi était un autre centre de tri. Il ne voulut pas donner plus de détails.
Les jeunes filles étaient emmenées à l'infirmerie, où des klelwaks en blouses blanches déterminaient leur âge. Celles qui étaient trop jeunes, en mauvaise santé, ou qui avaient l'air d'avoir plus de douze ans, étaient envoyées à Ishdahi. Les autres avaient le crâne rasé, pour éliminer les poux. Vincent les entendait souvent pleurer leurs cheveux perdus. Ensuite elles passaient sous la douche. L'eau était glaciale et les pauvres filles criaient de douleur. Ensuite les klelwaks leur donnaient un pyjama de toile, des sandales et une couverture, et un autobus militaire les emmenait dans la direction de Dibadi. Leurs anciens vêtements, et leurs maigres possessions (en général, quelques bijoux bon marché) étaient brûlés ou enterrés.
Le commandant Mindi passait souvent à Tosztihi. Il amenait toujours des femmes avec lui, des prisonnières choisies pour leur beauté et leur soumission, et les adjoints-miliciens qui avaient le mieux travaillé avaient le droit de passer une heure avec elles dans une grange. Chim obtint du commandant qu'Akohi puisse passer lui aussi une heure de temps en temps avec les femmes, parce que la fabrication de l'otlakhya était une chose importante, et même indispensable au bon fonctionnement de la section. Mindi accepta, à condition qu'Akohi participe à une exécution au moins une fois par semaine. | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 10 Oct 2010 - 18:07 Dim 10 Oct 2010 - 18:07 | |
| À la demande de mon plus jeune fils, qui aime lire les aventures de Vincent à Dibadi et qui veut en faire profiter ses copains (!), j'ai rassemblé toutes les histoires postées sur ce fil et je les ai téléchargées sur mon site perso :
http://saiwosh.pagesperso-orange.fr/dibadi1.pdf | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 17 Oct 2010 - 11:20 Dim 17 Oct 2010 - 11:20 | |
| J'ai "dévoré" ce dernier passage.
Tu abordes des sujets difficiles, mais je trouve que tu en as bien parlé.
J'imagine que tu connaissais l'expérience de Milgram ? |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 17 Oct 2010 - 16:56 Dim 17 Oct 2010 - 16:56 | |
| - Manildomin a écrit:
- J'imagine que tu connaissais l'expérience de Milgram ?
Oui. On ne le sait pas assez, mais l'être humain est fondamentalement un animal discipliné, ( homo sapiens sapiens) , avec un respect inné, instinctif, de l'autorité, qui est plus fort que ce que l'éducation peut apporter. Comme l'expérience de Milgram l'a montré. Il y a une vingtaine d'années (j'espère que les choses ont changé depuis) dans les orphelinats chinois le taux de mortalité des nourrissons de moins d'un an était de 90%. Sur cent bébés recueillis, 90 mouraient la première année, essentiellement du fait qu'ils étaient totalement privés d'affection. Un taux de mortalité bien supérieur à celui du camp de concentration de Dachau, par exemple (76 000 victimes pour 206 000 détenus. Lien). Je me suis souvent demandé comment les employés des orphelinats chinois, en général des femmes, pouvaient supporter leur travail. On peut supposer que les gens qui avaient choisi d'être gardiens dans des camps de concentration savaient ce qu'ils faisaient (bien que les interrogatoires faits après la guerre montrent que la principale motivation des gardien(ne)s des camps était d'éviter d'aller se faire tuer sur le front de l'Est, comme l'a montré l'affaire Demjanjuk). Mais des gens qui choisissent de s'occuper de bébés dans un orphelinat ? Je pense que pour eux/elles c'était un travail comme un autre, et, passé l'horreur des premiers jours, on s'habitue parce qu'il faut bien vivre... Comme Vincent à Dibadi. Le taux de mortalité des bébés dans les orphelinats français du 18e siècle était équivalent, d'après ce que j'ai lu en faisant des recherches historiques sur la commune où j'habite. On dit souvent que le "respect instinctif de l'autorité" se perd dans nos banlieues. Je pense plutôt qu'il se déplace : la loyauté envers le chef de bande remplace la loyauté envers des institutions déconsidérées. Ce qui est grave en soi, quand on y réfléchit. L'histoire de l'humanité montre que le meilleur moyen de ramener l'ordre, c'est d'envoyer les jeunes gens turbulents faire la guerre (avec des conséquences pour le pays bien pires que les désordres initiaux, mais passons là-dessus). C'est ce qui s'est passé sous la Révolution et l'Empire. En simplifiant, on peut dire que les Français qui s'étaient révoltés contre l'autorité du roi Louis XVI en 1789 ont accepté sans trop rechigner d'aller mourir pour l' empereur Napoléon à Moscou en 1812. C'est assez extraordinaire, quand on y pense, que le même peuple, qui brûlait les églises et décapitait le haut clergé et les nobles en 1792, est allé se faire tuer en masse vingt ans plus tard pour un empereur couronné par le Pape et créateur d'une nouvelle noblesse (dite "noblesse d'Empire"). Ceci étant, Vincent va connaître de nouvelles aventures, et Quamis Mindi, à la fois commandant de la milice et chef de bande, n'a pas encore montré tous ses talents  | |
|   | | Anoev
Modérateur
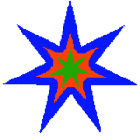
Messages : 37637
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Les arcanes de l'Histoire. Sujet: Les arcanes de l'Histoire.  Dim 17 Oct 2010 - 20:33 Dim 17 Oct 2010 - 20:33 | |
| - Vilko a écrit:
- C'est ce qui s'est passé sous la Révolution et l'Empire. En simplifiant, on peut dire que les Français qui s'étaient révoltés contre l'autorité du roi Louis XVI en 1789 ont accepté sans trop rechigner d'aller mourir pour l'empereur Napoléon à Moscou en 1812. C'est assez extraordinaire, quand on y pense, que le même peuple, qui brûlait les églises et décapitait le haut clergé et les nobles en 1792, est allé se faire tuer en masse vingt ans plus tard pour un empereur couronné par le Pape et créateur d'une nouvelle noblesse (dite "noblesse d'Empire").
On trouve les mêmes symptômes, quand les frères ou enfants des bolcheviks qui se sont fait tuer par l'armée blanche tsariste vont suivre sans trop d'états d'âmes (ceux qui en auront auront été exécutés par le GPU ou le KVD) les cadres de l'armée rouges (anciens généraux tsaristes, encadrés par les Commissaires politiques) et massacrer des Polonais à Katyn ou des Lituaniens ayant des doutes sur la "sincérité" du "rapprochement" des peuples baltes avec l'Idéal Révolutionnaire, suite à l'accord signé avec ce qui allait devenir l'Envahisseur fasciste... | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Lun 8 Nov 2010 - 22:30 Lun 8 Nov 2010 - 22:30 | |
| Au milieu de l'hiver, lors d'une de ses visites régulières à Tosztihi, le commandant Mindi rassembla dans un hangar en début d'après-midi la trentaine d'adjoints-miliciens de la section Chim et leur fit un discours :
"Chetencheda, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. Commençons par la mauvaise. J'espérais que nous pourrions passer la frontière sud-est et porter la guerre sur le territoire ennemi. Mais ce ne sera pas possible, parce que le Padzaland, notre grand et puissant voisin du nord-ouest, a envoyé un ultimatum au Niémélaga. Si le Niémélaga envahit ses voisins du sud-est, c'est la guerre au nord-ouest, contre le Padzaland."
Mindi fit une pause, il semblait chercher ses mots :
"Comme vous le savez, nous les Niémélagans, nous sommes sous protectorat padzalandais. À cause de ça, nous payons un tribut au Padzaland. Nous payons ce tribut en électricité et en produits agricoles. Ce tribut est devenu vital pour le Padzaland, vu l'effondrement de la production alimentaire mondiale et l'épuisement des ressources minières. Malgré ça, le Padzaland est encore trop fort pour nous, au moins pour le moment. Alors, lorsqu'ils nous disent qu'il ne faut pas envahir nos voisins, nous devons leur obéir, parce que militairement nous n'avons pas encore les moyens de leur botter les fesses."
Un éclair de colère traversa le visage de Mindi. Il continua son discours d'une voix devenue plus dure :
"Les grands chefs, là-bas à Dibadi, attendaient cent millions de réfugiés en quelques années. En fait, le flot s'est tari en trois mois. C'est le chaos total au sud-est, il n'y a plus de transports, plus rien, les réfugiés doivent marcher. Et personne ne peut faire cinquante kilomètres le ventre vide. Nous en avons tué quelques millions... Quand je dis nous, je veux dire les klelwaks et l'armée régulière, les exécutions faites par nous les miliciens sont une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, quand je dis tué... Pas tous, la plupart des réfugiés ont été expulsés, bien sûr."
Mindi se mit à rire, un drôle de petit rire sec. Curieusement, ce gaillard sans foi ni loi ne savait pas mentir. Officiellement, les réfugiés de la faim étaient "expulsés".
Vincent, qui avait dirigé plusieurs exécutions le matin même, se surprit à rire aussi. Graduellement, une hilarité plutôt incongrue se répandit dans toute la section.
Mindi retrouva son sérieux, et les miliciens aussi :
"Comme je le disais, personne ne peut marcher cinquante kilomètres le ventre vide. Je crois savoir que des commandos à nous ont détruit tout ce qui restait comme ponts et centrales électriques de l'autre côté de la frontière. Les réfugiés ne peuvent pas traverser à pied une zone où plus rien ne fonctionne depuis des mois, où le moindre jardin potager a été cent fois pillé. Pour parachever le travail nos micro-avions ont visé les fermes et les entrepôts. C'était un travail nécessaire, mais les salopards de Padzalandais ont hurlé au génocide et ont menacé de nous déclarer la guerre. Et notre gouvernement a reculé."
Vincent se sentit soulagé : le Padzaland était francophone. Comme lui. Il n'avait pas envie de faire la guerre à des gens parlant sa langue maternelle.
Mindi parlait toujours :
"Les bureaucrates du gouvernement ont reculé, et notre travail n'est pas fini. C'est la pénurie à Dibadi, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, à cause de la guerre. Nous sommes des miliciens avant tout, nous devons retourner à Dibadi pour maintenir l'ordre. C'est la bonne nouvelle dont je vous parlais : nous rentrons chez nous plus tôt que prévu."
Les miliciens poussèrent des cris d'allégresse et se mirent à applaudir. Vincent applaudit aussi, avec un peu d'inquiétude au fond du coeur, car le mot pénurie - wikyule - utilisé par Mindi ne lui disait rien de bon.
"Attendez" dit Mindi en levant les bras. "Ce n'est pas fini. Nous n'aurons pas de car pour rentrer, il faudra prendre le train. Faites vos bagages ce soir, demain matin à l'aube vous devrez marcher jusqu'à Ishdahi. Un klelwak vous y conduira."
Avant que Mindi s'en aille vers sa voiture, Dalawas, l'un des adjoints-miliciens, lui posa une question :
"Commandant... Et les femmes, celles qui venaient avec vous... ? Est-ce qu'elles vont aller avec nous à Dibadi ?"
"Les putes ? Déjà expulsées."
"Expulsées ?"
"Expulsées. Igochi musaia. Tu comprends le dibadien ?"
"Oui mon commandant."
L'adjoint-milicien était livide. Mindi, qui le dépassait d'une tête, le regarda droit dans les yeux, d'un regard froid et cruel, un regard de loup. Dalawas baissa la tête. Vincent, qui était près de lui, eut l'impression de voir des larmes dans ses yeux.
Ainsi donc, Dalawas s'était attaché à l'une des femmes... Vincent était surpris, il se serait plutôt attendu à trouver ce genre de faiblesse chez le jeune Akohi. Il le chercha du regard mais ne le vit pas.
Le soir, à l'heure du dîner, Akohi était là, l'air aussi pâle et troublé que Dalawas. Vincent, tout à la joie d'être sur le point de revoir Diletyet, la femme qu'il aimait, après deux mois de séparation, préféra ne pas parler à Akohi et aux autres camarades qui n'avaient pas la chance d'avoir une femme.
Le lendemain matin, dès que le jour se leva, la section Chim quitta Tosztihi, en manteau et sac sur le dos, après un petit-déjeuner copieux qui remonta le moral de ceux qui en avaient besoin. Il faisait froid, un froid sec, pas vraiment désagréable. Un soleil pâle brillait timidement dans le ciel. Le sous-lieutenant Chim marchait en tête, à côté du klelwak qui leur servait de guide, et Vincent en queue de section. Il devait veiller à ce qu'aucun traînard ne quitte la colonne.
Les adjoints-miliciens avaient passé plusieurs mois presque sans faire de sport, à part un peu de gymnastique de temps en temps, et la plupart avaient pris l'habitude de boire de l'alcool plusieurs fois par jour. Il leur fallut toute la matinée pour faire les quinze kilomètres de petites routes de campagne séparant Tosztihi d'Ishdahi, dans un paysage de champs en friches et de petites collines envahies de broussailles. L'absence de véhicule à moteur pour transporter une trentaine d'hommes indiquait un certain relâchement dans l'organisation, d'autant plus que des tracteurs électriques tirant des remorques pleines de prisonniers ligotés les dépassèrent plusieurs fois.
La région avait dû être urbanisée autrefois, comme souvent au Niémélaga. On voyait bien que le terrain avait été nivelé au bulldozer et recouvert de terre avant d'être rendu à l'agriculture. Les collines avaient la forme caractéristique des monceaux de débris que l'on recouvre de déchets organiques et qu'on laisse ensuite envahir par les mauvaises herbes et les coquelicots. Des dizaines de milliers de personnes, peut-être davantage, avaient dû vivre là, autrefois. Qu'étaient-ils devenus ? Peut-être s'étaient-ils enfuis dans des régions éloignées où ils avaient pu survivre. À Dibadi même, peut-être. La majorité d'entre eux avait dû mourir exterminée par les klelwaks et les robots de combat des cyborgs. Ensuite les bulldozers étaient venus et avaient jeté leurs cadavres sur les collines de débris...
À Ishdahi, centre agricole semblable à Tosztihi en plus grand, Chim et sa section firent connaissance avec le reste du bataillon Mindi, dont ils faisaient partie : de jeunes adjoints-miliciens comme eux, aux visages pour la plupart déjà marqués par l'alcool.
Le commandant Mindi était là, l'air tout joyeux, debout à côté de sa voiture avec chauffeur, regardant avec satisfaction les presque deux cents hommes qu'il commandait.
Vincent se demanda où étaient les prisonniers que les klelwaks emmenaient tous les jours à Ishdahi, il devait y en avoir des milliers, mais il ne vit rien. L'architecture locale, à part quelques bâtiments qui avaient miraculeusement survécu aux bouleversements du siècle précédent, était surtout composée de hangars pour klelwaks et robots. Dans les rues, la plupart des véhicules étaient des tracteurs, conduits par des klelwaks et tirant des remorques bâchées.
La gare d'Ishdahi, un grand bâtiment fonctionnel de brique et de béton, avait dû être construite un ou deux siècles plus tôt. Malgré la saleté qui la ternissait, il lui restait encore quelque chose des années de prospérité qu'elle avait dû connaître. En temps de paix, depuis que la région était devenue niémélagane, elle servait de gare de marchandises et de relais pour les trains internationaux. C'était à Ishdahi que les trains venus des pays du sud-est changeaient de locomotive et de conducteurs avant de poursuivre leur trajet jusqu'à Dibadi.
Cinq wagons avaient été réservés pour le bataillon Mindi, dans un train de marchandises à destination de Dibadi. La pensée qu'il serait chez lui le soir même remplissait Vincent d'une joie ineffable. Le départ vers Dibadi eut lieu tout de suite après le déjeuner, composé d'un sandwich et d'un peu d'eau bue à la gourde, pris dans le hall de la gare. Un pique-nique incongru de presque deux cents hommes en manteau et uniforme marron, assis à même le sol à côté de leurs sacs à dos.
Vincent n'avait pas bu d'otlakhya depuis la veille et ça lui manquait déjà. Mindi devait en avoir, lui. Il ne revit le commandant qu'au moment du départ, alors que les chefs de section étaient en train de faire l'appel.
"Venez, sergent," lui cria Mindi, "on parlera du pays." Et il l'entraîna dans l'un des wagons, où une quarantaine d'hommes avait déjà pris place. Faute de sièges, tout le monde était assis à même le sol. Tout commandant qu'il était, Mindi s'assit sans façon comme les autres. Il faisait un peu sombre, le wagon n'ayant que peu de fenêtres. Des bâches de bioplastique transparent avaient été tendues pour remplacer les vitres inexistantes.
Le train s'ébranla. Vincent n'osait pas demander à Mindi s'il avait de l'otlakhya.
Un peu plus tard, en rase campagne, le train qui transportait Vincent et les autres miliciens croisa un groupe de plusieurs centaines de klelwaks en bicyclettes, qui fonçaient à grande vitesse mais en bon ordre en direction de la frontière, vers le sud-est, sur une vieille route défoncée qui longeait la voie ferrée.
"Vous voyez" dit Mindi en souriant. "Les klelwaks n'ont pas besoin de voitures ni de trains. Ce sont des machines à deux pattes, chacun de leur muscle est un moteur électrique bionique. Les vélos leur permettent d'aller plus vite en dépensant moins d'énergie qu'à pied. Regardez comme ils vont vite, je dirais qu'ils font presque du quarante à l'heure."
Les klelwaks cyclistes disparurent dans le lointain. Vincent se surprit à les regarder avec nostalgie. Ces créatures incompréhensibles et familières à la fois faisaient partie de son univers. À Dibadi il n'en verrait plus.
C'était peut-être aussi bien. Les klelwaks n'ont pas d'âme. Vincent savait qu'ils tuaient les humains en les étranglant avec des cordes. Une méthode rapide et économique. Chez les humains, seuls des psychopathes seraient capables de faire ça de façon routinière. D'où le cérémonial des exécutions par fusillade, où chaque tireur peut se dire qu'il n'est pas coupable de meurtre puisque il a agi sur ordre. Même celui qui donne l'ordre de tir agit sur ordre, et de toute façon ils sont plusieurs à tirer, donc la responsabilité de chacun est diluée, et même annulée puisque même si l'un des tireurs visait à côté le condamné mourrait quand même à cause des autres tireurs. Et même si tous les tireurs visaient à côté, l'exécution aurait lieu quand même, elle serait recommencée, et ce serait une nouvelle et inutile agonie pour le condamné. Autant qu'il en finisse une fois pour toutes.
Le voyage dura sept heures. Mindi finit par sortir une bouteille d'otlakhya blanc de son sac à dos et il en distribua à la cantonade, dans les gobelets d'aluminium que lui tendaient les miliciens.
L'otlakhya blanc était fortement alcoolisé. Le liquide descendit le long de la gorge de Vincent comme une boule de feu et répandit une douce chaleur dans tout son corps, même dans son cerveau. Un sentiment de paix presque religieux se répandit en lui.
Mindi ressentait-il la même chose ? C'était difficile à dire. Le commandant avait de gros yeux globuleux un peu fixes dans un visage maigre et précocement vieilli, un vrai regard de fou. Vincent se rappela que cet homme-là était un tueur, un vrai, et malgré lui il détourna son regard vers son gobelet déjà vide. Malgré les dizaines d'exécutions auxquelles il avait participé en deux mois, Vincent ne se considérait pas comme un tueur. Il avait obéi à des ordres auxquels il était totalement impossible de ne pas obéir.
Vincent le sentait bien, dans l'esprit de Mindi les exécutions n'étaient qu'une première étape dans un processus d'endurcissement dans l'objectif final était mystérieux. Heureusement, la guerre se terminait déjà. Il ne restait plus qu'un peu de maintien de l'ordre à faire à Dibadi.
Les heures passèrent dans l'ennui des conversations futiles. Mindi raconta un peu sa vie à Vincent : "Je suis un Aneuvien, de Smùhr, dans les Santes." Le nom de la ville natale de Mindi sonnait bizarrement dans une phrase en dibadien. "Je ne m'appelais pas encore Quamis Mindi à l'époque, bien sûr. Sans entrer dans les détails, disons que mon caractère un peu impulsif et extrémiste a attiré défavorablement l'attention de la justice de mon pays. J'ai fait un peu de prison à Hocklènge. J'avais un diplôme universitaire, mais du fait de mes antécédents judiciaires il ne me servait plus à grand-chose. Je n'avais plus d'avenir en Aneuf."
Mindi hocha la tête, et il continua, comme pour lui-même : "Je savais que le Niémélaga cherchait des immigrants aneuviens, pour diversifier au maximum l'origine linguistique des Dibadiens. En prison, j'ai appris le dibadien. J'ai passé l'examen au consulat niémélagan à Hocklènge, à la suite de quoi on m'a donné un nom dibadien, Quamis Mindi, à la place de mon nom aneuvien. Peu de temps après je suis arrivé à Dibadi."
"Et comment êtes-vous devenu officier de la milice, mon commandant ?"
"Quamis Mindi le Dibadien n'a pas d'antécédents judiciaires. Celui que j'étais avant, à Smùhr, portait un autre nom. Pour moi c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Dans mon esprit il est mort et enterré. Je suis entré dans la milice, qui manquait d'officiers à l'époque. J'ai servi pendant deux ans, le temps que le dibadien devienne ma langue principale, et j'ai passé un concours interne. Maintenant, à quarante et un ans, je suis commandant de la milice."
Vincent raconta brièvement son propre cursus, et posa une question qui lui tenait à coeur :
"Comment voyez-vous l'avenir, mon commandant ? Pas seulement le vôtre, mais celui de tous les Dibadiens ?"
"Ah, ça, ça dépend des cyborgs. Voyez-vous, personne n'a l'air de connaître l'histoire des cyborgs. En fait, à l'université d'Hocklènge j'en ai appris davantage sur les cyborgs qu'ici. L'histoire, c'est important. Connaître le passé permet de comprendre le présent et, dans une certaine mesure, de prévoir l'avenir."
Sans transition, Mindi se mit à raconter une étrange histoire de savants américains excentriques, qui s'étaient constitués en société secrète aux États-Unis une vingtaine d'années après la Guerre de Sécession. L'un des savants était mormon et avait appris le jargon chinook lors d'un séjour dans le Nord-Ouest. Il créa une sorte de code linguistique, à base de jargon chinook, et s'amusa à le transcrire dans l'alphabet Deseret des Mormons. Ce code, au départ uniquement écrit, était utilisé par les savants lorsqu'ils se communiquaient par lettre les résultats de leurs recherches.
Les savants n'étaient pas très nombreux, une douzaine peut-être. Leur collaboration permit à l'un d'entre eux de trouver la formule du yeksootch, le gaz pensant qui stocke et transforme toutes les formes d'énergie, en application de l'équation fondamentale de l'univers.
"Et c'est là le grand mystère" dit Mindi, dont les yeux brillaient sous l'effet de l'alcool. "Pour comprendre cette équation, simplement pour la comprendre, il faut une intelligence supérieure à la normale. Et normalement, un cerveau humain ne peut pas atteindre ce niveau d'intelligence. Pas plus qu'un être humain ne peut mesurer dix mètres de haut."
Les miliciens regardèrent le commandant d'un air sceptique. Vincent se dit qu'il aimerait bien jeter un coup d'oeil à cette équation avant de décider si elle était trop compliquée pour un cerveau humain.
Mindi avait déjà recommencé à parler :
"Le nom de ce savant a été oublié, comme ceux de ses collègues d'ailleurs. Selon l'histoire officielle, ce savant a utilisé la formule pour créer un petit nuage de yeksootch dans une bouteille, et il l'a relié à son cerveau par des électrodes. Son cerveau aurait alors fusionné avec le yeksootch, et le premier cyborg - ilip eyesztilik - serait né de cette fusion. C'était aux États-Unis à la fin du dix-neuvième siècle. Ilip Eyesztilik, le Premier Cyborg, est l'ancêtre de tous les cyborgs, et de toutes les créatures dont le cerveau est fait de yeksootch. C'est le cas, entre autres, des klelwaks."
"Comment a-t-il fait ?" demanda Vincent.
"Un cerveau de yeksootch peut se dupliquer lui-même, totalement ou en partie. Ilip Eyektilik a introduit dans les cerveaux dupliqués une règle qui contrôle le comportement de chaque cyborg, klelwak et robot : un cerveau de yeksootch doit obéir à un cerveau de yeksootch plus ancien, sauf si cette obéissance met en danger la survie de l'ensemble des cerveaux de yeksootch."
Vincent était dubitatif : "Concrètement, ça veut dire quoi ?"
"Si un dirigeant cyborg donnait l'ordre d'envahir le Padzaland, il ne serait pas obéi, parce que la plupart des cyborgs considéreraient ça comme un suicide collectif. Mais s'il donne l'ordre de tuer des humains, il est obéi parce que ça ne met pas en danger la survie de la communauté cyborg, si c'est fait discrètement."
"Si je comprends bien, Ilip Eyesztilik a dupliqué son propre cerveau" dit en hochant la tête un jeune caporal que Vincent ne connaissait pas. Il devait être d'une autre section. C'était un jeune homme au teint clair et aux cheveux châtain, qui parlait dibadien avec un léger accent chantant.
"Oui. C'est pour ça que tous les cyborgs ont à peu près le même caractère. Ilip Eyesztilik a eu l'idée d'utiliser le code linguistique de son petit club de savants pour communiquer avec les autres lui-mêmes qu'il avait créés. Ils avaient ainsi une langue rien que pour eux. Cette langue était la langue-mère du dibadien. Je dis bien la langue-mère, parce qu'elle n'était pas vraiment au point. Il a fallu des années aux cyborgs pour perfectionner leur langue. Elle a encore subi des modifications lorsqu'elle est devenue la langue des Dibadiens, et ce n'est que récemment qu'elle a pris sa forme définitive."
Le caporal insistait : "Je comprends comment le savant a créé des cerveaux, mais comment a-t-il fait pour créer les corps qui vont avec les cerveaux ?"
"Au départ, les corps des cyborgs étaient ceux d'androïdes primitifs, des robots humanoïdes. Ils se sont perfectionnés ensuite, au point qu'on a du mal à les différencier des vrais humains."
"Et les autres savants, que sont-ils devenus ?"
"Quand Ilip Eyesztilik a cessé de leur écrire, ils sont retournés à leur vie normale de chercheurs et de professeurs d'université. Je ne vois pas de raison de penser que ce n'est pas vrai. Seul Ilip Eyesztilik avait la formule, et en plus il était le seul à pouvoir la comprendre."
"Est-ce qu'Ilip Eyesztilik est toujours vivant, mon commandant ?"
"Personne n'en sait rien. Les cyborgs ont le goût du secret. Ils essayent de se faire passer pour des êtres humains normaux, mais en définitive ils sont un seul individu qui a réussi à se multiplier des millions de fois. Et cet individu est un savant fou qui veut conquérir le monde."
"Mais mon commandant, les cyborgs que je connais ne sont pas comme ça !"
"Non bien sûr, parce qu'ils jouent un rôle. De plus, la plupart d'entre eux n'ont qu'une partie du cerveau d'Ilip Eyesztilik. Ils n'ont ni son intelligence ni son savoir. Mais ils lui obéissent, à cause de la règle gravée dans leur esprit : un cerveau de yeksootch doit obéir à un cerveau de yeksootch plus ancien, sauf si cette obéissance met en danger la survie de l'ensemble des cerveaux de yeksootch."
Mindi continua à parler pendant une bonne heure. Il raconta les grandes lignes de l'histoire des cyborgs, pendant les presque trois siècles qui suivirent la naissance d'Ilip Eyesztilik, comment les êtres humains se multiplièrent jusqu'à ce que huit milliards d'entre eux pullulent sur la Terre, et comment l'épuisement des ressources fit brutalement chuter la population du monde. Les cyborgs, qui s'étaient multipliés aussi, profitèrent du chaos pour créer leur propre État, le Niémélaga, dont Dibadi est la capitale.
"Neuf millions d'habitants à Dibadi" conclut sombrement Mindi. "Mais autrefois cent millions d'hommes vivaient sur le territoire du Niémélaga, qui n'existait pas encore, là où maintenant on ne voit plus que des robots et des klelwaks. La chute démographique de l'humanité continue, une horrible agonie de peuples entiers qui meurent de faim et s'entretuent, c'est d'ailleurs pour ça que nous venons de passer deux mois à la frontière."
Le caporal, qui était un peu ivre, regarda Mindi droit dans les yeux :
"Nous sommes des humains et nous tuons des humains pour le compte des cyborgs. Nous sommes des traîtres."
Un grand silence se fit dans le wagon.
Mindi lui répondit tranquillement : "Il y a deux façons de tenir un fusil. Moi je préfère le tenir par la crosse."
Le caporal était devenu tout pâle. Vincent crut un moment qu'il allait cracher au visage de Mindi, mais il se contenta de dire :
"Sëpukamuk !"
L'insulte ("chien de merde") avait fusé. Mindi sortit prestement son pistolet automatique d'officier de son étui de ceinture et le braqua en direction du visage du caporal, qui n'avait pas d'arme. Dans la milice seuls les officiers ont droit à un pistolet, les sous-officiers et simples miliciens ont des fusils. Pendant les transports les armes sont rassemblées en faisceaux, par sécurité.
Vincent eut peur que Mindi ne tue le caporal sur place, dans le wagon bondé. Il en était capable. Selon les rumeurs qui couraient parmi les miliciens, il avait déjà fait bien pire.
Tout en tenant le caporal en respect avec son pistolet, Mindi sortit un téléphone portable d'une poche de sa veste et donna l'ordre d'arrêter le train.
La nuit tombait déjà. Le caporal se retrouva dans la campagne grelottant dans son manteau, sans arme et sans nourriture, sans même son sas à dos.
Le train repartit. Personne ne disait rien. Vincent avait les larmes aux yeux et les mains qui tremblaient. Il avait mal au dos, du fait d'être assis depuis plusieurs heures sur le plancher du wagon, et il avait un peu envie de vomir, à cause de l'otlakhya dans son estomac presque vide et de la scène pénible à laquelle il venait d'assister.
Le caporal pourrait-il survivre ? Que feraient les klelwaks en voyant son uniforme ? Vincent se demanda comment le caporal ferait pour ne pas mourir de froid pendant la nuit. Marcherait-il le long de la voie jusqu'à une installation agricole, et ensuite demanderait-il l'hospitalité aux klelwaks en tant que milicien ? C'était sa seule chance de survie. Mais que feraient des robots, s'il en rencontrait en chemin ? Est-ce qu'ils reconnaîtraient eux aussi l'uniforme de la milice ?
Mindi était énervé et, la bouteille d'otlakhya blanc étant vide, rangea son pistolet et sortit un jeu de cartes. Vincent et quelques autres se sentirent obligés de jouer avec lui. Ils ne tenaient pas à subir le même sort que le caporal.
Vincent essaya de se concentrer sur son jeu pour ne pas penser. Le voyage tirait vers sa fin. À travers les bâches transparentes recouvrant les fenêtres on voyait les lumières des premières maisons de Dibadi.
Au bout d'une dizaine de minutes le train s'arrêta. Ils étaient arrivés.
Dernière édition par Vilko le Sam 20 Nov 2010 - 19:51, édité 1 fois | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Jeu 18 Nov 2010 - 12:52 Jeu 18 Nov 2010 - 12:52 | |
| Intéressant cette suite ! Je me demande une chose : - Spoiler:
Est-ce que Vincent va se retrouver à devoir fusiller Diletyet ?
|
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Jeu 18 Nov 2010 - 19:44 Jeu 18 Nov 2010 - 19:44 | |
| - Manildomin a écrit:
- Intéressant cette suite !
Je me demande une chose :
- Spoiler:
Est-ce que Vincent va se retrouver à devoir fusiller Diletyet ?
- Spoiler:
Normalement, non. Parce que Quamis Mindi sait très bien qu'il ne le ferait pas. On ne peut tuer que des gens avec lesquels on ne s'identifie pas. Un ennemi dont on ne veut pas voir l'humanité peut être tué sans problème de conscience excessif. Mais même les criminels de guerre ne tuent pas leurs femmes de sang-froid. Vincent et les autres miliciens ne pourrront jamais aller plus loin que des criminels de guerre. Ils ne sont d'ailleurs pas encore des criminels de guerre, contrairement à leur chef...
| |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 20 Nov 2010 - 13:40 Sam 20 Nov 2010 - 13:40 | |
| Ok merci.
Une autre question :
pourquoi ne pas essayer d'écrire l'histoire en dibadien ? |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 20 Nov 2010 - 19:47 Sam 20 Nov 2010 - 19:47 | |
| - Manildomin a écrit:
- Ok merci.
Une autre question :
pourquoi ne pas essayer d'écrire l'histoire en dibadien ? Parce que personne ne pourrait me lire  De plus, je n'ai pas assez de vocabulaire ! Mais j'essaie de "penser" les dialogues en dibadien. Par exemple, quand Mindi dit : "Les putes ? Déjà expulsées." En français, c'est rapide et brutal. En dibadien, on dirait : Eumkamukda... Diletalta saia. Littéralement : "Les chiennes... Déjà au loin." La phrase est également rapide et brutale, mais pas de la même façon, c'est une sorte de bredouillis, avec les syllabes accentuées qui ressortent plus nettement : eUMkamukda... DIletalta SAia. Un peu comme en russe, une langue qui convient parfaitement à un certain style militaire. Le milicien dépité va reprendre le mot-clé, en y joignant la particule interrogative wik : " Saia wik..." (Au-loin est-ce-que) Il est obligatoire d'utiliser une particule, ou un mot interrogatif (qui, quoi, comment.. ) pour exprimer une question, car l'intonation n'a pas de valeur sémantique en dibadien, contrairement au français. Mindi se fait alors plus précis : Tlas igochi musaia. Igochi musaia. Këmtëk dibadimide wik...(Elles quelqu'un-dans-le-passé faire-partir-au-loin. Quelqu'un-dans-le-passé faire-partir-au-loin. Savoir langue-dibadienne est-ce-que) En français : "Elles ont été expulsées. Expulsées. Tu comprends le dibadien ?" On remarquera que, comme en japonais, on se passe assez facilement des pronoms en dibadien. Question d'habitude, les Japonais s'y font très bien, les Dibadiens aussi. Wik est une particule négative lorsqu'elle est placée avant un mot, interrogative en fin de phrase, comme le latin "ne". Tlët wik këmtëk ou Wik tlët këmtëk. Tu ne sais pas. Tlët këmtëk wik... Est-ce que tu sais ? On peut aussi placer une particule interrogative en début de phrase. Dans ce cas, ce sera nak : Nak tlët këmtëk... Est-ce que tu sais ? Dans la phrase " Tlas igochi musaia", l'ordre des mots est OSV. C'est un ordre des mots assez rare parmi les langues humaines, mais c'est ainsi que le dibadien exprime ce qui lui tient lieu de passif : en mettant l'objet en tête de phrase. Au mode actif, on dirait : Igochi musaia tlas, "Quelqu'un les a expulsées." Pour les Dibadiens, c'est simple. Beaucoup plus simple qu'en français... C'est grâce à cela que Quamis Mindi peut parler dibadien sans faire de fautes de grammaire même lorsqu'il est à moitié ivre  | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 16 Jan 2011 - 20:44 Dim 16 Jan 2011 - 20:44 | |
| Un nouveau chapitre des aventures de Vincent / Mantolo Haiakkhuch ! À la demande de mon plus jeune fils, qui est plus jeune que Vincent mais plus vieux qu'Akohi. Bon, c'est l'hiver, et ça influe sur l'inspiration, mais l'hiver, c'est la saison où Dibadi ressemble le plus à Dibadi...  -------------------------------------------- Le train s'était arrêté dans la gare de marchandises de Shagohon, dans la partie sud-est de Dibadi, à une dizaine de kilomètres du centre de la métropole. Les miliciens du bataillon de Mindi sortirent les uns après les autres des cinq wagons qui leur avaient été assignés. Ils étaient affamés, fatigués, certains étaient ivres, et tous avaient besoin de soulager leur vessie ou leurs intestins. Mais avant d'être autorisés à s'occuper d'eux-mêmes ils durent faire la queue dans le froid pour récupérer leurs fusils, qui avaient voyagé à part. C'était la nuit, il devait être au moins dix-neuf heures, en plein hiver. Il faisait froid, et la gare n'était éclairée que par des lampes fixées aux parois des hangars. Il n'y avait personne pour les accueillir. Vincent se rendit compte avec irritation qu'il ne pourrait pas dîner avant d'arriver à la caserne, un trajet d'au moins quarante minutes en métro. Certains miliciens, dont les casernes étaient à l'autre bout de la ville, avaient encore près de deux heures à faire avant d'arriver à leur caserne. Le commandant Mindi dit brièvement bonsoir à ses hommes et disparut dans l'obscurité, tout seul. En tant qu'officier supérieur il avait sans doute une voiture avec chauffeur qui l'attendait à la sortie de la gare, le veinard. Un groupe d'hommes en bonnets de laine, blouses grises et gros gants de manutention sortit de nulle part et commença à décharger les autres wagons, qui contenaient de gros sacs de pommes de terre. Vincent remarqua que pour se protéger du froid les hommes portaient tous plusieurs pull-overs sous leurs blouses, ce qui leur donnait des silhouettes boudinées. "Hé les gars, vous savez où sont les toilettes ?" demanda Chim. "Dans le hangar numéro sept, là-bas" répondit l'un des hommes en riant tout seul. Les sanitaires étaient insuffisants pour près de deux cent hommes, et beaucoup de miliciens se soulagèrent comme ils purent dans les allées sombres entre les hangars. Vincent et Chim firent comme les autres. Faute de papier hygiénique, Vincent utilisa quelques pages du carnet qu'il portait toujours sur lui. Il vit passer un rat dans la pénombre à deux mètres de lui. Ces animaux pullulent à Dibadi. Le jour, on ne les voit pas, on ne voit que des chats errants, surtout dans les quartiers pauvres du centre, avec leurs immeubles vétustes et mal entretenus, dont certains datent de plus d'un siècle, quand Dibadi était encore une petite ville. Certains Dibadiens mangent de la viande de chat. Quand on meurt de faim, on n'a pas le choix. C'est un cycle complet, se dit Vincent. Il lui était déjà arrivé de voir des cadavres de clochards à moitié dévorés par les rats. Les rats mangent les miséreux, les chats mangent les rats, et les miséreux mangent les chats. Plusieurs camarades de Vincent étaient déjà partis à la recherche d'une station de métro. Contrairement aux gares de voyageurs, qui sont souterraines et intégrées au réseau du métro, à Dibadi les gares de marchandises sont en surface, et le fret entrant et sortant est transporté par camion. Chim et Vincent rassemblèrent les miliciens de leur section qu'ils purent trouver, au nombre d'une vingtaine, pour faire un retour groupé à la caserne. On ne savait jamais sur quoi on pouvait tomber, à circuler la nuit dans une ville où beaucoup plus de gens que d'habitude étaient sans ressources. À Dibadi, de grandes flèches blanches peintes sur les murs indiquent toujours la direction de la sortie. Après quelques minutes de marche les miliciens se retrouvèrent devant un portail gardé par deux agents des chemins de fer en uniforme bleu, armés de carabines. À la demande de Chim ils leur ouvrirent le portail et leur indiquèrent la station de métro la plus proche. Le portail donnait sur une grande avenue rectiligne, faiblement éclairée, où des voitures et des camions roulaient assez vite, sans égard pour les piétons. Tous les commerces étaient fermés et très peu de gens marchaient dans les rues, ce qui était inhabituel. Les Dibadiens sont souvent mal logés, dans des logements exigus et surpeuplés, et beaucoup d'entre eux ne rentrent chez eux que pour dormir. Ils préfèrent encombrer les trottoirs, les parcs et les cafés. Mais on était en hiver. Vincent se dit que le froid avait dû chasser les gens des rues. Au croisement de l'avenue avec une rue plus petite, Vincent reconnut avec émotion une entrée de métro, avec sa balustrade peinte en jaune. Un panneau blanc éclairé par des tubes de néon, en haut d'un mât de quatre mètres de haut, portait l'inscription MINWEKHA (gare, ou station de métro) en lettres bleues. Un escalier descendait jusqu'à un tunnel, au-dessus duquel le nom de la station était peint en lettres noires sur fond jaune : UMTËKAGI, un prénom féminin. Les miliciens attendirent le train pendant plusieurs minutes sur un quai, où une demi-douzaine d'hommes barbus en haillons, et deux ou trois femmes aussi sales qu'eux, s'enfuirent cheveux au vent en les voyant arriver. Une vision aussi choquante qu'un nid de cafards pour Vincent, qui avait commencé sa carrière de milicien comme chasseur de clochards. Le trajet, avec ses deux changements, parut interminable à Vincent et à ses camarades. Tout le monde était fatigué et avait faim et soif. Les wagons étaient presque vides, ce qui est rare à Dibadi. Les autres voyageurs, qui évitaient leur regard, avaient l'air pauvres et amaigris. Certains dormaient, affalés sur les sièges. Vincent se demanda si ce n'étaient pas des sans-logis essayant de dissimuler leur situation en voyageant sans cesse toute la nuit. Des impulsions contradictoires se mêlaient en lui. Il y a avait le milicien, dont le réflexe était de faire son travail, quel qu'il soit, et ce travail, socialement nécessaire, consistait à éliminer de Dibadi les clochards qui la parasitaient comme des poux humains. Mais il y avait aussi le Vincent d'autrefois, qui compatissait aux malheurs des malchanceux de la vie et qui aurait voulu les aider. Les miliciens arrivèrent enfin à la caserne. L'adjudant de permanence les attendait, et les obligea à déposer leurs armes à l'armurerie avant de les autoriser à se rendre aux cuisines pour un dîner tardif. Le froid avait aiguisé l'appétit de Vincent et de ses compagnons, et ils avaient tellement faim qu'ils en avaient des vertiges. Akohi, notamment, qui n'avait que dix-sept ans, avait visiblement du mal à tenir debout. Dans les cuisines, les cuistots, de mauvaise humeur parce qu'ils avaient dû les attendre pendant des heures, leur servirent de grands bols de soupe chaude aux légumes et à la viande, et du pain. La nourriture avait un goût sucré, chimique, même la viande, comme toujours à Dibadi. Comme boisson, ils n'avaient que de l'eau tiède, au goût douceâtre. Dans les casernes de la milice les boissons alcoolisées sont interdites pendant le service, sauf exception autorisée par le colonel. Le ventre rempli de bonne soupe chaude, Vincent se détendit. Avec un verre ou deux d'otlakhya, le repas aurait été parfait. Akohi, assis à côté de Vincent, souriait. Les miliciens étaient heureux, comme on est heureux lorsque on a bien mangé après avoir eu faim depuis des heures, et qu'on est rentré chez soi après une mission de plusieurs mois où l'on a fusillé des gens tous les jours, une tâche désagréable mais nécessaire, et finalement facile quand on s'y est habitué. Personne ne parlait du caporal abandonné dans la campagne par le commandant. Vincent se demanda s'il était le seul à y penser. Il imaginait le caporal marchant vers Dibadi le long de la voie dans la nuit noire et glacée, avec la lune comme repère. Avec un peu de chance il avait pu attirer l'attention de klelwaks en patrouille, ou atteindre une petite gare de campagne, une de ces gares du Niémélaga où on ne trouve que des robots et des klelwaks, et y attendre le prochain train. Mais s'il avait été malchanceux, le caporal était en ce moment même en train de mourir gelé, recroquevillé sur le bas-côté. À l'aube, les rats des champs et les corbeaux en feraient leur festin. Ils commenceraient par le visage et les mains, les parties non protégées par les vêtements. Les rats remonteraient par les manches, le col et les jambes de pantalon, et se creuseraient des tunnels dans la chair rouge et molle. Chim et Vincent quittèrent la table assez rapidement. Ils avaient tous les deux des femmes qui les attendaient. Vincent pensait de nouveau à Diletyet. Elle était sûrement dans leur studio, en train de l'attendre depuis des heures, allongée toute habillée sur le lit mais trop agitée pour dormir. Arrivé devant la porte de son studio, à l'autre bout de la caserne, Vincent sonna, mais personne ne répondit. Il ouvrit la porte avec sa clé. Heureusement, il ne l'avait pas perdue à Tosztihi. Le studio était plongé dans l'obscurité. Vincent alluma la lumière, un peu inquiet. Diletyet n'était pas là. Il y avait une feuille de papier sur la table. Vincent la ramassa. Diletyet avait écrit quelques lignes, visiblement en s'appliquant, de sa grande écriture arrondie : Mantolo. Je m'en vais. Je sais ce que tu fais à la frontière, avec le commandant Mindi. Même les autres officiers le méprisent et le détestent. C'est un criminel en uniforme. Les gens racontent des choses horribles sur lui. Tu es devenu comme lui, c'est pour ça que tu as été nommé sergent. Je ne veux pas vivre avec un assassin. Tu as choisi de faire ce que tu fais. Vous tuez des gens désarmés, des gens qui ont faim. Mindi oblige des femmes à coucher avec vous et il les fait tuer ensuite. Je sais tout. Tout le monde sait tout. Patlisztada.Choqué, Vincent se vit ouvrir l'armoire, regarder même dans la minuscule salle de bains. Diletyet était partie avec ses affaires. Mais quand ? Sa lettre n'était pas datée. Il s'assit sur le lit. Il savait qu'il aurait dû pleurer, tout sergent de la milice qu'il était, mais il n'y arrivait pas. Une phrase courait dans sa tête : "Un milicien du bataillon Mindi ne mérite pas la pitié. Nous sommes des tueurs." Son coeur battait à grands coups. Il se dit que Diletyet n'était pas la seule femme à Dibadi, il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres. Des fantasmes de vengeance lui traversaient l'esprit. Il se vit en train de fusiller Diletyet. À Tosztihi il arrivait que des miliciens particulièrement stupides tirent dans le visage des condamnés. On voyait le sang jaillir, les pauvres types hurlaient de douleur. Vincent se mit torse nu, ouvrit la fenêtre et s'allongea sur le lit. L'air venu du dehors tomba sur lui comme une douche froide. Exactement ce dont il avait besoin. Au bout d'une heure, il n'y tint plus et il referma la fenêtre, avant de s'endormir d'un sommeil de plomb, blotti sous la couverture. Ce n'est que le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, que Vincent se rendit compte que sa vie ne serait plus jamais la même. Ses camarades lui demanderaient où était Diletyet, et il répondrait : "Même les bonnes choses ont une fin. Ça n'allait plus vraiment entre nous." Il ne mentirait pas, ce serait inutile. Mais il devrait garder sa dignité, cacher sa tristesse. Il était un sergent de la milice, un sergent du bataillon Mindi, et ce n'était pas rien. Une ritournelle familière lui traversait l'esprit : Kopa piyu, haiu 'mgoda, haiu 'mgoda.Dans la foule, y'en a des femmes, y'en a des femmes. Il essaya de se préparer un petit-déjeuner mais il n'avait pas faim. À huit heures du matin il se rendit machinalement sur la place d'armes, où les miliciens qui n'avaient pas de travail précis à faire devaient se rassembler pour y attendre les ordres. Il faisait encore nuit et les lampadaires entourant la place étaient allumés. Le sous-lieutenant Chim était là, avec les miliciens de sa section, qui continuaient d'arriver. Le capitaine Baltë était là aussi, toujours aussi gros, rougeaud et essoufflé. Le cérémonial familier commença. Chim et Vincent rassemblèrent la section et la mirent au garde-à-vous pour le salut au drapeau, le drapeau niémélagan à bandes horizontales rouges et noires, avec un oiseau blanc stylisé au milieu. Le capitaine fit cesser le garde-à-vous. Les miliciens crièrent tous ensemble : "Niémélaga !" et se mirent au repos, les jambes légèrement écartées et les mains dans le dos. Le capitaine Baltë, selon son habitude, leur fit un petit discours : " Chetencheda, je sais que vous êtes fatigués, de retour de la zone frontière. Mais la milice est une bonne mère, vous allez pouvoir vous reposer pendant trois jours. Ensuite vous allez changer de zone d'action. Cette fois-ci vous irez vers le nord-ouest, vers la frontière padzalandaise. Les Padzalandais n'apprécient pas que nous gardions nos récoltes pour nous, ils veulent que le Niémélaga continue de leur envoyer des produits agricoles et de l'électricité, car c'est ce qui est prévu par le protectorat. Ils crèvent de faim, ils ont besoin de nos céréales et de nos légumes, mais nous aussi on a besoin de manger, et la guerre nous a fait perdre un bon quart de nos récoltes. C'est pour ça qu'on ne leur envoie plus rien. Je ne sais pas comment ça va tourner avec le Padzaland, personne n'en sait rien, mais le bataillon Mindi va toujours là où Taïa regarde." Taïa est le dieu chinook de la mort, et l'une des divinités amérindiennes dont le nom a été conservé par la religion konachoustaï, à laquelle tout le monde doit adhérer au Niémélaga. Vincent se dit qu'il aimerait bien fusiller le gros capitaine. Il y eut des murmures parmi les miliciens. Le jeune Akohi sifflait entre ses dents. Baltë, qui était officier depuis longtemps, comprit tout de suite que son allocution n'avait pas plu. Les mains sur les hanches, il fit face à la section d'un air bravache : "Juste un dernier mot, chetencheda. En temps de guerre, on ne retourne pas dans le civil. On reste, et on obéit jusqu'à ce qu'on soit autorisé à partir. Sinon, ça s'appelle de la désertion, et c'est puni de mort. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Nos vies ne nous appartiennent plus, elles appartiennent au Niémélaga, notre patrie. Je vais même vous apprendre quelque chose, chetencheda. Le commandant Mindi a, par privilège spécial, droit de vie et de mort sur ses troupes, et ses troupes, c'est vous. Maintenant, rompez !" Les miliciens se dispersèrent par petits groupes en murmurant. Chim faisait grise mine. "Cette fois-ci, ce ne sera pas comme à Tosztihi" dit-il à Vincent. "Il y aura de la casse..." | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Jeu 20 Jan 2011 - 13:44 Jeu 20 Jan 2011 - 13:44 | |
| J'ai l'impression de me répéter mais bon...
j'adore ! |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Mar 25 Jan 2011 - 17:03 Mar 25 Jan 2011 - 17:03 | |
| Merci, Manildomin !  Une étape nécessaire : Tsaiazskochëk (prononcer : TSA-yass-ko-tcheuk). Quamis Mindi prend un galon de plus, et le jeune Akohi devient un milicien aguerri. ---------------------------- Quatre jours plus tard la section fut rassemblée de nouveau avant l'aube sur la place d'arme par le sous-lieutenant Chim et son adjoint, le sergent Mantolo Haiakkhuch, autrefois prénommé Vincent. Chaque milicien portait son paquetage complet, avec un sac de couchage et un fusil d'assaut, sauf Chim qui en tant qu'officier avait seulement un pistolet automatique. Ils montèrent tous dans des camions peints en marron, couleur des uniformes de la milice, et ils partirent, phares allumés, dans la direction du nord-ouest par l'un des larges boulevards concentriques de Dibadi. Les kopikhada (cafés) étaient déjà ouverts. Les camions traversèrent la ville encore endormie, puis la banlieue et enfin la campagne, avec ses champs de terre brune sous le soleil hivernal et ses exploitations agricoles espacées. On ne voyait pas d'oiseaux, les produits chimiques dont la terre était saturée les ayant presque tous fait mourir. Vers midi, les miliciens prirent un repas froid dans les camions et ils purent se dégourdir un peu les jambes, avant que Chim ne donne l'ordre de remonter dans les camions. En fin d'après-midi, alors que le soleil était déjà bien bas à l'horizon, ils s'arrêtèrent dans ce qui avait dû être un centre agricole ou industriel, avec les inévitables hangars et quelques bâtiments de béton, sans étage, de construction plus récente. "Nous sommes arrivés" dirent les chauffeurs. Le lieu s'appelait Tsaiazskochëk, ce qui signifie la mare au démon. Il n'était habité que par quelques klelwaks, qui portaient des insignes de l'armée sur leurs uniformes verts. Ils étaient chargés de l'entretien des bâtiments et de la réception des approvisionnements en nourriture, armes et matériels divers, et de la gestion de l'armurerie et des stocks. Il y avait des camions partout, et des dizaines de miliciens que Vincent ne connaissait pas vaquaient à leurs occupations en discutant par petits groupes. Le lendemain, Vincent apprit que le bataillon était devenu un régiment de quatre cent miliciens, la moitié de l'effectif d'un régiment normal, divisé en trois bataillons. Chaque bataillon regroupait quatre sections de trente à trente-cinq hommes chacun et était dirigé par un capitaine. Vincent s'aperçut, à son grand déplaisir, que la section Chim faisait partie du bataillon du capitaine Baltë. Ce dernier faisait triste mine. Il était évident que sa nouvelle affectation lui avait été imposée contre sa volonté. Vincent ne put s'empêcher de sourire. Les camions étaient tous repartis. Ils revinrent dans l'après-midi, avec le ravitaillement. L'un des chauffeurs, qui était probablement un cyborg malgré son uniforme de milicien, dit à Vincent que le ravitaillement se faisait quotidiennement, depuis un dépôt de l'armée situé à une trentaine de kilomètres. Les chauffeurs étaient des miliciens détachés auprès de l'armée avec leurs camions. Le régiment n'avait pas de section de commandement et des services. Chaque section se gérait elle-même, ce qui dans les faits signifiait que tout le monde faisait du camping dans les hangars non chauffés, dormant dans les sacs de couchage et faisant sa cuisine sur place. Les communications se faisaient par talkie-walkie. Apparemment les appels parvenaient à une intelligence artificielle qui gérait et enregistrait les communications. Il était ainsi possible d'appeler un numéro de téléphone à Dibadi. Les talkies-walkies étaient considérés comme des armes et donc gardés dans l'armurerie. Seuls les officiers et sous-officiers avaient le droit de les utiliser. L'intelligence artificielle, que tout le monde appelait "État-Major", était sans doute dissimulée quelque part dans un endroit secret, à l'abri des bombes, bien loin de Tsaiazskochëk. Les officiers et sous-officiers lui faisaient des rapports quotidiens et recevaient des instructions en retour. La section de Chim avait été renforcée de deux sergents et d'un adjudant. Ce dernier, Chon Limatën, un mulâtre trapu d'environ trente-cinq ans, devenait de par son grade l'adjoint de Chim à la place de Vincent, qui était le plus jeune et aussi le moins ancien des sergents, et donc rétrogradé de fait de la deuxième à la cinquième place dans l'organigramme de la section. Mindi arborait avec une satisfaction non dissimulée ses nouveaux galons de lieutenant-colonel, qui, expliquait-t-il à tout un chacun, étaient provisoires : en tant que chef d'un régiment il devait passer colonel, mais le règlement de la milice lui imposait au moins un an dans chaque grade d'officier. Au bout de quelques jours, Chon Limatën et les deux nouveaux sergents confièrent à Vincent qu'ils avaient été affectés dans le régiment de Mindi à cause de leurs mauvais états de service. Un séjour de quelques mois dans ce qui était de fait le régiment disciplinaire de la milice devait leur permettre de se faire pardonner leurs insuffisances passées. Les nouveaux adjoints miliciens, au nombre d'environ deux cents, avaient été recrutés dans les centres d'hébergement pour clochards et parmi les chômeurs les plus désespérés. Certains d'entre eux ne se lavaient jamais, et Vincent était effaré qu'on ait simplement songé à leur donner des armes à feu. Mais Chon Limatën lui dit qu'ils avaient tous été testés sur leur condition physique et leur état mental. On n'avait écarté que ceux qui n'étaient pas assez robustes et les malades mentaux avérés. "Mais on a gardé les illettrés" ajouta Limatën avec un soupir. "La moitié des nouveaux sont incapables de lire une phrase complète en dibadien. Il va falloir nommer caporaux ceux qui savent lire une carte. La formation va être très, très basique : reconnaître les grades, marcher au pas, tirer au fusil, saluer les supérieurs. Pas question de leur apprendre à lancer des grenades, on aurait trop d'accidents." La formation des nouveaux dura un mois. Vincent fut mis à contribution comme moniteur de tir. Il s'aperçut que certains des nouveaux les plus obtus n'avaient qu'un vocabulaire extrêmement réduit, et parfois même un accent étranger très marqué. Les problèmes de discipline commencèrent dès le début, et Mindi montra à ce sujet un manque d'autorité surprenant. Les nouveaux buvaient trop d'alcool, même selon les critères très laxistes de la milice, et surtout ils ne s'arrêtaient de boire que lorsqu'ils étaient ivres morts. Ils n'avaient aucune notion des horaires, beaucoup d'entre eux ne sachant même pas lire l'heure. La nuit, dans les dortoirs, les plus faibles étaient battus, parfois violés ou carrément torturés. Un jeune adjoint milicien se suicida au champ de tir en se tirant une balle dans la bouche avec son fusil, un autre s'ouvrit les veines du poignet dans les latrines. Le régiment n'ayant pas de médecin, seulement quelques miliciens-infirmiers, le pauvre garçon mourut faute de soins adéquats. Trois ou quatre recrues désertèrent et disparurent dans la campagne. Le camp n'avait pas d'installations sportives et l'entraînement physique se faisait en uniforme. Il consistait en marches sac au dos, jogging et gymnastique. Le niveau physique de la troupe était plutôt faible. Les anciens clochards en particulier, même jeunes, manquaient de souplesse et de résistance. Ils étaient souvent peu musclés et prématurément vieillis par l'alcool et les nuits passées dans la rue. Et surtout, ils manquaient terriblement de volonté. Vincent avait toujours peur d'un accident au stand de tir avec les nouveaux, qui lui semblaient plus bêtes et plus caractériels les uns que les autres. Les autres moniteurs partageaient ses craintes, et ils avaient décidé, d'un commun accord, d'être toujours deux lors des séances d'instruction : l'un pour expliquer, et l'autre l'arme à la main, prêt à tirer si l'un des adjoints miliciens tournait son fusil contre le moniteur. Les séances d'instruction étaient courtes, mais éprouvantes. Les moniteurs criaient sans cesse et ne cachaient pas leur hostilité et leur mépris envers les idiots qu'ils étaient censé transformer en vrais miliciens. Vincent savait que c'était la peur qu'il ressentait qui le rendait hostile et méprisant. Il espérait que la violence bestiale des recrues se transformerait en ardeur au combat face à l'ennemi, mais au fond de lui-même il en doutait. Il pensait souvent à Diletyet, mais de plus en plus son image devenait floue, tellement elle était étrangère à la pesante réalité du régiment Mindi, cette communauté d'hommes dangereux, des asociaux que Mindi, qui était à sa façon le pire de tous, essayait de transmuer en un outil de mort au service des cyborgs. Vincent pensait sans cesse au jour où il pourrait rentrer chez lui, à la caserne, et trouver une nouvelle femme, celle avec laquelle il fonderait une famille. Il n'avait que vingt-deux ans, mais lorsqu'il se regardait dans le petit miroir qui faisait partie de son paquetage, en se rasant le matin, il voyait deux rides chaque jour plus profondes de chaque côté de sa bouche, dans un visage amaigri et dur. Il était conscient du fait que le stress, l'alcool, et le mauvais sommeil dans un hangar glacial, accéléraient son vieillissement. Le capitaine Baltë avait essayé d'obtenir un semblant d'ordre en faisant mettre aux arrêts les fauteurs de trouble, qui terrorisaient leurs camarades. La mise aux arrêts consistait à rester enfermé, pendant vingt-quatre heures ou davantage, sans eau et sans nourriture, dans un réduit sans lumière, uniquement meublé d'un seau d'aisance. Dans les réduits régnait une odeur insupportable de sueur humaine et d'excréments. Les punis commençaient souvent par crier, ou même pleurer, et ensuite ils se calmaient et ils s'endormaient accroupis sur le sol. Quand ils se réveillaient, certains d'entre eux gémissaient par intermittence pendant des heures, dans le vain espoir d'attendrir ou de lasser leurs gardiens. La punition, en tout cas, semblait plus efficace que les coups, que certains sous-officiers distribuaient généreusement. Certains cas difficiles passaient plusieurs jours d'affilée aux arrêts. Le bruit courait que le régiment serait envoyé tout de suite au combat, dès que la guerre serait déclarée, pour que tout le monde comprenne qu'il fallait "se tenir tranquille et obéir aux ordres." Mindi était désagréablement familier et vulgaire avec ses subordonnés. Il buvait comme un trou et il en était fier. De temps en temps il avait l'air de se rendre compte du désordre inacceptable qui régnait dans ce qui était son régiment, et il faisait mettre aux arrêts quelques adjoints miliciens qui lui avaient été désignés comme insolents ou récalcitrants. Suite à une série de désobéissances graves qui auraient pu dégénérer en mutinerie, Mindi fit fusiller trois recrues "pour l'exemple". Vincent se souvint alors de ce qu'avait dit Baltë : Mindi avait, par privilège spécial, droit de vie et de mort sur ses troupes. La section Chim, considérée comme fiable, fut chargée d'effectuer les trois exécutions. Un peloton de cinq hommes suffirait. Vincent, qui avait dirigé plus d'exécutions à Tosztihi que n'importe qui d'autre, fut chargé de la corvée, pour laquelle il sélectionna cinq miliciens de la section, dont Akohi. L'adolescent supportait mal l'ambiance éprouvante du camp, et souvent il cherchait refuge auprès de Vincent. Ce dernier, en retour, espérait qu'Akohi lui serait loyal. C'est avec satisfaction qu'il vit qu'Akohi avait compris leur accord tacite. Sa main ne tremblait pas lorsqu'il appuyait sur la détente, et il visait le cœur. Et pourtant, cette fois-ci, il ne s'agissait pas de tuer des étrangers déguenillés au langage incompréhensible, mais des camarades qui avaient fauté. Et quoi qu'ils aient fait, ils avaient certainement commis moins de scélératesses à eux trois que Mindi tout seul. Les trois exécutions eurent lieu l'une après l'autre, après le petit-déjeuner. Les trois condamnés, ligotés, les jambes entravées et un sac sur la tête, étaient des caractériels détestables, sans aucun sens de la dignité, de vrais asociaux. La peur de la mort les possédait comme un démon chinook, ils hurlaient des insultes aux miliciens du peloton. L'un d'eux pleurait et suppliait. Vincent n'avait jamais vu des condamnés réagir comme ça. Ces trois-là étaient bien nourris, ils n'étaient pas résignés à la mort comme les crève-la-faim de Tosztihi. "Il faut s'occuper du premier. Le moustachu à la grande gueule d'abord, ça calmera les autres" dit Vincent. Avec l'aide d'un autre milicien il tira le condamné récalcitrant jusqu'au poteau des exécutions, auquel il l'attacha avec une corde. Ce ne fut pas un travail facile, l'homme essayait de donner des coups de coude, de genoux et de tête malgré ses liens. Une fois solidement attaché, il devint muet, mais se tordit contre le poteau avec désespoir en essayant de desserrer ses liens. Trente secondes et cinq détonations plus tard l'homme était mort. Vincent le détacha du poteau et fit mettre son cadavre de côté. Les deux autres condamnés, qui n'avaient rien vu à cause des sacs qu'ils avaient sur la tête, mais qui avaient entendu les ordres d'exécution et les coups de feu, étaient devenus subitement silencieux. L'un d'eux souilla son pantalon. Dix minutes plus tard, ils gisaient tous les deux dans l'herbe, morts, à côté du cadavre de leur camarade. Le régiment n'avait pas de chapelain, mais l'adjudant Chon Limatën connaissait les paroles rituelles. Il les récita avec la gravité d'usage, devant les miliciens au repos et tenant leurs fusils par le canon, crosse au sol. Limatën termina le rituel par un laïus improvisé : " Patlisztada, camarades. Vous êtes retournés à l'indifférencié, vous ne faites plus qu'un avec l'univers. Vos pensées sont mortes avec votre cerveau, mais l'univers, éternel et sans commencement ni fin, est toujours là. Vous existez encore par les effets de vos actions, par les conséquences de vos actes, et dans la mémoire des hommes. Adieu camarades, que la paix de l'éternité soit avec vous." Vincent ne put s'empêcher de sourire. Telle était la sagesse de la religion konachoustaï : si tu meurs, je te pardonne. Il remarqua aussi que Limatën avait utilisé le terme tsatsoauda (camarades, littéralement frères de la lance), et non pas chetencheda (citoyens). Les trois condamnés restaient des miliciens, au-delà de la mort, même si de leur vivant ils avaient été indignes de leur uniforme. "Vous êtes morts et je vous pardonne" pensa Vincent en regardant les cadavres, et ses yeux s'embuèrent. La seule différence entre lui et les morts qu'il regardait, c'était que lui, il faisait le mal sur ordre, pour le Niémélaga, pour Dibadi. Une mission sacrée qui justifiait tout, comme État-Major ne cessait de le lui rappeler lors de leurs conversations par talkie-walkie. État-Major... Une intelligence artificielle. Vincent était devenu dépendant de ces conversations. État-Major savait tout, comprenait tout, et il était toujours prêt à aider, à écouter. Il avait expliqué à Vincent comment il pouvait gérer son stress et ses angoisses, comment il pouvait progressivement se libérer de l'alcool. Après le travail, Vincent marchait tous les jours, seul, jusqu'à une ferme située à environ un kilomètre du camp. Il n'y avait que des klelwaks dans cette ferme. Vincent s'asseyait sur un tas de pierres, malgré le froid, et il appelait État-Major. Après une demi-heure de conversation, parfois une heure entière, il rentrait au camp, rasséréné. | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Ven 18 Fév 2011 - 21:36 Ven 18 Fév 2011 - 21:36 | |
| Bonjour Vilko. Pour commencer, encore et encore bravo! Ton histoire est très prenante. Ensuite, je précise que je ne suis pas encore parvenu à lire l'ensemble du texte (le temps m'a manqué) mais la moitié que j'ai lue m'a bien accroché et il est clair que 1- je vais aller jusqu'au bout en prenant mon temps et 2- j'ai déjà prévu que le Lapin de Pâques m'offre Epépé à la place de bêtes œufs en chocolat  . Et justement, l'ensemble m'a paru tellement bon, que je ne puis m'empêcher de me poser des questions, d'avoir des remarques à faire, de me gratter vigoureusement le sinciput  . Aussi, je me positionne ici comme un lecteur lambda qui n'a pas lu Epépé et qui ouvre un bouquin qui s'appelle "Comment Vincent apprit le dibadien." Tout d'abord, je m'interroge sur la forme du récit. Au début de l'histoire, nous avons un personnage principal (Vincent) qui se situe dans une trame chronologique et avec une finalité: les évènements sont racontés dans l'ordre où ils arrivent et Vincent nourrit l'espoir d'intégrer Dibadi. Le fait de raconter chronologiquement donne un sens : on désire savoir ce qui se passe... après, et la finalité: un but. Tout est donc très clair. (Je veux dire par là que tu ne brouilles pas intentionnellement les pistes ; dans ce qui suit il n'y a ni jugement, ni échelle de valeur : tout est à l'appréciation de l'auteur!) Mais au fil des chapitres, cela se dilue lentement pour disparaître peu à peu. On en arrive à des chapitres qui s'autosuffisent et qui, au gré du lecteur pourraient être lus dans le désordre. Il n'y a plus au sein de l'histoire ni but, ni sens (=direction). Ce n'est pas négatif. Mais est-ce la volonté de l'auteur? Car en fait, le lecteur, alors qu'il suivait l'évolution d'un personnage dans le temps (modelé par les actions, les faits, les décisions), suit un personnage qui se remodèle en fonction d'une situation donnée qui n'évolue plus (la société dibadienne est par essence figée) et où lui seul doit faire ses choix, mais choix qui ne vont pas l'ammener à changer, mais simplement à se renforcer ou à se diminuer (vis-à-vis de l'univers dans lequel il évolue). Je crois que le passage s'opère lorsqu'il devient milicien (policier. Je pense à policier car milicien à plus un sens militaire et policier un sens... administratif, disons ; et c'est ce qui semble ressortir des deux premières pages.) Est-ce voulu? Car si l'on oublie ton en-tête : - Citation :
- Comment des gens venus de partout sont-ils arrivés à Dibadi et ont-ils perdu leurs racines ?
il est assez facile de se perdre et de se demander : mais où l'auteur veut-il en venir?? Vincent se perd-il dans Dibadi? Le seul fait de devenir policier semblerait le prouver, non? Un policier défend l'ordre établi. Il n'est pas là pour donner son avis ou le changer (l'ordre). Il représente le type de société dans lequel on vit car il le défend. Le fait pour Vincent de devenir policier présume son assimilation et l'objectif atteint de l'auteur. De tout ce qui suit, une question : est-il plus dans ton idée (te faire plaisir) de raconter des chapitres qui vont éclairer un monde, une société, sa langue, via un personnage qui s'intègre..., ou au contraire, après une parenthèse de temps, d'abscence de chronologie qui peut indiquer une dissolution des repères, de reprendre le court du temps pour écrire un roman, c'est-à-dire nous ammenant à un achèvement de Vincent, ou à tout le moins vers une finalité qui peut ne pas être celle de Vincent? Je reprends la citation et me demande : Comment des gens peuvent-ils perdre leurs racines, leurs valeurs? Même en le souhaitant!! Ce me paraît être un objectif bien difficile. Je pense (mais je me trompe souvent) qu'un adulte reste ce qu'il est (à moins d'être reconditionné par des drogues et des techniques de reconditionnement... Quelque part, ton texte m'a beaucoup fait penser à "1981".) Il peut s'adapter, s'intégrer, mais ce qui fut son enfance, son adolescence, ses souvenirs, la manière dont il fut élevé, dont il grandit, le moule à tout jamais. Il peut changer, mais il ne peut devenir. Tenter de perdre son moi, c'est jouer dangereusement avec la schisophrénie, non? D'un point de vue du ressenti, lorsque je lis ton histoire, je ressens l'acculturation de Vincent comme un drame, comme une agonie muette. Vincent s'enfonce dans quelque chose qui au lieu de lui faire changer de culture, le déshumanise (l'épisode avec les clochards). Il a voulu, il subit et il accepte parce que c'était son choix, même si moralement, le choix devient discutable. Qu'en penses-tu? Changeons de sujet. Il y a une chose qui me chagrine beaucoup, c'est le contexte planètaire que l'on a bien de mal à définir. Je pense que c'est intentionnel, mais personnellement, cela m'empêche de comparer par l'analyse Dibadi avec l'extérieur. Je ne peux la mesurer qu'à l'aune d'elle-même et à la socité dont elle est issue, la nôtre (même si cette autre a été transformée par les cyborgs.) Alors bien sûr, nous sommes dans une histoire d'anticipation (2051+ environ). Il y a un gaz intelligent (j'y reviendrai), des cyborgs, etc... Le futur proche, donc. Mais pourquoi, au nom de tous les dieux, les gens fuient-ils vers Dibadi????? Que savons nous : des guerres, des dictatures, des femmes exploitées et vendues, des peuples éradiqués, internet qui ne fonctionne plus. Tout cela a besoin d'une explication plausible car le phénomène est planétaire. Comment en Europe pourrait-on en arriver là? Car je pense que Vincent est français (le prénom peut être donné dans plusieurs pays mais son livre de départ est en français et je crois bien me souvenir que Dibadi est en France.) Des dictatures planétaires, des famines partout, etc... Il faut une catastrophe, une apocalypse, un truc terrible (comme dirait Nicolas, le petit.) Or, une telle catastrophe doit marquer les esprits, les âmes, l'environnement. Vincent en aurait eu des traumatismes visibles - ce qui n'est pas le cas. C'est donc ancien, plus ancien que lui : 2030, 2040 et l'on serait en 2060, 2070... Mais des personnages d'environ 40 ans devraient s'en rappeller et il devrait y avoir des traces visibles (ou invisibles mais palpables) d'une telle catrastrophe. Or, rien ou pas grand chose (je pense à internet, mais cela me paraît bizarre)... Il est dès lors plus difficle de croire en cette société dibadienne qui se veut actuelle et réelle, au sein d'un environnement, d'un univers qui lui, ne le paraît pas ou plus ou pas assez pour le lecteur... Mais peut-être y a-t'il une volonté particulière de n'en rien dire. Néanmoins si en dire peu présente son intérêt, en dire trop peu peut aussi ruiner la construction. L'équilibre n'est pas simple et je sens un désir de huis clos. Est-ce que je me trompe? En tous les cas, ma réflexion sur ce sujet est loin d'être épuisée. Mais je pense que j'en ai déjà trop dit, comme d'habitude. Cela dit, je reviendrai...  J'ai hâte d'aller lire la suite, Amicalement, Akorion |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  | |
| |
|   | | | | Comment Vincent apprit le dibadien |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
