|
| | Comment Vincent apprit le dibadien |  |
| | |
| Auteur | Message |
|---|
Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 20 Juin 2009 - 20:51 Sam 20 Juin 2009 - 20:51 | |
| Un extrait d'Épépé, un roman dont j'ai déjà parlé : - Citation :
- (...) Les rues, l'hôtel, la circulation, les véhicules, le métro : tous exactement ou approximativement les mêmes que dans n'importe quelle grande ville. Le mode de vie, son rythme, les magasins, les buffets, la cuisine, l'économie monétaire et le fait qu'on lui ait changé son chèque de voyage; les chiffres arabes et l'usage du système de calcul à base dix. Tout comme le découpage du temps en semaines, le dimanche férié, etc.
La métropole ne se singularise que par trois choses : sa langue, opaque et incompréhensible, son alphabet, inconnu ailleurs, et sa religion, purement locale. Comment des gens venus de partout sont-ils arrivés à Dibadi et ont-ils perdu leurs racines ? C'est ce que je vais tenter de raconter... Vincent avait dix-neuf ans. Il est inutile de rappeler pour quelles raisons il avait décidé de quitter son pays: il a toujours été assez vague dans ses explications, se contredisant même, parfois. Certains racontent qu'il avait commencé d'apprendre le dibadien en prison, mais c'est certainement faux. En ce milieu du 21e siècle, seule la métropole de Dibadi offrait une opportunité aux candidats à l'immigration . Les conditions étaient simples : il fallait parler, lire et écrire le dibadien, prendre un nom dibadien et se convertir à la religion locale, le konachoustaï. Les dirigeants dibadiens considéraient qu'une population aussi diverse ne pouvait être gouvernée que si elle était culturellement aussi homogène que possible, le monolithisme culturel étant censé contrebalancer l'infinie diversité raciale des Dibadiens. En contrepartie, il n'y avait ni visite médicale, ni conditions de moralité, ni aptitude professionnelle particulière exigée pour les candidats. Les Dibadiens essayaient quand même d'accueillir un nombre à peu près égal d'hommes et de femmes par tranche d'âge. Beaucoup d'immigrants venaient en couple, parfois avec des enfants, mais en généra les hommes étant bien plus nombreux que les femmes à vouloir émigrer. C'est pourquoi le gouvernement dibadien avait conclu un accord avec un certain nombre de pays : les femmes pouvaient immigrer plus facilement, sous la seule condition de parler, un peu, le dibadien, et d'accepter de changer de nom et de religion. En ce siècle où la population mondiale avait commencé à diminuer, souvent dans la violence et l'horreur, certains dictateurs en profitaient pour se débarrasser des femmes des peuples vaincus, ce qui leur épargnait la peine d'avoir à les laisser mourir de faim dans des camps, tout en leur rapportant quelques devises. Des peuples entiers ont ainsi disparu. Les femmes, hébétées par le malheur, étaient hébergées quelques mois dans des centres de transit, où des missionnaires konachoustaï tentaient de leur apprendre quelques centaines de mots dibadiens et à reconnaître les lettres de l'alphabet Deseret. Le dibadien étant encore très proche du pidgin dont il était issu, il n'était pas nécessaire de s'appesantir sur la grammaire. Les missionnaires mettaient plutôt l'accent sur l'apprentissage des règles élémentaires de la vie dans une société urbaine : respect de l'autorité, hygiène, usage de la monnaie, utilisation d'appareils électriques et de téléphones portables, que la plupart de ces femmes, en général très jeunes et parfois chargées d'enfants, n'avaient jamais vu. Vincent avait acheté deux livres et un disque compact pour apprendre le dibadien : Le premier livre s'appelait "Eikanem ye Tlatayetgo", le Récit du Voyageur. C'était un petit volume au format "Livre de Poche", d'environ quatre cent pages, avec trente-sept lignes par page et en moyenne sept mots par ligne. Sur la page de gauche, le texte en dibadien : les aventures pittoresques et amusantes de Chim le Voyageur, ses conversations souvent triviales, et en même temps une description de la religion konachoustaï. Celle-ci est fondée sur un panthéisme basique : l'univers est divin, l'homme en fait partie, comme toute chose, et lorsqu'il meurt il retourne à l'indifférencié dont il est issu, comme une goutte d'eau retourne à l'océan. S'y ajoutent des rituels plus ou moins universels, avec un clergé marié et fonctionnarisé, la pratique de la méditation, de la prière aux vieilles divinités chinook, et quelques superstitions en option, comme la croyance aux fantômes et aux démons. Vincent avait souri en lisant, page après page, les passages relatifs au konachoustaï et les descriptions des temples et des cérémonies qui s'y déroulaient dans les vapeurs de l'encens : les prêtres étaient des fonctionnaires, et ils ne croyaient sans doute à rien, mais cela n'avait aucune importance. L'objectif des Dibadiens était d'unifier une population venue de tous les coins de la planète. "Eikanem ye Tlatayetgo" raconte aussi comment les apostats, ceux qui renient le konachoustaï ou refusent de le transmettre à leurs enfants, sont sévèrement punis : les dirigeants Dibadiens n'aiment pas qu'on les prenne pour des idiots. Les 200 pages en dibadien comptaient environ vingt-cinq mille mots, selon les calculs de Vincent. Le livre était écrit en dibadien standard avec un vocabulaire de cinq mille mots. Chaque mot revenait au moins deux fois dans le texte. Il suffisait donc, en théorie, de lire et de relire le livre pour avoir une connaissance au moins passive du dibadien. Ces cinq mille mots sont utilisés par les média officiels (radio, journaux, télévision) et par les services publics. Il est possible de vivre tout à fait normalement à Dibadi en ne connaissant que ce vocabulaire. Les termes spécialisés, qui sont plusieurs centaines de milliers, ne sont connus que des gens qui les utilisent : techniciens, médecins, etc. Il existe aussi un dibadien littéraire de plusieurs dizaines de milliers de mots. Sur la page de droite, la traduction en français, ligne par ligne, et aussi proche du texte dibadien que possible. Vincent s'en servait au début, mais il avait vite choisi de la cacher sous une feuille pour ne pas être distrait. Le deuxième livre était un dictionnaire français-dibadien et dibadien-français, également au format livre de poche, avec en guise de préface une grammaire dibadienne d'une cinquantaine de pages. Le disque compact était le texte de "Eikanem ye Tlatayetgo" lu par plusieurs acteurs avec un accompagnement sonore : bruitage, musique, etc. C'était tout. Vincent avait lu et relu "Eikanem ye Tlatayetgo". Il lui avait fallu des mois pour être réllement familiarisé avec l'alphabet Deseret, d'ailleurs très simple mais souvent imprimé dans des polices de caractère qui ne laissent pas d'espace entre certaines lettres, donnant l'impression d'un grand nombre de signes différents. Il avait écouté et réécouté le disque comptact. Il avait recopié les dialogues et il les lisait à haute voix, jusqu'à les connaître presque par coeur, en imitant la prononciation des acteurs. Vincent avait peur que ce ne soit pas suffisant pour parler couramment la langue. Mais il était seul et à l'époque on ne pouvait déjà plus compter sur l'Internet. Alors Vincent écrivait des listes de questions, et il y répondait à haute voix, en enregistrant ses réponses au magnétophone. Au bout de quelques mois d'exercices quotidiens, il sentait qu'il était à l'aise dans des conversations du style : _ Monsieur, savez-vous où se trouve la rue des Trois Soeurs ? _ C'est la troisième à gauche, juste après la boulangerie. En dibadien, cela donnait : _ Chetenche, nak tlët këmtëk ka Tlun Atsda wehët?
_ Usz tluni sitau, dilet kimta epankha. Vincent faisait aussi des traductions, mais il ne pouvait jamais être sûr de ne pas faire d'erreurs, faute de professeur. Finalement, le jour du passage arriva. Il se rendit au consulat dibadien. Une foule de candidats faisait la queue. Comme lui, ils avaient un sac à dos ou une valise de dix kilos, le maximum autorisé. Au bout de deux heures d'attente on le fit entrer dans un bureau miteux qui sentait l'encre et la poussière. Un homme corpulent et une femme aux yeux clairs l'accueillirent en dibadien avec une politesse de pure forme. L'homme lui fit faire une dictée d'une dizaine de lignes, en articulant les mots avec plus de précision qu'il n'est habituel en dibadien : Otlakh chi mutso siphid esha... Le soleil se levait au-dessus de la montagne... La dictée faisait environ cinq lignes. Vincent était stupéfait de la simplicité de l'exercice. "Maintenant, écrivez la date en dibadien" dit la femme. Vincent fit ce qu'elle demandait. L'homme prit la feuille et y jeta un coup d'oeil : " Ilip tlush... Très bien. Maintenant, vous allez remplir le reste du formulaire, en écrivant votre nom en français" dit-il en lui rendant la feuille. L'homme parlait dibadien, et Vincent était stupéfait de tout comprendre. Même le mot "formulaire", qui en dibadien se dit "papier de questions". Vincent écrivit son nom et sa date de naissance, et indiqua sa taille en centimètres. Il écrivit Hë (oui) en face de la question "Le konachoustaï est-il votre religion ?" Il n'y avait pas d'autre question. Sur les instructions de la femme il appliqua le bout de ses pouces sur un tampon encreur et les pressa sur le formulaire, là où il était écrit en dibadien "pouce gauche" et "pouce droit". La femme l'aida à bien imprimer ses empreintes digitales sur le document et à essuyer ses doigts avec un mouchoir en papier. L'homme écrivit quelque chose sur la feuille, la photocopia et donna la photocopie à Vincent : "Maintenant, vous n'êtes plus Vincent Chafrichetaine, vous êtes Mantolo Haiakkhuch, citoyen dibadien. Je viens de l'écrire sur la feuille. Gardez-la bien, c'est votre billet de transport pour Dibadi et votre carte d'identité. Votre nouveau nom a été choisi au hasard sur une liste faite par ordinateur, j'espère qu'il vous plaît, sinon c'est pareil. Maintenant, sortez par cette porte et suivez les flèches blanches. Vous arriverez dans une cour. Montez dans l'autobus et faites ce que vous diront les Dibadiens en uniforme marron." Cette fois-ci, l'homme s'était laissé aller à parler à un rythme plus rapide. Vincent, dont la tête tournait, devina plus qu'il ne comprit le sens de ses paroles. Ce n'est qu'une fois assis dans l'autobus qu'il se rendit compte de ce qui venait de lui arriver. En quelques minutes, il venait de changer de nationalité et même de nom. Haiakkhuch... loup rapide. Il se dit que cela aurait pu être pire.
Dernière édition par Vilko le Jeu 2 Juil 2009 - 18:17, édité 1 fois | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 21 Juin 2009 - 5:32 Dim 21 Juin 2009 - 5:32 | |
| Juste une question ( mes excuses par avance de ne pas être sûre) : le long texte de Vincent devenant dibadien est-il un extrait du roman Epepe ou bien un texte à toi sur l'inspiration de ce roman ?  |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 21 Juin 2009 - 13:47 Dim 21 Juin 2009 - 13:47 | |
| - Sab a écrit:
- Juste une question (mes excuses par avance de ne pas être sûre) : le long texte de Vincent devenant dibadien est-il un extrait du roman Epepe ou bien un texte à toi sur l'inspiration de ce roman ?
 C'est un texte à moi inspiré par le roman  Depuis mon adolescence (qui ne date pas d'hier) j'ai réfléchi à des histoires basées sur les thèmes suivants : L'exil à 19 ans. J'ai pensé partir vivre dans un pays anglophone quand j'avais 19 ans. Je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre d'idée, vu l'intérêt de Yiuel pour le Japon, par exemple. Mon fils aîné, qui a étudié le japonais, rêvait de vivre au Japon. Finalement il n'y a passé que trois semaines et maintenant il étudie la comptabilité  La langue qu'il faut apprendre pour pouvoir émigrer : le fait d'apprendre une langue étrangère, parlée nulle part ailleurs, servant de test de QI. Le livre unique qui permet à la fois d'apprendre une langue et de se familiariser avec sa culture (j'en ai eu l'idée en lisant un manuel d'anglais qui expliquait aussi comment téléphoner, aller à la poste, dans une banque, etc). Changer de nom, de langue usuelle, de pays, de nationalité, etc. Qu'est-ce que cela fait ? A vrai dire, je pourrais demander à mon épouse, qui a vécu tout cela sans se poser de question existentielle  Il y a aussi un intérêt concernant l'Atelier : d'autres membres ont sans doute écrit des histoires qui se passent dans leur monde construit. Il serait intéressant qu'ils en publient des extraits sur ce forum... | |
|   | | Xé
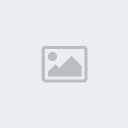
Messages : 190
Date d'inscription : 08/04/2009
Localisation : NANCY
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 21 Juin 2009 - 20:25 Dim 21 Juin 2009 - 20:25 | |
| Très sympa ton texte. J'ai cru au début que tout était issu du livre en question (que je ne connaissais pas du tout).
Ça m'a donné envie de le lire! | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 21 Juin 2009 - 21:49 Dim 21 Juin 2009 - 21:49 | |
| - cebelab° a écrit:
- Très sympa ton texte. J'ai cru au début que tout était issu du livre en question (que je ne connaissais pas du tout).
Ça m'a donné envie de le lire! C'est une excellente idée  http://www.ciao.fr/Epepe__89513 J'ai lu Épépé en juillet 2007 et je ne m'en sépare jamais. J'habite en proche banlieue parisienne, et depuis j'ai l'impression de vivre dans le roman, surtout lorsque je me promène à pied dans Paris ou en banlieue. Le dibadien a été créé après avoir lu le livre. Des mots comme "chetenche" (citoyen, ou : monsieur, madame) et bien sûr "Dibadi" proviennent du livre. J'ai constitué un corpus des mots et phrases en "langue locale" du roman, et j'ai tout retranscrit en dibadien, en imaginant le sens des phrases à partir du contexte. Je pense le publier sur mon site en juillet, pendant mes vacances. Il y a peu de romans qui m'ont fait autant d'effet qu'Épépé. Peut-être "Sur les falaises de marbre" et "Héliopolis" par Ernst Jünger, "La maison aux milles étages" par Jan Weiss et "Rulers of Kings" par Gertrude Atherton. J'ai acheté Épépé pour 3€ à Emmaüs, je peux dire que j'ai fait une affaire  Bon, je viens d'écrire une suite à mon premier texte : Lorsque le dernier candidat fut passé, Mungpan et Tëkoptagi, l'homme et la femme qui avaient fait passer l'examen de passage à Vincent, virent enfin arriver la fin de leur journée de travail. "Quarante-sept candidats aujourd'hui, c'est infernal !" dit Tëkoptagi, la femme aux yeux bleus. "Et il y a quinze bureaux comme le nôtre dans ce bâtiment !" "Je vais faxer les formulaires" dit le gros Mungpan. "Le Ministère de la Population va pouvoir leur ouvrir des dossiers, aux candidats qu'on a sélectionnés aujourd'hui. Je n'ai même pas relu les formulaires... Tant pis. S'il y a des erreurs dedans, on va encore se faire engueuler par le chef." "Il m'énerve, le chef !" dit Tëkoptagi en faisant chauffer du thé sur une plaque électrique. "Il est payé à relire les formulaires remplis par les candidats, et à vérifier qu'on a bien tout faxé à Dibadi ! Facile, son job !" "Tu changeras d'avis quand tu seras cheffe !" dit Mungpan en riant, tout en faisant passer les formulaires par groupe de dix dans le fax. "C'est pas pour demain !" rétorqua Tëkoptagi en remplissant deux tasses de liquide sombre et chaud. "C'est pas croyable" dit Mungpan. "Aujourd'hui, on a eu douze candidats qui ne savaient même pas écrire la date en dibadien. Ils repasseront l'examen dans six mois. Ils devraient savoir qu'on leur demande toujours d'écrire la date !" "Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à mieux se préparer" dit Tëkoptagi en lui tendant une tasse fumante. Puis, sur un ton plus doux : "Je t'ai mis du sucre." "Ah, merci" répondit Mungpan en mettant les quarante-sept formulaires dans un dossier de carton qu'il plaça sur une étagère. Près d'un tiers d'entre eux portaient une mention manuscrite indiquant que le candidat avait échoué. Demain, avant le passage des candidats, Mungpan apporterait le dossier au chef, pour vérification. Et le chef lui remettrait une nouvelle liste de noms masculins et féminins créés par ordinateur. Chaque fois qu'ils attribuaient un nom dibadien à un candidat, Mungpan et Tëkoptagi devaient le rayer de la liste. Il arrivait que des employés négligents attribuent le même nom à deux ou même trois candidats différents, et cela créait la panique à Dibadi, où les employés du Ministère de la Population se voyaient obligés de convoquer les homonymes ainsi créés et de leur donner des prénoms additionnels. Tëkoptagi et Mungpan burent leur thé sans se presser. Le thé du soir était l'un de leurs rares moments de détente de la journée, avant le retour épuisant dans la cohue, en métro et autobus, jusqu'à leurs domiciles respectifs. Le café du matin, dans la cafétéria à côté du bureau du chef, avec la trentaine d'autres employés du Département B du Service de l'Immigration, était plus une conférence de travail qu'un moment de plaisir, et la pause déjeuner était toujours trop courte. "Quand même" dit Mungpan, "Y'a des candidats qui m'énervent, des fois. Ceux qui indiquent que le konachoustaï n'est pas leur religion... Qu'est-ce qu'ils croient, ceux-là ? Que Dibadi est une démocratie ? Ils pourraient quand même se donner la peine de lire les livrets d'information qu'on leur remet avec les bulletins d'inscription ! Pour immigrer à Dibadi, il faut se convertir au konachoustaï !" "On nous le reproche assez dans ce pays !" dit Tëkoptagi en hochant la tête. "A l'école, ma fille n'ose pas dire qu'elle est dibadienne."
Dernière édition par Vilko le Jeu 2 Juil 2009 - 21:29, édité 1 fois | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Jeu 2 Juil 2009 - 17:18 Jeu 2 Juil 2009 - 17:18 | |
| Je viens d'écrire une suite...  -------------------- Les heures passaient, et le car était toujours dans la cour du consulat. Un Dibadien avait expliqué à Vincent et aux autres candidats à l'immigration qu'il fallait attendre la fin de la journée, quand le dernier candidat serait passé. Une employée avait amené une grande théière et des gobelets. Vincent et les autres candidats étaient sortis dans la cour, pour se dégourdir les jambes et discuter. Il y avait très peu de femmes parmi eux. Vincent se retrouva en train de parler avec un homme aux cheveux gris et au visage rougeaud qui aurait pu être son père. "Il ne me reste rien ici" dit l'homme aux cheveux gris. "Je suis divorcé, j'ai perdu mon travail, je n'arrive plus à payer mon loyer... A Dibadi je suis sûr d'avoir un travail, et normalement je retrouverai une femme, il y a autant de femmes que d'hommes parmi les immigrants et elles sont toutes disponibles, comme nous." "Nous n'avons pas encore vu les femmes" objecta Vincent. "J'ai lu que c'étaient des survivantes des massacres de populations dans les pays en guerre, les vainqueurs les vendent aux Dibadiens." "Et alors ?" "Elles n'ont pas la même expérience de la vie que nous. La plupart n'ont pas eu d'éducation, elles ont vu leurs parents et leurs amis se faire massacrer, beaucoup ont été violées ou battues. Elles ont connu la misère, la peur, la faim." "Attend de les avoir vues pour t'inquiéter. J'ai passé les trois dernières nuits à dormir dans un couloir de centre commercial, je n'avais plus un rond pour me payer une chambre. A mon âge, tu te rends compte ! J'en pleure de honte tous les jours. La seule chose qui m'inquiète, c'est l'hygiène... Elles ne doivent même pas savoir ce que c'est qu'une salle de bains !" Vincent décida de changer de sujet de conversation : "Moi c'est Vincent, et toi ?" "Otlakhmin. Métal du soleil, ça me va bien. Je préfère oublier mon nom français dès aujourd'hui. Il ne me rappelle que des échecs." Le soleil commençait à décliner quand le chauffeur dibadien annonça que le départ était imminent. Il fallut aller chercher deux ou trois jeunes gens qui étaient allés aux toilettes, et le long trajet vers Dibadi commença. Une heure plus tard le car s'arrêta devant une gare de banlieue, où un train spécial avait été affrété. Un petit groupe de Dibadiens leur donna des sandwichs et des bouteilles d'eau minérale : leur dîner. Il y avait aussi un groupe d'une cinquantaine de femmes, jeunes pour la plupart, et curieusement silencieuses, portant de gros sacs de toile en bandoulière. Elles étaient de tous les types physiques imaginables, et toutes pareillement vêtues de longues blouses marron qui leur tombaient sur les mollets. La plupart étaient pieds nus dans leurs sandales, malgré la température vespérale un peu fraîche. "Tiens, je crois que voilà nos dames" dit Otlakhmin. "Tu as vu comme leurs cheveux sont courts ? Les Dibadiens ont dû leur raser le crâne pour éliminer les poux. Ils leur ont aussi donné des vêtements décents, quoique peu variés et pas du tout à la mode." "On va voir si elles parlent français ou dibadien" dit Vincent sans conviction. Mais il n'eut pas le temps d'engager la conversation avec les jeunes femmes. Les Dibadiens qui les cornaquaient annonçaient l'arrivée d'une personnalité. Vincent se retrouva avec les autres dans un demi-cercle, regardant un vieillard dignement assis dans un fauteuil roulant. "C'est un sénateur de Dibadi, il a cent cinquante ans !" dit l'un des Dibadiens. Vincent se demanda s'il avait bien compris. Il se tourna vers Otlakhmin : "Il a bien dit cent cinquante ans ?" "Oui, oui, takëmën quinëm tatlëm kolda, cent cinquante ans." Le sénateur manoeuvra avec dextérité son fauteuil électrique et se gara au milieu des immigrants. Vincent l'observa d'aussi près qu'il le pouvait. L'homme était vêtu d'une sorte de robe de chambre à capuchon, de couleur pourpre, dont les longues manches couvraient la moitié de ses mains protégées par un exosquelette articulé. On aurait dit qu'il portait des gants de métal, comme un chevalier du Moyen-Âge. Deux jambes de pantalon noir dépassaient de la robe de chambre. Les pieds chaussés de bottines reposaient sur une plaque de métal. Le visage semblait fait de vieux cuir jaunâtre craquelé. Pas un centimètre de peau n'était épargné par les rides. D'épaisses lunettes de verre fumé dissimulaient son regard. Les montures supportaient deux petits ronds noirs qui étaient sans doute des oeilletons de caméras cybernétiques. Le capuchon de la robe de chambre dissimulait le crâne et les oreilles. Le sénateur portait un casque audio avec un petit micro devant sa bouche sans lèvres. Lorsqu'il parlait, les muscles de ses joues crevassées se contractaient spasmodiquement et ses lèvres s'entrouvraient sur des dents blanches et bien plantées, certainement artificielles. Vincent fut surpris d'entendre une voix forte et profonde, bien qu'un peu rauque et sifflante. Il se demanda où était le haut-parleur : était-il dissimulé dans la minerve que le sénateur portait au cou ? " Tayida pi oquilda... Messieurs et mesdames..." dit le sénateur en dibadien, lentement et en articulant chaque mot. "Mais je devrais déjà vous appeler citoyens ( chetencheda) car vous avez réussi les tests de sélection. Je suis venu rencontrer les dirigeants de ce pays, et j'ai pensé qu'il était bon que je profite de cette occasion pour vous rencontrer vous aussi, et vous souhaiter par avance la bienvenue à Dibadi, où vous serez dans quelques jours. Comme vous le voyez, je suis très vieux, extrêmement vieux, et toujours vivant. Mi-homme, mi-machine. De plus en plus machine, à mesure que les années passent. Même mon cerveau est à moitié machine, maintenant. Mais je suis encore vivant, et chacun d'entre vous a la possibilité, s'il réussit et s'il a beaucoup de chance, de vivre au-delà des limites biologiques de l'animal humain. Comme moi. A bientôt à Dibadi !" Vincent et ses compagnons applaudirent, mollement imités par les jeunes femmes en longues blouses marron, qui n'avaient peut-être pas compris grand chose au discours du vieil invalide. Le sénateur fit faire un demi-tour à son fauteuil électrique se retira parmi les membres de sa suite. Vincent se retrouva dans le train. Il fut déçu d'apprendre que les femmes voyageaient dans des wagons à part. Lorsqu'il se confia à Otlakhmin, ce dernier éclata de rire : "Tu ne pensais quand même pas que les Dibadiens allaient laisser les mariages se conclure dès le premier soir ?" | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 12 Juil 2009 - 20:24 Dim 12 Juil 2009 - 20:24 | |
| Encore un épisode... C'est les vacances et j'ai le temps d'écrire. Cette fois-ci, je parle de la langue dibadienne.
-------------------------
Le train se dirigeait vers l'est. Si tout se passait bien, Vincent et ses compagnons de voyage seraient à Dibadi dans une trentaine d'heures. Il faisait nuit. Vincent et Otlakhmin essayaient de s'endormir sur leur siège, mais ils n'y arrivaient pas. Le hasard avait mis en face d'eux dans le compartiment l'un des Dibadiens qui les escortaient. C'était un petit homme maigre et chauve, aux yeux bleus, vêtu du costume de toile brune caractéristique des Dibadiens.
"C'est assez extraordinaire qu'une langue artificielle comme le dibadien soit devenu la langue maternelle de plusieurs millions de personnes" dit Vincent, qui ne savait pas comment lancer la conversation.
"Oh, ça n'a rien d'extraordinaire, vous savez" répondit le Dibadien. "D'abord, le dibadien n'est pas vraiment une langue artificielle. Il y a plusieurs siècles il existait une langue appelée le jargon chinook, parlée dans le Nord-Ouest de l'Amérique du Nord. Bien plus tard, un groupe de savants, ou prétendus tels, réunis dans une société secrète, a décidé d'utiliser cette langue comme un code pour ses communications internes, qui devaient rester confidentielles. Leurs recherches, étendues sur plusieurs générations, leur ont permis de créer des cerveaux artificiels, comme vous le savez, et ce fut le début de leur puissance. Pour garder ces recherches inconnues de tous, ils avaient besoin d'un code, d'une langue connue d'eux seuls. Comme le jargon chinook n'avait ni un vocabulaire suffisant, ni une grammaire assez développée, certains de ces savants ont pris sur eux d'enrichir son vocabulaire, de perfectionner sa grammaire et de redéfinir sa phonologie. Rien de plus que ce qui a été fait pour bien d'autres langues qui ne sont pas artificielles pour autant, comme le hongrois et le finnois. Je reconnais qu'en ce qui concerne le dibadien, les manipulations linguistiques sont allées assez loin, plus loin que dans aucune autre langue.
Pour finir, l'un des savants, qui se trouvait être un mormon, a proposé d'utiliser l'alphabet Deseret des Mormons, proposition qui a été acceptée. Peu de gens savent lire ou même reconnaître l'alphabet mormon, qui n'a été utilisé que quelques années par les Mormons eux-mêmes."
Vincent secoua la tête : "Quelqu'un qui ne parlerait que le jargon chinook ne comprendrait pas un traître mot de dibadien."
Le Dibadien sourit : "C'est vrai. Disons que les savants qui utilisaient le dibadien dans leur correspondance secrète ont créé leur propre langue, comme les Amérindiens et les trappeurs canadiens et américains ont créé le jargon chinook pour faire du commerce. La création du dibadien s'est faite de façon naturelle, organique, comme celle du jargon chinook. Les savants créaient les mots dont ils avaient besoin et se les envoyaient par courrier. Ils ont développé ce qui existait déjà. La grammaire du dibadien est celle du jargon chinook, avec quelques ajouts : l'article préfixé, une dizaine de suffixes et préfixes, quelques figures de style, comme de dire 'la souris le chat a mangé' comme équivalent du passif français 'la souris a été mangée par le chat'. Tous ces ajouts tiennent sur moins d'une page de livre."
"Et la façon très particulière d'indiquer la date et l'heure !" s'exclama Vincent. "En voila une innovation d'importance !"
Le Dibadien hocha la tête : "Je le reconnais. Mais cela représente juste une vingtaine de mots et peut-être une page d'explication. A propos, je ne me suis pas présenté : je m'appelle Chon Khuchëk."
Vincent se présenta sous son nom dibadien : Mantolo. Il en revint à sa préoccupation première :
"Maintenant, plusieurs millions de personnes parlent le dibadien."
Khuchëk sourit. "Le dibadien est la langue des créatures sorties des laboratoires des savants. Ces créatures, cyborgs et robots, ont créé la ville de Dibadi, et y imposent leur langue. Je dois dire que j'ai joué un rôle dans cette histoire. Le dibadien est la langue des doublages de films et de feuilletons télévisés. J'ai fait des doublages pendant des années. Par exemple, je devais traduire une phrase comme :
Où est-ce que t'étais passé ? Je t'ai attendu toute la soirée !
Cette phrase compte un certain nombre de syllabes, et elle a un rythme particulier. En dibadien, cela donne :
Go ka ati ang tlata? Chi nai mitlaitës patli tlipsan!
Littéralement : Homme où es-tu allé ? J'ai attendu toute la soirée.
Le texte dibadien se dit dans le même espace de temps que le texte français, avec exactement le même nombre de syllabes, et presque la même proportion de syllables ouvertes et fermées. C'est l'idéal pour un doublage de film. Ceci étant, l'acteur qui fait le doublage peut parler plus ou moins vite, si le nombre de syllabes ne correspond pas tout à fait entre les deux langues.
A noter, pour vous qui connaissez la langue depuis peu, que le plus grand nombre de syllabes fermées en dibadien ralentit l'élocution, mais c'est compensé par un nombre plus limité de phonèmes : en dibadien, on n'a pas besoin de prononcer avec autant de précision qu'en français ou en anglais. On peut parler très vite, comme en espagnol, une langue dont la phonologie est encore plus réduite que celle du dibadien.
Vous les immigrants, vous parlez plusieurs dizaines de langues différentes. Mais vous connaissez tous le dibadien, plus ou moins bien, donc vous avez tendance à parler dans cette langue, entre immigrants de langues maternelles différentes. C'est déjà bien, mais pour que la greffe prenne, il fallait, d'une part, faire du dibadien l'équivalent d'une grande langue de culture, comme l'anglais ou le français, et d'autre part livrer avec le dibadien une culture clé en main. Sinon, les immigrants parleraient l'anglais, qui est la langue de l'informatique et de tout ce qui est moderne et attirant à notre époque. Or, le dibadien n'a pas de culture originale. Même sa religion est faite d'éléments composites. Les cyborgs qui gouvernent le pays ont donc décidé d'annexer la culture la plus internationale qui soit, la culture par défaut de la planète entière, celle des aéroports et des feuilletons américains."
Otlakhmin, qui n'avait encore rien dit, intervint dans la conversation :
"Comment êtes-vous passé d'une langue secrète à la langue des feuilletons télévisés ?"
"Ah, ç'a été beaucoup de travail ! Comment dire, par exemple, 'Fais pas chier, connard, ou j't'en fous une' dans une langue qui a été créée, dois-je le rappeler, par des savants pour communiquer entre eux par écrit sur des sujets hautement scientifiques ? En dibadien, cela donne :
Tlush kamuk, pelten, pëswik nai pak!
Littéralement : Bon chien, idiot, sinon je frappe.
Mes collègues et moi, nous étions très satisfaits : nous venions d'inventer une expression idiomatique : Bon chien, pour dire sois gentil, laisse moi tranquille, mais avec beaucoup de mépris et de vulgarité. Elle est entrée dans le vocabulaire dibadien courant, après avoir été utilisée dans les films et les romans policiers. Les immigrants regardent beaucoup de vidéos et essayent de parler comme les acteurs dont ils aiment le style."
Khuchëk se mit à rire tout seul :
"Les gens aiment la musique. Mes collègues et moi nous avons traduit tout le répertoire de Michaël Jackson, dont les chansons sont toujours appréciées si longtemps après son époque. Un chanteur dibadien est devenu riche et célèbre en chantant les chansons traduites par nous, sur la musique originale de Jackson ! Si ça vous intéresse, le Michaël Jackson dibadien s'appelle Taisuk Chonkal. On trouve ses disques dans toutes les boutiques de Dibadi."
Vincent demanda à Khuchëk, qui ne cessait de rire : "Et vous-même, comment avez-vous appris le dibadien ? Je vois que vous êtes francophone d'origine."
Le Dibadien redevint sérieux :
"Comme vous, j'ai passé un examen pour immigrer à Dibadi. Je crois que la première mouture du manuel de dibadien que j'utilisais a été écrite par un cyborg, un robot d'apparence humaine avec un cerveau artificiel."
Dernière édition par Vilko le Mer 21 Oct 2009 - 22:19, édité 1 fois | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 27 Sep 2009 - 20:13 Dim 27 Sep 2009 - 20:13 | |
| Une citation du roman : - Citation :
- Sur les coutumes vestimentaires des gens il n'a rien remarqué de particulier, elles sont très semblables à celles des grandes villes européennes, sinon en moyenne d'une nuance plus grise, plus morne, et on porte davantage divers uniformes.
---------------- La conversation avec Khuchëk continua pendant quelques heures, dévia sur des plaisanteries de corps de garde, et tout le monde finit par s'endormir sur son siège, au rythme des roues du train. Vincent se réveilla à l'aube, plein de courbatures et la gorge sèche. Il se souvint avec inquiétude que le train ne devait arriver à destination que la nuit suivante, bien après minuit. Le compartiment sentait la sueur. Il n'y avait pas de douche dans le train. Vincent appréhendait la journée qui allait se dérouler. Khuchëk venait de se réveiller. Vincent lui demanda d'un ton anxieux : _ Quand est-ce qu'on mange ? _ A huit heures, le train va s'arrêter dans une gare et un chariot roulant va passer dans les wagons. Il est interdit de descendre du train, d'accord ? Avant on laissait les passagers sortir, mais certains en profitaient pour se perdre dans la nature. Nous sommes ici dans un pays étranger, et les autorités locales n'aiment pas les vagabonds. Vincent ne trouva rien à répondre. Il attendit l'arrêt du train en regardant le paysage par une fenêtre du couloir. Champs cultivés, villes endormies où alternaient jolies petites maisons et immeubles gris. C'était déjà l'aube. Il se surprit à envier les gens qui étaient bien tranquilles dans leurs chambres bien chauffées, en attendant de commencer une journée ordinaire. Tous ces gens ne se rendaient pas compte, c'était certain, de la chance extraordinaire qu'ils avaient de se réveiller au lit à côté de leur femme, et d'avoir la certitude absolue, totale, d'avoir de quoi boire et manger à satiété dans la journée. Le train finit par s'arrêter dans une gare d'un pays qui n'était plus celui de Vincent mais pas encore Dibadi. Sur le quai, des miliciens en uniforme vert sombre regardaient le train tout en discutant entre eux. Vincent sentit une bouffée de colère monter en lui, vite remplacée par un sentiment désagréable qu'il n'arrivait pas à définir : la présence des miliciens révélait la méfiance des gens du lieu envers les gens comme lui. Dans quelle galère s'était-il fourré ? Il fit par de ses pensées à Otlakhmin, qui ricana : "C'est normal qu'ils se méfient de moi, je suis un ancien clochard !" Le passage du chariot roulant contenant les petits déjeuners, poussé par deux employés en tenue bleue, ramena Vincent à des pensées plus prosaïques. Chaque passager reçut du café tiède dans une tasse de carton, deux petits pains et une bouteille en bioplastique jaunâtre, contenant ce qu'il supposa être de l'eau du robinet. Otlakhmin conseilla à Vincent de garder la bouteille, puisqu'il n'avait pas de gourde. L'eau des sanitaires du train n'était pas potable, mais on pouvait avoir de la bonne eau en tonnelet, en passant de wagon en wagon pour retrouver le chariot. Vincent n'avait pas fait de repas chaud depuis son déjeuner de la veille, pris dans une gargotte de la capitale en attendant de passer l'examen, et il prit bien soin de manger lentement pour bien profiter des petits pains. Car il est vrai que l'être humain en revient vite, très vite, à son obsession quotidienne, viscérale, commune depuis l'aube des temps à tout ce qui marche, court, vole, nage, saute et rampe en ce bas monde : manger. Vincent passa la journée, qui lui parut extrêmement longue, à regarder le paysage par la fenêtre du couloir, et à discuter avec les autres passagers. Chacun raconta plus ou moins sa vie. Personne n'avait envie de relire pour la centième fois Eikanem ye Tlatayetgo et encore moins de parler dibadien. A midi : sandwichs industriels, sous cellophane. Idem le soir, plus une tasse de thé. Curieuse idée, se dit Vincent, de donner une boisson stimulante et diurétique le soir. Les sanitaires du train ne permettaient pas autre chose qu'une toilette élémentaire, mais Vincent mit un point d'honneur à faire un brin de toilette et à se raser. Chacun se pelotonna sur son siège pour une deuxième nuit de mauvais sommeil. Enfin, presque une nuit : à deux heures du matin, ils seraient à Dibadi, d'après Khuchëk. Certains avaient décidé qu'il était inutile de dormir, et continuaient à parler entre eux, jusqu'à ce que les autres les fassent taire. Plus tard, alors qu'il s'était endormi pour de bon, Vincent sentit le train s'arrêter, et des voix parler dibadien dans le couloir. Il était au milieu d'un rêve et il lui fallut un certain temps pour se rendre compte qu'ils étaient arrivés. Le quai était assez étroit, sous une voûte de béton brillamment éclairée. Une demi-douzaine de miliciens en uniforme marron, mais sans arme visible, invitaient les passagers à sortir du train : Konagoda chako tlahani asam eisztada ! Que tout le monde sorte avec ses bagages ! Les syllabes crépitaient comme des balles de mitrailleuse, tla-tla-tla-tla, et il fallut quelques minutes à Vincent pour comprendre quelques bouts de phrases. Il prit son sac à dos, qui contenait toutes ses affaires, et se retrouva sur le quai à côté d'Otlakhmin. Il se rendit compte qu'il n'y avait pas que des miliciens sur le quai, mais aussi un prêtre konachoustaï en long caftan noir et ceinture jaune, coiffé d'un bonnet carré violet, et une dizaine d'assistants laïcs en tenue civile et brassard rouge, dont une majorité de femmes, certaines vêtues comme des hommes. Vincent remarqua que même les civils portaient des vêtements sombres, où le brun, le gris et le noir prédominaient. Les cinquante femmes qui avaient voyagé dans un wagon à part se retrouvèrent aussi sur le quai, frissonnant dans leurs blouses marron et caquetant dans leur langue maternelle. Les assistantes du prêtre les prirent rapidement en charge et les poussèrent vers une destination inconnue. Vincent se retrouva face au prêtre, un homme grand et massif au visage couleur de brique. "Vous regardez partir les femmes avec regret" dit le prêtre avec un sourire, en articulant soigneusement les mots. "Ne vous inquiétez pas, elles vont... ( ici un mot que Vincent ne comprit pas) ... dans des équipes de nettoyage. Vous les reverrez." "Et nous, les hommes ?" demanda Vincent. C'étaient ses premiers mots en dibadien à un vrai Dibadien, et ils étaient sortis de sa bouche sans effort, presque naturellement. Bon présage. "Vous allez travailler dans des équipes de construction. Creuser des tunnels pour le métro, construire des immeubles. Vous serez logés dans des foyers et payés. Ensuite, vous pourrez choisir d'autres professions suivant vos talents individuels." "Je suis surpris d'être accueilli par un prêtre" dit Vincent. "La religion compte beaucoup à Dibadi. Les dispensaires et les écoles sont gratuits parce que nous rappelons sans cesse à nos dirigeants leur devoir de compassion. De même, le revenu minimum des vieillards et des infirmes... " Khuchëk interrompit la conversation : "Mantolo, viens. Il faut prendre le métro pour arriver au foyer où vous pourrez tous vous installer." Vincent remarqua que Khuchëk l'avait appelé par son prénom dibadien et lui avait parlé en dibadien. " Nai chako. Je viens" répondit-il avec lenteur. | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 10 Oct 2009 - 12:49 Sam 10 Oct 2009 - 12:49 | |
| Vincent se retrouva dans une chambre minuscule d'un foyer pour nouveaux arrivants. Le foyer, haut de dix-huit étages, avait l'apparence d'un hôtel, avec un hall immense, d'au moins cent mètres de long, bordé de boutiques. Un long comptoir servait à la fois de bureau d'accueil, de banque et de bureau de poste. Au premier étage, une grande salle à manger faisait office de cantine. Il y avait même une estrade pour un orchestre, la même salle servant de salle de bal et de salle de spectacle, le samedi soir et le dimanche.
Le foyer-hôtel s'appelait Tlipsan Emusëmkha, l'Hôtel du Soleil Couchant, sans doute à cause de sa localisation au sud-ouest de la ville. Pour accentuer la ressemblance avec un véritable hôtel, il y avait même un portier en manteau de fourrure et casquette galonnée d'or.
La chambre de Vincent avait sa propre salle de bains, ce qui le ravit : il ne s'attendait pas à tel degré de confort.
L'un des réceptionnistes, avec qui il eut un jour l'occasion de discuter, lui donna une explication prosaïque :
"Nous hébergeons aussi des familles, même dans les petites chambres. Beaucoup de gens n'ont pas l'habitude des sanitaires modernes, ils salissent et abîment tout. Une petite salle de bain préfabriquée par chambre, cela ne coûte pas trop cher pour l'hôtel, qui peut accueillir jusqu'à deux mille personnes, et cela évite bien des disputes et même des bagarres."
Les bals du samedi soir à l'Hôtel du Soleil Couchant permettaient à Vincent et à ses camarades de rencontrer des femmes, également logées dans l'hôtel. C'est là que Vincent rencontra Diletyet, qui travaillait dans une blanchisserie industrielle, et avec laquelle il eut une longue liaison.
A Dibadi les femmes sont obligatoirement stérilisées après leur accouchement si elles ont déjà un ou plusieurs enfants. Les tricheuses, qui dissimulent les enfants déjà existants, sont simplement punies d'amendes assez lourdes. Avoir beaucoup d'enfants est une calamité à Dibadi, et une punition en soi, sauf si on est riche, ce qui est rare. Diletyet savait qu'elle ne pourrait avoir, au maximum, que deux enfants, et elle n'était pas sûre de vouloir les faire avec Vincent. Ce dernier, à dix-neuf ans, ne se sentait pas prêt non plus à fonder une famille.
Les six premiers mois, Vincent travailla comme manoeuvre dans une équipe de creusement du métro. Ils étaient plusieurs centaines à utiliser des pelles ou à conduire des pelleteuses pour creuser les vastes tranchées rectilignes, profondes de dix mètres et large de douze, qui devaient abriter les nouvelles voies ferrées souterraines.
Ensuite, d'autres équipes installeraient les rails et les traverses et construiraient les voûtes de béton qui, recouvrant les tranchées dans toute leur longueur, les transformeraient en tunnels.
La touche finale consisterait à faire passer des routes au-dessus des tunnels. A Dibadi, les lignes de métro suivent le tracé des avenues et des boulevards. Il est ainsi possible d'avoir des lignes de métro juste deux mètres en dessous du niveau de la rue, ce qui ne serait pas possible si des immeubles étaient bâtis dessus.
Le dur travail de manoeuvre était une étape obligatoire. C'est ainsi que les nouveaux arrivants étaient testés. Certains trouvaient le travail trop fatigant, d'autres n'arrivaient pas à accepter la discipline des chantiers. Une minorité regimbait et rejoignait les nombreux clochards et voleurs de Dibadi.
Vincent travaillait dans une équipe qui creusait ce qui devait devenir plus tard une extension de la Ligne Jaune-Bleu du métro et, en surface, Tëkopkaiush Wehët, la rue du Cheval Blanc.
Souvent, sa pioche heurtait toutes sortes d'objets enterrés : blocs de béton, morceaux de meubles, fragements d'os humains. Une fois, il trouva un crâne humain intact. Il le nettoya et le ramena dans sa chambre comme un trophée.
Vincent se dit que l'époque où l'on bâtissait les villes dans des lieux jusque là réservés à la nature n'existe plus, surtout à Dibadi. Les traces de la présence humaine sont partout. Même les champs et les vergers qui entourent Dibadi ont été créés sur les ruines de villes détruites, d'où les amoncellements de débris, souvent recouverts d'herbes folles et d'arbustes, que l'on voit partout à la campagne. Les cyborgs font de leur mieux pour les recouvrir de terre afin de leur donner un aspect verdoyant.
La ville de Dibadi fait comme la nature, elle recycle toute chose. Les religieux dibadiens rapellent sans cesse que le corps de l'être humain est fait de 90% d'eau, de l'eau qui existe depuis des centaines de millions d'années et qui a, certainement, été bue et pissée des milliers de fois par les dinosaures. Cette eau a aussi fait partie de leur corps, de leur sang, et même, pourquoi pas, de leur sperme. Il en est de même des 10% du corps humain qui ne sont pas de l'eau. Le calcium de nos os vient de la terre, qui elle-même vient de la décomposition de la matière vivante. Votre bras a sans doute en lui une quantité non négligeable d'anciens atomes de diplodocus. Et de cafard aussi, soyons réalistes.
L'Hôtel du Soleil Couchant est situé à proximité d'un grand immeuble de vingt étages, dont les fenêtres de verre dépoli sont toujours fermées. Cet immeuble est le Sëkukyakha, littéralement la maison de l'homme fort. En fait, le nom a été donné à l'immeuble en hommage à un nommé Sëkuk, ce qui signifie "fort" ou "homme fort" en dibadien.
Dans ses promenades en ville avec Diletyet, Vincent passait souvent devant le Sëkukyakha. Il finit par apprendre qu'il s'agissait d'un refuge pour clochards.
Il est assez facile de devenir clochard à Dibadi. Pour le citoyen ordinaire les soins médicaux sont gratuits, des logements très bon marchés sont disponibles, la nourriture et les vêtements de base sont subventionnés pour être accessibles à tous. On ne demande jamais ses papiers à quelqu'un pour le soigner. Mais les structures sont chroniquement surchargées : il faut attendre des heures dans un dispensaire pour se faire soigner, la police est corrompue et inefficace, les écoles manquent de place, d'enseignants et de fournitures, bien qu'elles soient obligées par la loi de fournir un uniforme et un ciré vert aux élèves, et la plupart des gens sont logés dans des appartement exigus et mal entretenus, avec des canalisations qui fuient et des murs extérieurs décrépis.
Les étrangers qui parlent mal ou pas du tout le dibadien, les asociaux et les malchanceux ont vite fait de se retrouver sans travail et sans logement : les structures urbaines ont été conçues pour une population de quatre millions d'habitants mais la ville en compte déjà neuf millions. Les clochards finissent par se retrouver malades et gravement sous-alimentés dans les rues. Les miliciens les envoient dans des centres d'accueil comme le Sëkukyakha, d'où ils ne ressortent jamais.
Vincent voyait parfois les cars de la milice amener de pauvres hères, vêtus de guenilles et souvent infirmes, devant le Sëkukyakha, et les faire entrer à l'intérieur.
Les gens racontaient, sans preuve, que les clochards ne ressortaient jamais du Sëkukyakha. Par contre, on voyait souvent des bennes à roulettes sortir par une porte latérale pour être vidées dans les camions d'une société de voirie.
Le contenu des bennes non couvertes était visible : des détritus informes nageant dans de la boue sèche, noirâtre, et surtout, surtout, des centaines de cadavres de rats. Vincent, qui les avait vus de ses yeux, en tremblait de dégoût.
Diletyet raconta à Vincent que selon la rumeur les clochards étaient d'abord emmenés dans les bas étages du Sëkukyakha, où ils étaient nourris et lavés, bien que séquestrés de fait. Si au bout d'un an personne ne prenait de leurs nouvelles, ils étaient envoyés un peu plus haut dans l'immeuble. Si une autre année se passait sans que personne ne les réclame, ils étaient transférés dans les étages supérieurs. Certaines personnes à l'imagination fertile pensaient que les cyborgs les étranglaient et les faisaient dévorer par des rats, qui n'en laissaient que les os et les cheveux.
Lorsque les rats, nourris de la chair des clochards morts, devenaient trop nombreux, il fallait les tuer, d'où les cadavres de rats dans les bennes. Les os humains, les cheveux et les vêtements étaient coupés ou broyés en tout petits morceaux et mélangés à des excréments et à des ordures diverses.
Vincent avait du mal à y croire. Le Sëkukyakha avait l'air si propre, si moderne. La lumière du soleil se reflétait sur le verre de ses centaines de fenêtres closes et carrées, toutes identiques. Pour une fois que Dibadi était belle...
Vincent se surprit à passer de plus en plus souvent devant le Sëkukyakha. Il voyait presque toujours la même chose :
Dans un parking clos par une barrière, sur le côté gauche de l'immeuble, des miliciens en uniforme marron poussaient des bennes vides vers l'intérieur du bâtiment. Un camion était garé sur le parking. Il avait une inscription en dibadien sur le côté : Lamotaigo, mungmëk pi lulumëk.
Ce qui signifie : Lamotaïgo, traiteur-livreur.
Bien sûr ! Il fallait nourrir les résidents, se dit Vincent. La simple présence du camion dissipait les immondes rumeurs.
Si des gens était tués à l'intérieur du bâtiment, qui plus est de façon quasiment industrielle, les employés parleraient, se dit Vincent, un énorme scandale éclaterait, une révolution, même. Sauf si les miliciens qui travaillaient dans le Sëkukyakha étaient des cyborgs, ce qui était possible. Les cyborgs ne parlent jamais.
Un jour, n'y tenant plus, Vincent entra dans le Sëkukyakha. La double porte d'entrée donnait sur un grand hall, aux murs peints en bleu clair. Une odeur de désinfectant imprégnait les lieux, qui avaient l'air calmes et tristes. Une hôtesse aux cheveux châtain bouclés était assise derrière un comptoir, à côté de deux miliciens qui lisaient le journal.
"Je cherche un homme qui est peut-être hébergé ici" dit Vincent à l'hôtesse.
"Je vais voir, citoyen" répondit la jeune femme. "Comment s'appelle-t-il ?"
"... Pierre... Pierre Benoît" improvisa Vincent. Sous le coup de l'émotion, il avait parlé français.
"Piye Bënua, wik?" dit l'hôtesse. Vincent hocha la tête.
L'hôtesse tapa quelques mots sur un clavier d'ordinateur.
"Non, nous n'avons personne de ce nom ici. Depuis quand n'avez-vous pas eu de nouvelles de votre ami ?"
Vincent se dit que l'hôtesse devait être une cyborg. Son dibadien était trop parfait. Ou alors, elle était née à Dibadi. C'était possible. Elle avait l'air d'avoir une trentaine d'années.
"Oh... peut-être trois ans, je crois" dit Vincent.
"Si votre ami a été transféré dans un autre centre, ou si quelqu'un est venu le réclamer et l'a pris en charge, son dossier a été effacé et il n'en reste pas de trace. Ni date d'arrivée, ni date de départ."
"Oh, citoyenne" dit Vincent, assez mal à l'aise. "Pouvez-vous voir s'il n'est pas dans un autre centre ?"
"Malheureusement non, citoyen. Les fichiers ne sont pas connectés. Chaque centre est une unité autonome. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous aider. Patlisztada."
"Mais pourquoi est-ce que vous effacez les dossiers ?"
"Citoyen... seul le Ministère de la Population peut garder indéfiniment des données privées sur les gens, et elles ne sont pas accessibles à tout le monde" dit l'hôtesse avec un léger sourire.
"Patlisztada, citoyenne" répondit Vincent et il sortit aussi vite qu'il le put sans avoir l'air de s'enfuir.
Dernière édition par Vilko le Mer 21 Oct 2009 - 22:07, édité 1 fois | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Mer 21 Oct 2009 - 20:48 Mer 21 Oct 2009 - 20:48 | |
| j'ai vraiment accroché, c'est très bien écrit, ça donne envie de se mettre au Dibadien.
J'ai tout lu d'un trait. |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Mer 21 Oct 2009 - 22:09 Mer 21 Oct 2009 - 22:09 | |
| Merci !  Je vais écrire la suite dès que possible... | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 31 Oct 2009 - 23:54 Sam 31 Oct 2009 - 23:54 | |
| Ce n'est qu'au bout de plusieurs mois à Dibadi que Vincent se rendit compte que beaucoup de gens mouraient de faim. La famine n'est pas une chose aussi spectaculaire que l'on croit. On ne voit pas de foules de squelettes ambulants s'effondrant dans la rue. Ceux qui meurent ne disent rien et on les voit rarement. Ils deviennent passifs et faibles, un rhume suffit à les emporter. Ils restent assis ou couchés sans rien faire, les yeux dans le vague, dans leur chambre ou dans le taudis qui en tient lieu. Un jour, ils meurent, tout simplement. Le médecin, s'il en vient un - à Dibadi, c'est en général un cyborg - écrit sur le certificat médical que la mort est due à la malnutrition et à l'état de faiblesse généralisée qui en résulte. Les journaux ne mentionnent jamais ce genre de faits divers. Les vieillards et les enfants meurent en général assez vite, parce qu'ils sont les premiers à ne plus avoir la force de sortir de chez eux pour mendier ou chercher de la nourriture parmi les ordures, et que contrairement aux femmes, ils ne peuvent pas se prostituer. Ce fut difficile pour Vincent, qui n'avait sauté un repas qu'une ou deux fois dans sa vie, de comprendre vraiment ce qui se passait pourtant presque devant ses yeux.
Vincent commençait à regretter d'être venu à Dibadi, malgré Diletyet, dont il était vraiment amoureux.
Lorsqu'il lui arrivait de passer devant le Sëkukyakha, il pressait le pas et regardait ailleurs, comme les autres passants.
Il passa un examen pour entrer dans la milice, et le réussit assez facilement. Diletyet le félicita d'avoir quitté son travail éreintant de manoeuvre pour un emploi à la fois moins éprouvant et mieux payé.
Quelques jours après avoir réussi l'examen, il se présenta à la caserne Tëkopako, à une dizaine de stations de métro de l'Hôtel du Soleil Couchant. L'adjudant de semaine lui attribua un studio guère plus grand que sa chambre d'hôtel, mais où Diletyet fut autorisée à s'installer avec lui.
Il semblait à vincent qu'il nageait dans le bonheur. Il venait d'avoir vingt ans, et il était fier et heureux de porter l'uniforme marron des miliciens, malgré l'impopularité du métier. Peu lui importait : les miliciens vivaient entre eux et méprisaient ouvertement les civils.
Le premier mois fut consacré à la formation de base. Exercices physiques, techniques d'arrestation, simulations de contrôles d'identité, quelques éléments de droit (Il est interdit de tirer dans la rue même sur quelqu'un qui s'enfuit, sauf s'il est armé ! Il est interdit de torturer les prisonniers !), tir et maniement d'arme, cours sur l'histoire et l'organisation de la milice... Vincent trouva l'entraînement stimulant, les formateurs étaient de vieux soudards grognons et un peu trop portés sur l'alcool, mais sympathiques.
Sa première mission consista à sillonner les rues de l'un des quartiers centraux, dans un fourgon avec une demi-douzaine de collègues, sous les ordres d'un sergent-chef. De minuit à huit heures du matin, ils devaient ramasser tous les clochards qui dormaient sur les trottoirs ou sous des abris de carton, pour les emmener dans un centre d'accueil, que les autres mliciens appelaient le T44.
Vincent était livide. Il se rappelait le Sëkukyakha et ce qu'on racontait à son sujet. Il avait l'impression qu'on lui demandait d'envoyer à la mort les pauvres bougres qu'il arrêterait.
Cela se passa, en fait, bien mieux qu'il ne s'y attendait. Une grosse bouteille de bière au goût de miel, de l'otlakhya, boisson nationale de Dibadi, circulait dans le fourgon, et bientôt tous les miliciens se sentirent joyeux et pleins d'allant, même le chauffeur, qui riait en prenant les rues à contre-sens dans la nuit glacée.
"Les clodos nous connaissent" lui dit un collègue qui avait déjà plusieurs années de milice. "Ils se cachent dans les baraques des chantiers ou dans les parcs. On n'y va jamais, c'est trop dangereux. On n'arrête que les plus faibles, ceux qui se font virer des planques par les plus costauds. Des fois, on va les chercher jusque dans les halls d'immeubles, parce que les résidents nous téléphonent."
"On va d'abord faire les rues" lui dit l'ancien, qui se faisait appeler Tlushga, ce qui signifie santé. "Ensuite, on fera un parc, à l'aube. On risque moins de se faire trucider quand il fait jour."
Vers une heure du matin ils tombèrent sur une famille entière, le père, la mère et deux jeunes enfants, cachés sous des couvertures dans une ruelle. Vincent n'osait pas les toucher, de peur d'attraper des puces. Heureusement la famille de clochards n'opposa pas de résistance et monta assez facilement dans le fourgon. La mère pleurait et les enfants aussi, le père était nerveux et agressif, mais finalement tout se passa bien.
Le T44 était un grand immeuble de béton, semblable à des milliers d'autres à Dibadi. Le hall, meublé de chaises déglinguées et de grandes tables, était rempli de miliciens, de deux ou trois infirmières en blouse blanche et de clochards malodorants, à qui les miliciens donnaient de la soupe.
"T'as vu les collègues ?" lui dit Tlushga discrètement. "Jamais une goutte d'alcool, jamais une connerie, et leur barbe ne pousse jamais. C'est des cyborgs ces gars-là, j'te dis. Des robots avec un cerveau artificiel."
"Comment tu le sais ?" demanda Vincent, incrédule. Il se sentait un peu saoûl et il essayait tant bien que mal de le cacher.
"Tout le monde le sait."
Vincent et ses collègues laissèrent la famille aux bons soins du responsable de nuit, un adjudant ventripotent et débonnaire, et repartirent dans le fourgon.
"On a fait notre boulot" dit Tlushga. "Les officiers pourront pas dire qu'on a dormi dans le fourgon. On a fait quatre bâtons."
Vincent comprit que dans l'argot des miliciens, un bâton (sëtik) voulait dire une arrestation. Les enfants comptaient comme des adultes.
Le sergent-chef tenaient à ce qu'ils contrôlent un parc public, qu'il appelait Sidni Pëchakh, aux premières lueurs de l'aube, vers sept heures du matin. Avec un peu de chance, expliquait-il, ils tomberaient sur des clochards encore engourdis par le froid.
Cela faisait environ cinq heures d'attente. Les miliciens décidèrent de dormir dans le fourgon.
Vers six heures et demie, le sergent-chef les secoua pour les réveiller. Vincent, qui avait dormi assis, était tout engourdi. Mais l'effet de l'alcool était passé.
Tlushga fit chauffer du café, après avoir branché la cafetière électrique sur l'allume-cigare. Ce n'était que l'immonde café synthétique de Dibadi, qui ressemble à du café seulement si on n'a pas goûté à du vrai café depuis très longtemps. Mais avec trois ou quatre sucres, il devenait presque bon.
Vincent aurait bien mangé quelque chose avec le café, mais il n'y avait rien, même pas des biscottes. Les anciens n'emmenaient dans le fourgon que des boissons, de préférence alcoolisées, qu'ils cachaient sous les banquettes.
Le fourgon se gara à l'entrée d'un parc sombre et silencieux. Les miliciens sortirent tous ensemble, sauf le chauffeur, et commencèrent à examiner les fourrés avec des lampes électriques.
Il n'y avait pas assez de lampes pour tout le monde, et Vincent en était réduit à rester à côté de Tlushga, qui en tant qu'ancien en avait une de réservée pour lui.
Au bout d'un quart d'heure ils trouvèrent deux clochards sous des cartons et leur passèrent promptement les menottes dans le dos. Les clochards mirent beaucoup de mauvaise volonté pour se lever, mais le sergent-chef connaissait les vieux trucs : il les souleva par la chaîne des menottes, et les fit courir jusqu'au fourgon. Le deuxième clochard tomba. Incapable de se protéger le visage à cause de ses bras menottés par derrière, il se cassa le nez. Deux miliciens le soulevèrent par les bras et le traînèrent jusqu'au fourgon où ils l'attachèrent à un siège pour l'empêcher de mettre du sang partout.
Vincent et deux collègues examinèrent le reste du parc, mais ils n'attrapèrent personne. Ils virent au loin quelques silhouettes courir lourdement vers l'une des sorties, en zigzaguant parmi les bosquets.
Vincent commençait déjà à leur courir après, mais l'un de ses collègues le retint par le bras : "Laisse tomber, on s'en fout, on en a déjà assez fait avec les deux qu'on a pris."
Au T44, l'adjudant ventripotent, toujours impeccablement rasé, fit des histoires. Les deux clochards donnaient des adresses, des noms, et même des numéros de téléphone, ils prétendaient avoir un domicile, donc ce n'étaient pas de vrais clochards. Celui qui avait le nez cassé geignait, le visage presque noir là où le sang avait séché.
"J'applique la circulaire" dit le sergent-chef, passablement énervé. "Tu dois prendre en charge les gens que je t'amène. C'est quand même pas le bout du monde de vérifier deux adresses bidon, non ?"
"Sauf si elles sont dans des quartiers dangereux..." objecta l'adjudant.
"Alors tu les relâches, je m'en fous, j'ai fait mon boulot" dit le sergent-chef en tournant les talons.
Le fourgon retourna à la caserne Tëkopako. Vincent était fatigué, il avait l'impression que l'alcool qu'il avait bu et le mauvais café se battaient comme des chats dans son estomac, mais il était soulagé de voir que le travail n'était pas aussi difficile qu'il l'avait craint.
"Tu crois que l'adjudant du T44 va les relâcher ?" demanda-t-il à Tlushga.
"Je pense, oui. En général, il ne garde que ceux qui sont trop faibles, trop malades pour survivre dans la rue. Ceux-là avaient l'air plutôt costauds. Des fois, on en trouve qui meurent vraiment de faim. Le T44 les accueille sans problème. Et nous, on se fait engueuler quand les jardiniers trouvent un type mort de froid dans un parc. On nous dit qu'on aurait dû le trouver avant. C'est ça la milice, mon gars : t'as toujours tort !"
Diletyet était déjà parti travailler à la blanchisserie. Vincent prit le temps de prendre une douche avant de se coucher, il avait peur d'avoir attrapé des puces ou des poux au contact des clochards. Qu'il était doux de se laisser glisser dans le sommeil entre des draps propres, alors que dehors il faisait déjà jour. | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 1 Nov 2009 - 17:08 Dim 1 Nov 2009 - 17:08 | |
| La suite de l'épisode posté hier :
--------------------------------------------
Quelques mois plus tard, Vincent rencontra Otlakhmin par hasard dans la rue, alors qu'il déambulait du côté de la Halle aux Cochons. Ils étaient tout heureux de se revoir et de parler français, et ils décidèrent d'aller boire un verre dans un café.
Otlakhmin commanda un verre d'otlakhya, mais Vincent préféra prendre du thé : "Je bois assez d'alcool comme ça quand je travaille."
A Dibadi, il est d'usage de payer les consommations dès qu'elles sont servies. Remarquant l'air triste et fatigué d'Otlakhmin et ses vêtements usés, Vincent paya d'autorité les deux consommations. Otlakhmin ne dit rien, et Vincent en conclut qu'il était vraiment fauché.
Le visage rougeaud d'Otlakhmin était mal rasé et ses cheveux gris avaient poussé. Il était évident qu'il se laissait aller. Dès la première gorgée d'alcool il se mit à raconter sa vie :
"Je n'en pouvais plus de creuser des tranchées pour le métro. J'avais mal partout. J'ai dû cesser de travailler, mais je n'ai rien retrouvé d'autre. Me voila donc sans ressources, et je vais bientôt être expulsé de l'hôtel. Il m'arrive la même chose qu'autrefois dans le vieux pays. Ma copine m'a quitté, elle aussi."
"Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?"
"Je vais demander à être hébergé au Sëkukyakha. J'aurai deux ans pour retrouver du travail, avant d'être envoyé dans les étages supérieurs, dont bien peu ressortent."
"Mais c'est de la folie !" s'exclama Vincent.
"Tu as une meilleure idée ?"
Vincent baissa la tête. "Non" dit-il d'une voix blanche.
Otlakhmin avalait son otlakhya, la douce boisson dorée des Dibadiens, à petites gorgées. "Je ne sers plus à rien à personne. Les gens qui ont des enfants peuvent rester dans les étages inférieurs tant que leurs enfants leur écrivent ou viennent les voir. Mais les célibataires comme moi, on nous oublie rapidement. Pour finir, on nous transfère dans un autre centre d'accueil, comme ils disent, et nous disparaissons."
"Deux ans pour trouver du travail, ça devrait suffire" dit Vincent sans conviction.
"J'espère, j'espère. Mais toi, Vincent, comment vas-tu ? Tu as les traits marqués, déjà à ton âge."
"C'est le travail de nuit et l'otlakhya. Mais je ne me plains pas. Je ne travaillerai pas toujours la nuit, et je vis avec Diletyet. J'ai un logement, un emploi, une femme. Je mange à ma faim. Que demander de plus ?"
Deux jeunes femmes d'environ vingt-cinq ans, vêtues de pantalons élimés et de vieilles vestes décolorées, aux visages amaigris et aux longs cheveux noirs et sales, les regardaient avec intérêt depuis le comptoir. L'une d'elles s'approcha d'Otlakhmin :
"On peut discuter avec vous deux ? Vous nous payez à boire ?" dit-elle en dibadien.
Il répondit d'un ton sarcastique :
"J'ai pas un rond et je vais bientôt être à la rue. Quant à mon jeune ami, il est déjà marié de fait."
"Vous pouvez payer à boire quand même."
"Pas question" dit Otlakhmin en plongeant son regard droit dans les yeux de la fille.
Elle tourna les talons sans dire un mot.
"Tu vois, Vincent," dit Otlakhmin, "Ces deux aventurières ont plus de chance que moi. Elles ont quelque chose à vendre."
Vincent secoua la tête avec colère : "Cette ville nous rend fous. Tu acceptes de disparaître dans deux ans, et tu sais aussi bien que moi ce que ça veut dire, disparaître dans le Sëkukyakha. Et tu ne te révoltes pas ?"
Otlakhmin sembla s'énerver :
"C'est toi qui me dis ça, alors que ton boulot, laisse-moi te le rappeler, consiste à alimenter en viande à deux pattes des endroits comme le Sëkukyakha !"
Il vida son verre d'un seul coup et continua, sur un ton plus posé :
"Un jour il y aura peut-être une révolution à Dibadi. Il y en a déjà eu et on sait comment elles ont fini : l'armée des cyborgs a massacré les rebelles. Il n'y a pas d'espoir, je te dis. On ne peut même plus rentrer chez nous, dans le vieux pays. Le pays où nous sommes nés ne nous laisserait pas revenir, nous avons été rayés des listes."
Vincent secoua la tête : "Avant nous, combien de gens ont eu des conversations comme celle-ci, dans des cafés comme celui-ci ?"
"Des millions. On reboit quelque chose ?" | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 7 Nov 2009 - 20:48 Sam 7 Nov 2009 - 20:48 | |
| Lorsqu'il apprenait le dibadien, Vincent avait des problèmes avec l'alphabet. Il connaissait toutes les lettres, mais un texte écrit dans cette langue lui était toujours incompréhensible au premier regard, et même au deuxième. Il était obligé de déchiffrer les lettres une par une, et cela prenait du temps. Au bout de quelques lignes, lorsqu'il lisait un journal par exemple, il était fatigué et il se contentait de déchiffrer un mot par-ci par-là, pour avoir une idée, souvent trompeuse, de ce que voulait dire le texte.
Le temps passant, et après beaucoup d'efforts, il arriva à lire en dibadien presque aussi vite et facilement qu'en français. Il s'aperçut alors que lorsqu'on lit, on ne déchiffre pas les mots lettre par lettre, mais on les reconnaît dans leur globalité. Pour lire du dibadien, comme toute autre langue qui s'écrit dans un alphabet particulier, il faut s'entraîner souvent et longuement, pour reconnaître les mots sans avoir à les analyser. Lire, c'est plus que déchiffrer.
De même, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on le reconnaît à l'ensemble des traits de son visage, et non pas en regardant d'abord les yeux, puis le nez, la bouche, etc.
Apprendre à lire vraiment, couramment, c'est comme d'apprendre à reconnaître des milliers de visages.
Inévitablement, cela prend du temps.
D'où l'utilité de lire et relire les mêmes textes. Vincent avait lu et relu Eikanem ye Tlatayetgo, au point d'en être dégoûté.
La plupart des camarades de Vincent avaient étudié Eikanem ye Tlatayetgo uniquement pour passer l'examen, et plutôt à contrecœur. Ils avaient ensuite rangé le livre au fond d'un tiroir, comptant sur la pratique pour apprendre à parler couramment le dibadien. Ils avaient plutôt moins de vocabulaire que Vincent, ils faisaient des fautes et il leur arrivait d'avoir du mal à s'exprimer, voire même de glisser des mots de leur langue maternelle dans la conversation. Mais, grosso modo, ils se débrouillaient pour comprendre et être compris.
Vincent, lui, parlait plutôt bien la langue, il avait même adopté l'accent saccadé et guttural des Dibadiens de naissance, qui parlent du fond de la gorge, avec un débit rapide et rythmé qui donne un aspect curieux aux phrases les plus anodines : "Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ça donne envie d'aller se promener" devient, dans la bouche d'un Dibadien, quelque chose comme :
Il fait beau. Aujourd'hui. N'est-ce pas. Ça donne envie. D'aller se promener.
En dibadien : Toszti kusa, altas, wisz, usz mung, tlata ulipi.
Vincent ne comprenait pas toujours les expressions argotiques, colorées, créées spontanément, quotidiennement, par les Dibadiens dans le feu de la conversation. Le seul argot qu'il connaissait vraiment, c'était celui des miliciens avec lesquels il travaillait.
Diletyet avait un problème différent, et plus gênant. Illettrée dans sa langue maternelle, elle déchiffrait péniblement le dibadien et ne lisait vraiment que les mots figurant sur les devantures des magasins et sur les panneaux publics : des mots comme métro, sortie, alimentation, boucherie, pharmacie... Les cours donnés deux fois par semaine sur son lieu de travail lui avaient permis d'acquérir juste assez de vocabulaire pour tenir une conversation courante et suivre l'action des séries télévisées, doublées en dibadien, qu'elle regardait pendant ses loisirs. Lorsqu'elle parlait, son accent était épouvantable et elle se limitait toujours à des phrases simples.
Comme elle ne savait pas lire un plan, Diletyet ne connaissait de la ville que le quartier où elle habitait avec Vincent, avec ses commerces et son petit supermarché, et le trajet entre son domicile et la blanchisserie où elle travaillait. Une fois, elle avait oublié de descendre à sa station de bus habituelle. Affolée, elle avait téléphoné à Vincent depuis une cabine publique pour qu'il vienne la chercher. Heureusement, l'utilisation du téléphone faisait partie des cours de dibadien qu'elle avait reçus...
La plupart des couples de miliciens logés dans la caserne étaient comme eux sur le plan linguistique, et à de rares exceptions près ils parlaient le dibadien en famille, comme Vincent et Diletyet. Apparemment, leurs enfants ne parlaient que le dibadien. Mais avec quel accent ? L'accent étranger de leur mère, celui de leur père, le "bon" accent des institutrices, ou un accent composite ?
Vincent s'aperçut que jusqu'à l'âge d'environ trois ans les enfants des miliciens parlaient avec l'accent de leur mère, rarement celui de leur père. Ensuite, à l'école, les institutrices leur apprenaient à parler kaqua tlush (comme il faut) en corrigeant leurs erreurs et en leur faisant réciter de petits textes, en général des poèmes ou des chansons. Entre eux, les enfants s'influençaient mutuellement et acquéraient tous le même accent, à peu près conforme à la prononciation officielle, et ensuite ils le gardaient définitivement.
La nécessité de parler kaqua tlush était martelée sans répit. Comme le répétaient les enseignants et la plupart des adultes "ceux qui parlent mal n'arriveront à rien dans la vie et finiront clochards."
A Dibadi, le mot bikhago (clochard) a des connotations sinistres de déchéance et de mort, malgré le secret officiel sur ce qui se passe dans les étages supérieurs des centres d'accueil comme le Sëkukyakha et le T44. Même les enfants pâlissent lorsqu'on prononce certains mots devant eux.
"C'est pour leur bien" se disait Vincent.
Et il se rendait compte avec un peu de tristesse, que, presque malgré lui, il était devenu un vrai dibadien.
Mais il restait encore bien des mystères qu'il ne comprenat pas. Les cyborgs, par exemple. La rumeur disait qu'en fait c'étaient des androïdes, des êtres entièrement artificiels, y compris le cerveau.
En y réfléchissant bien, Vincent se disait qu'il n'y avait pas d'autre explication. Les cyborgs racontaient avoir été humains dans des vies antérieures, dont ils prétendaient n'avoir gardé que de vagues souvenirs, et avoir changé de nom et de visage en devenant des cyborgs. Même s'ils disaient vrai, le fait d'avoir hérité d'une partie des souvenirs, des instincts et des facultés intellectuelles d'un être de chair et de sang fait-il d'une machine intelligente un être humain ? Vincent tendait à penser que non, mais en fait il n'en était pas sûr.
Les seuls Dibadiens dont il était certain qu'il soit des cyborgs étaient les interprètes, auxquels la milice faisait parfois appel. Rien dans leur aspect et leur comportement ne les différenciait des êtres humains biologiques.
Et pourtant... Vincent savait que les corps des cyborgs sont fabriqués en usine. Ce ne sont, en fait, que des réceptacles sophistiqués pour une dizaine de litres de yeksootch, le "gaz pensant" des cyborgs.
Le yeksootch est peut-être la plus importante découverte depuis celle du feu. C'est un gaz qui développe des synapses entre ses molécules, comme les cellules du cerveau entre elles. On peut donc l'utiliser pour créer des copies du cerveau humain. Ce gaz se contrôle lui-même; il peut se condenser et devenir liquide, ou augmenter son volume jusqu'à ressembler à de la vapeur d'eau. Il a la capacité, inexpliquée, de convertir l'énergie : il absorbe et stocke la chaleur, par exemple, et la transforme en électricité ou en force motrice, et vice versa. Selon le même principe de conversion de l'énergie, il perçoit les ondes lumineuses et les ondes radio. Les cyborgs communiquent entre eux par ondes radio, leurs cerveaux sont reliés en permanence au vaste réseau de communication électronique sans fil de la planète.
Selon les cyborgs eux-mêmes, le yeksootch est une application de l'équation fondamentale de l'univers, celle qui unifie toutes les formes d'énergie, ainsi que la matière et la gravitation. Pour comprendre cette équation il faudrait une capacité intellectuelle bien supérieure à celle qu'aucun être humain ne pourra jamais avoir. De même qu'un être humain ne pourra jamais sauter dix mètres en hauteur ou courir à trois cent kilomètres à l'heure, un cerveau humain ne pourra jamais comprendre l'équation fondamentale de l'univers.
Seul le yeksootch peut fabriquer du yeksootch, et cela pose le problème de l'origine de ce gaz. Les cyborgs disent qu'un groupe de savants humains en a fabriqué par hasard il y a deux siècles. Depuis ce coup de chance fantastique, absolument unique dans l'histoire de l'univers, le yeksootch se reproduit de lui-même, en gardant l'image d'un cerveau humain comme modèle : celui de son créateur, disent les cyborgs.
Bien des savants, de par le vaste monde, ont essayé d'analyser le yeksootch. Mais ce gaz se dissout en ses éléments constitutifs, essentiellement de l'azote, lorsque l'intelligence qui le contrôle meurt ou que les synapses sont coupées.
La persuasion, la torture et la ruse sont sans effet sur les cyborgs prisonniers. Les cerveaux de yeksootch ont même la possibilité de mourir à volonté. Toute l'énergie qu'ils contiennent se disperse alors sous forme de chaleur et de lumière.
Presque tout ce que Vincent lisait sur les cyborgs, à la bibliothèque de la caserne et à celle du quartier, était écrit en dibadien scientifique, spécialisé, et il y avait toujours de nombreux mots qu'il ne comprenait pas. Il n'y avait jamais de dictionnaire dibadien-français disponible, car à Dibadi les cyborgs ont le monopole des contacts avec l'étranger. Vincent en était réduit à consulter des dictionnaires dibadiens et à deviner le mot français correspondant. Parfois, il ne le connaissait pas, ou alors il n'en était pas sûr. Si bien que, petit à petit, des mots comme bisikhsuch et taiamin entrèrent dans son vocabulaire sans qu'il puisse les traduire dans sa langue maternelle. | |
|   | | Invité
Invité
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Dim 15 Nov 2009 - 14:38 Dim 15 Nov 2009 - 14:38 | |
| comme d'habitude, c'est très bien écrit, agréable à lire et on a très envie de connaître la suite...
te lire me donne envie de poster des extraits de mon propre roman...je vais m'y mettre ! |
|   | | Anoev
Modérateur
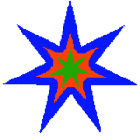
Messages : 37636
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Yeksootch Sujet: Yeksootch  Dim 15 Nov 2009 - 17:07 Dim 15 Nov 2009 - 17:07 | |
| Fallait l'trouver! Je tire un coup de chapeau à l'auteur de cette idée qui, si elle existait, résoudrait définitivement le problème de l'énergie!
Bravo Vilko! | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Mer 2 Déc 2009 - 22:10 Mer 2 Déc 2009 - 22:10 | |
| - Anoev a écrit:
- Fallait l'trouver! Je tire un coup de chapeau à l'auteur de cette idée qui, si elle existait, résoudrait définitivement le problème de l'énergie!
Mais qui en créerait d'autres, beaucoup plus graves  ---------------------------- Dibadi ressemble, extérieurement, à nos mégalopoles à nous. Mais les différences, bien que cachées, sont bien réelles, comme le montre l'épisode qui suit. ---------------------------- Parfois, Vincent avait du mal à supporter la grande ville et son agitation permanente. Même les parcs sont toujours pleins de monde à Dibadi. Une fois, il décida de consacrer l'un de ses jours de repos à essayer d'atteindre les limites de la ville. Le fait de travailler la nuit avait quand même un avantage : il avait beaucoup de temps libre, même en semaine. A Dibadi, la plupart des gens travaillent six jours par semaine et se reposent le dimanche. Le travail de nuit étant censé compter double, Vincent était de service trois nuits d'affilée, et ensuite il se reposait quatre jours. La deuxième nuit de travail était toujours la plus difficile. La station Sëbanes était le terminus de la ligne bleue. Vincent avait remarqué, en regardant un plan, qu'au-delà on pouvait encore aller assez loin en prenant le bus 113. Il partit donc un matin, avec une sacoche de toile contenant une bouteille d'eau et des sandwichs préparés par Diletyet. Dans une poche de sa veste il avait un carnet et des stylos, pour prendre des notes et faire des croquis. "Je rentrerai dans l'après-midi" dit-il à Dilyetyet en partant. Il lui fallut une heure et deux changements de ligne pour arriver jusqu'à la station Sëbanes. Une fois arrivé à l'extérieur, il ne remarqua rien de spécial. Des immeubles de quatre et cinq étages alternaient avec des maisons préfabriquées entourées de jardins minuscules. Au bas de certains immeubles, il y avait des boutiques : épiceries, salons de coiffure, cafés-restaurants. Le temps était gris et le paysage était aussi peu engageant que possible. Il y avait peu de monde dans les rues : on était un vendredi matin, les enfants étaient à l'école et les parents au travail. On ne voyait que les vagabonds habituels, encore jeunes mais déjà marqués par le manque de nourriture, les cuites et les nuits passées à dormir n'importe où. Vincent avait fait un plan sur une feuille de papier. L'arrêt du 113 était sur la grande avenue, Laispichëk, à l'angle de la rue Sëbanes. La sortie du métro était, vu le plan, du côté nord de la rue, juste à côté de l'arrêt de bus. Vincent avait toujours peur de prendre le bus dans le mauvais sens, et il faisait très attention à bien se repérer. Debout à côté du panneau portant le numéro 113 et le nom de la station (Sëbanes, comme le métro), Vincent se mit à attendre. Au début il était seul, et puis deux femmes noires corpulentes arrivèrent, et quatre jeunes gens plutôt maigrichons, aux cheveux longs et aux vêtements sales et usés. S'ils savaient que je suis un milicien, ces gars-là me feraient un mauvais sort, se dit Vincent intérieurement. Il ne se sentait pas vraiment à l'aise. L'ordre public n'est jamais très bien assuré à Dibadi, il y a trop de misère, trop de désespoir aussi. Au bout d'une bonne vingtaine de minutes le 113 arriva. Vincent paya son ticket, mais les deux femmes et les quatre hommes s'engouffrèrent dans le véhicule sans payer et sans regarder le chauffeur, qui ne réagit pas. Il y avait peu de monde dans le bus. Vincent s'assit prudemment pas trop loin du chauffeur. Personne n'avait l'air de faire attention à lui. Il se dit qu'avec son visage mal rasé et ses yeux fatigués il faisait couleur locale. Les deux femmes noires s'étaient assises juste derrière lui. Elles conversaient avec animation, et Vincent remarqua que le "ph" dibadien, qui normalement se prononce "pf" devant une voyelle et "f" devant une consonne ou en fin de mot, devenait "p" dans leur bouche, dans toutes les positions. Curieux accent. Beaucoup d'enfants, et certains adultes, prononcent le "ph" comme un "f", mais rarement comme un "p". Vincent se demanda s'il s'agissait d'un accent étranger ou si, dans cette partie de la ville, les gens avaient créé leur propre accent. Mais les autres passagers étaient trop loin de lui pour qu'il puisse entendre leurs conversations. Les arrêts de bus défilaient, avec leurs noms si dibadiens qu'ils en paraissaient familiers : Tenaskha, Tlatsodi, Musdatu... et puis le terminus, Ilipgokha. Vincent descendit, et les quatre jeunes gens aussi. Derrière lui, il y avait un mur d'environ trois mètres de haut, et un portail avec l'inscription Ilipgokha Chakhachkha (hôpital psychiatrique d'Ilipgokha). A sa droite, vers l'ouest, la route s'enfonçait entre des terrains vagues parsemés de tertres recouverts de mauvaises herbes et de détritus. En face de lui, un lotissement de grands pavillons de deux ou trois étages. Des logements pour les employés de l'hôpital ? Vincent se mit à marcher vers les terrains vagues. Ce devait être ça, la limite de la ville. Les quatre jeunes gens le rattrapèrent et l'un d'eux l'aborda : "Où tu vas comme ça, mec ? Y'a rien par là." "Je m'promène" répondit Vincent, sur un ton aussi pacifique que possible. La situation ne lui plaisait pas du tout. "Y'a personne qui s'promène par là, mec. Tu cherches quèque chose ? T'as planqué quèque chose par là ?" "Je cherche la campagne" répondit Vincent. Son interlocuteur ne se laissa pas désarmer : "On crèche par là, mec" dit-il avec un geste du bras. "Si t'as d'la bouffe ou d'la bibine, on est preneurs !" "Non, j'ai que de l'eau." "Ça fait rien, tu viens quand tu veux !" L'un des vagabonds avait sorti une bouteille d'otlakhya d'une sacoche. Vincent continua son chemin avec un sourire, pendant que les vagabonds s'éloignaient en direction d'un petit groupe de carcasses de voitures au milieu des herbes folles. Au bout de cinq minutes de marche Vincent arriva à un endroit où la route s'incurvait vers le nord. A la place des terrains vagues, des champs cultivés s'étendaient sur des kilomètres. Au loin, de grandes machines agricoles se déplaçaient lentement. La coeur de Vincent se mit à battre plus fort : c'était la campagne, à portée de main ! De l'autre côté de la route, au début de la courbe, il y avait un grand hangar. De temps en temps, des camions en entraient et sortaient. Vincent continua à marcher le long de la route, mais au bout d'une dizaine de minutes il s'aperçut qu'elle le ramenait vers la ville, sans aucun doute possible. Il fit demi-tour et, en arrivant près du hangar, il remarqua que les camions qui y entraient en ressortaient par l'autre extrémité. Il resta quelques minutes à les regarder s'éloigner vers l'horizon. Parfois, un camion apparaissait dans le lointain, traversait le hangar et se dirigeait vers la ville. La campagne commençait de l'autre côté du hangar. Vincent traversa la route et s'approcha du bâtiment. Les deux portails, à chaque extrémité, s'ouvraient et se fermaient automatiquement, pour permettre le passage des véhicules. Lorsque l'un des portails s'ouvrait, l'autre se fermait, et inversement. Une inscription était peinte en grandes lettres noires sur le devant du hangar : WIK TLATA DISAI _ MIMLUSTU Ce qui signifie : entrée interdite, danger de mort. Profitant du passage d'un camion, Vincent se faufila à l'intérieur du hangar, le coeur battant. Derrière lui, le portail se refermait. Mais l'autre portail ne s'ouvrait pas. Vincent marcha jusqu'au milieu du bâtiment, dans la demi-obscurité, et attendit, le dos au mur, que l'un des portails s'ouvre. Au bout de quelques minutes qui lui parurent interminables, le portail ouest, celui qui donnait sur la campagne, s'ouvrit lentement. Mais pas pour laisser le passage à un camion : deux imposantes machines agricoles occupaient tout l'espace. Leurs bras mécaniques armés de faux et de pinces battaient l'air de façon menaçante. Le portail ouest se referma derrière elles. Vincent recula jusqu'au portail par lequel il était entré, en priant pour qu'il s'ouvre. Ce sont des robots, se dit Vincent. Aucune des machines n'avait de cabine de pilotage visible. Les bras mécaniques fauchaient le vide devant et de chaque côté, effleurant les murs de parpaings. Le portail s'entrouvrit derrière Vincent, qui s'enfuit et traversa la route en courant, jusqu'à l'hôpital psychiatrique trois cent mètres plus loing. Suant et tremblant de peur rétrospective, adossé au mur, il se laissa glisser à terre et se versa de l'eau dans un gobelet. Il avait découvert la clôture, le mur invisible qui fait de Dibadi une prison, une réserve où les humains s'entassent et meurent, un Sëkukyakha géant de neuf millions d'habitants et quarante kilomètres de diamètre. Il n'y avait pas de mur pour entourer la ville, pas de barbelés ni de miradors. Rien que des champs de blé et de luzerne, et les machines qui les cultivaient. Même s'il n'était pas possible de sortir de Dibadi en voiture ou à pied, il y avait le train, et l'aéroport. Mais pour acheter un billet de train ou d'avion, il fallait y mettre le prix, et surtout avoir un passeport, et à Dibadi seul les cyborgs en ont. L'émotion passée, Vincent s'aperçut qu'il avait faim. Il traversa une nouvelle fois la route, en faisant attention aux camions qui débouchaient du hangar, jusqu'à l'autre arrêt du 113, devant les pavillons. Il mangea ses sandwichs en attendant le bus. Deux femmes attendaient avec lui. Des pensionnaires de l'hôpital en permission de sortie, à en juger par leur regard halluciné. Lorsque Vincent rentra chez lui, il trouva Diletyet en train de regarder la télévision. "Alors, tu as vu la campagne ?" lui demanda-t-elle. "Oui" répondit-il "Mais je crois que je n'y retournerai pas."
Dernière édition par Vilko le Ven 26 Fév 2010 - 18:31, édité 2 fois | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Ven 26 Fév 2010 - 13:06 Ven 26 Fév 2010 - 13:06 | |
| Dibadi est une ville immense sans culture distincte et sans passé historique. Mais la culture et l'histoire sont comme le langage et la religion, consubstantiels à l'être humain. S'il le faut, il se créera un langage, une religion, une culture et une histoire à partir de rien, ou de presque rien.
Noël arriva pour Vincent et Diletyet. Ou plutôt, l'équivalent dibadien de Noël. Le vingt-cinq décembre est férié à Dibadi, mais pas pour célébrer une fête religieuse : c'est la célébration de la reddition des habitants de Dibadi, à l'époque petite ville francophone, aux troupes du général cyborg Pupong.
Les immigrants célébraient Noël, et sachant qu'il ne serait pas possible de les en empêcher, les cyborgs ont créé, à partir de faits historiques douteux, les deux principales fêtes de l'année, Noël et la Fête du Printemps.
Noël, connu sous le nom de Pupongsan, le jour de Pupong, célèbre la reddition des habitants de la petite ville francophone de Dibadi ("Dibady" en français) aux troupes du général cyborg Pupong.
Selon la légende, quatre vieillards chenus et vêtus de noir, aux longues barbes blanches, sont sortis de la ville assiégée le jour de Noël pour remettre au général Pupong le drapeau dibadien. Il faisait un froid glacial et le sol était couvert de neige. Le plus âgé des vieillards aurait alors prononcé les paroles célèbres : "Tu as gagné, Pupong ! Ton roi sera mon roi, tes dieux seront mes dieux, ta langue sera ma langue ! Prends ce drapeau, général, il représente Dibady, notre ville qui est à toi désormais !"
Toujours selon la légende, le général, un homme de haute stature, impressionnant dans son uniforme blanc et son casque camouflé de feuillage, a alors accordé la vie sauve aux habitants. Menottés et les pieds entravés, ils ont été emmenés dans des camps pour travailler sur les grands chantiers de la reconstruction. Les tranchées dans lesquelles ont été installées les premières lignes de métro, notamment, ont été creusées par des prisonniers de guerre, remplacés ensuite par des immigrants comme Vincent.
Noël est célébré par des échanges de cadeaux et des festins, en famille et entre amis, pour célébrer la fin des privations et des souffrances de la guerre. Dans les écoles, les enfants, déguisés, rejouent l'événement historique pour leurs parents.
Vincent avait lu et étudié tous les textes concernant Pupong qu'il avait pu trouver dans les bibliothèques de la ville. Divers éléments avaient semé le doute dans son esprit : le général avait vraiment existé, mais apparemment ses troupes, essentiellement constituées de robots, avaient exterminé les habitants et recouverts de terre et de débris les monceaux de cadavres.
Réalisant après coup l'ampleur de leur faute, ou plutôt le risque qu'ils couraient que les peuples du monde, horrifiés et scandalisés, s'allient contre eux, les cyborgs avaient inventé l'histoire des quatre vieillards et fait venir à Dibadi des civils capturés à d'autres endroits, en les faisant passer pour des Dibadiens survivants. Après la fin de la guerre, ils ont encouragé l'immigration à Dibadi pour retrouver une place dans la communauté humaine. C'est grâce aux neuf millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui habitent à Dibadi que les cyborgs peuvent prétendre faire partie d'une nation comme les autres.
Vincent garda pour lui-même ses hypothèses. En tant que milicien, il avait participé à suffisamment d'arrestations pour savoir que les cyborgs peuvent faire disparaître qui ils veulent, sans avoir de justification à fournir.
La Fête du Printemps est plus spectaculaire que Noël. Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues pour commémorer la refondation de la ville, trois mois après la reddition. Plusieurs milliers d'habitants avaient été libérés après s'être convertis au konachoustaï, la religion des cyborgs. Un gigantesque carnaval converge vers la Place de l'Eléphant, où des prêtres bénissent la foule en répandant sur elle l'encens purificateur.
Les prêtres, en soutane brune et bonnet carré violet, agitent les encensoirs, des sortes de théières placées au bout de chaînes de métal. Des plantes sèches et des écorces mêlées à de l'huile brûlent lentement dans les théières. Lorsque les prêtres font bouger les théières au bout des chaînes, au rythme obsédant des chants sacrés, une fumée odorante se répand. Les fidèles s'agenouillent à même le sol, certains psalmodient des prières. Lorsque la cérémonie se prolonge il n'est pas rare que les personnes impressionnables aient l'impression que les dieux sont descendus parmi eux. Certains visages sont transfigurés par l'extase, d'autres ont les yeux baignés de larmes.
L'encens est omniprésent dans les cérémonies konachoustaï. Selon certains plaisantins il servirait à dissimuler les odeurs corporelles des fidèles mal lavés. Pour les croyants, l'odeur de l'encens fait fuir les démons et purifie les âmes.
Chaque prêtre konachoustaï a ses recettes favorites d'encens, parfois proches de la magie. Divers opiacés et plantes toxiques feraient ainsi, parfois, partie des ingrédients.
Les deux autres fêtes officielles, la Fête de l'Eté, célébrée le vingt-et-un juin, et la Fête de l'Automne, fin septembre, sont moins liées à l'histoire et à la religion. Ce sont surtout des occasions de boire, de danser et de festoyer. La police et la milice ont souvent à intervenir, les festivités dégénérant souvent en bagarres et agressions de toutes sortes.
Vincent prit l'habitude d'assister aux cérémonies dans le temple le plus proche de la caserne. Au début, il était venu par curiosité, et ensuite il avait pris goût aux rituels de la religion des cyborgs.
Le panthéisme lui convenait intellectuellement : le mot "konachoustaï" (konaszustai) est la contraction de la phrase "Konawe isztada shub Sakhali eTayi" – Toute chose est le Seigneur Dieu – que l'on retrouve écrite à l'intérieur des temples, le plus souvent dans une calligraphie élaborée. Les prêtres expliquent à longueur de sermon que le Seigneur Dieu est une allégorie, l'univers ne pense pas, il n'y a pas de synapses entre les étoiles, mais par la méditation et l'extase religieuse l'homme peut se représenter l'univers dans sa grandeur infinie et se rendre compte qu'il ne fait qu'un avec lui, et que par conséquent la mort individuelle n'est pas à craindre.
Dans le temple fréquenté par Vincent, les images, statues et ornements puisent leurs sujets à diverses sources. On reconnaît Talapas – l'Esprit Créateur, vénéré par les Chinooks; Ilahi – la Terre-Mère. Otlakh – le dieu-soleil; Ilichi – la déesse de la lune; Ichani – la bienveillante déesse des eaux, qui a appris aux hommes à fabriquer des canots, des pagaies et des filets. Matsu – le dieu du tonnerre, maître des éléments et du climat. Taia – le dieu de la mort, symbolisé par un homme couvert de sang, tenant sa tête coupée dans les mains.
Des scènes de chasse, avec des cerfs et des chiens de meute, sont peintes sur les murs. Il s'agit d'une allusion aux éternels terrains de chasse auxquels croyaient les Chinooks et les autres Amérindiens du Nord-Ouest, qui sont les principaux ancêtres linguistiques des Dibadiens.
Un chevalier en armure combattant un serpent, c'est Sakhali Choch, dont le nom vient du "Saint Georges" des Chrétiens. Il symbolise l'effort que l'on doit faire sur soi-même pour dominer les mauvais démons que tout être humain porte en soi.
Les démons et fantômes, si présents dans l'imaginaire dibadien, ne sont pas représentés, de peur de les attirer magiquement à l'intérieur du temple.
Beaucoup d'émotions, parfois violentes, se libèrent pendant les cérémonies konachoustaï. Vincent, souvent mal à l'aise dans son travail de milicien au service d'un Etat cyborg dont il devinait la vraie nature, se surprenait à invoquer Sakhali Choch, le dieu de l'effort intérieur, et Ichani la bienveillante.
Contrairement à Vincent, Diletyet s'ennuyait dans le temple et se méfiait des prêtres, hypocrites et manipulateurs. Pour elle, le konachoustaï faisait partie des bizarreries de la vie à Dibadi, et le dimanche matin elle préférait rester au lit ou faire son ménage. | |
|   | | Anoev
Modérateur
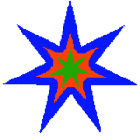
Messages : 37636
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Ven 26 Fév 2010 - 17:41 Ven 26 Fév 2010 - 17:41 | |
| - Vilko a écrit:
- Une inscription était peinte en grandes lettres noires sur le devant du hangar :
ENTREE INTERDITE _ DANGER DE MORT*
Profitant du passage d'un camion, Vincent se faufila à l'intérieur du hangar, le cœur battant. Tiens-tiens! Étrange que cette inscription ne fût pas en dibadien. Sinon la description est très bien rendu et donnerait également un peu l'idée de ce que donneraient certaines cités deshéritées du Pelliant ou du Surroenyls (avec toutefois un sentiment d'insécurité moins fort dans cette dernière). * En aneuvien on dit PROBIDAN INGÆNT. PERIG DÆNTEN**. Comment dit-on en dibadien?** Tout de l'à-postériori! Des fois, on s'croirait à... non! j'déconne! | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Ven 26 Fév 2010 - 18:49 Ven 26 Fév 2010 - 18:49 | |
| - Anoev a écrit:
- Tiens-tiens! Étrange que cette inscription ne fût pas en dibadien.
Elle l'est ! Pour une fois que j'avais décidé de ne pas surcharger le texte de phrases en dibadien... - Anoev a écrit:
- En aneuvien on dit PROBIDAN INGÆNT. PERIG DÆNTEN**. Comment dit-on en dibadien?
Wik tlata disai = ne pas (wik) aller (tlata) dedans (disai) Mimlustu = lieu (tu) de mort (mimlus) | |
|   | | Anoev
Modérateur
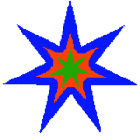
Messages : 37636
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Ven 26 Fév 2010 - 20:35 Ven 26 Fév 2010 - 20:35 | |
| Un peu comme ça, quoi...  Un gros plan sur l'inscription:  J'ai p'têt' oublié un ou deux points d'exclam': je ne connais pas la ponctuation dibadienne. En fait, pas tout-à-fait. Sur mon image, on dirait plutôt une plaque emaillée: - Citation :
- ... était peinte sur le devant du hangar.
En tout cas, la porte est assez large pour y laisser entrer un camion (du moins, j'pense). | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Ven 26 Fév 2010 - 22:41 Ven 26 Fév 2010 - 22:41 | |
| Je suis impressionné ! Merci Anoev ! - Anoev a écrit:
- Un peu comme ça, quoi...
Mais avec un portail beaucoup plus grand ! Le hangar est avant tout un passage. - Anoev a écrit:
- Un gros plan sur l'inscription:

Mimlu stu !!! L'inscription est en alphabet Deseret (mormon), j'ai réalisé un équivalent de l'inscription sur Paint avec la police "Huneybee"...  Normalement il faudrait un tiret bas à la place du point mais il n'y a pas de tiret avec Huneybee... Pas terrible, je vais essayer de faire mieux un autre jour... Déjà que j'ai eu un mal fou à uploader l'image sur mon site ce soir... C'est bien, Filezilla, et surtout c'est gratuit, mais je n'y comprends pas grand chose quand mon fils l'informaticien n'est pas là... - Anoev a écrit:
- J'ai p'têt' oublié un ou deux points d'exclam': je ne connais pas la ponctuation dibadienne.
Des tirets bas, rien d'autre, l'intonation n'a pas de valeur sémantique en dibadien. | |
|   | | Anoev
Modérateur
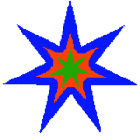
Messages : 37636
Date d'inscription : 16/10/2008
Localisation : Île-de-France
 |  Sujet: Oups!!! Sujet: Oups!!!  Ven 26 Fév 2010 - 23:11 Ven 26 Fév 2010 - 23:11 | |
| - Vilko a écrit:
- Mimlustu !!!
Oh M... !! Bon, pour la police, j'pouvais pas savoir, mais pour les deux lettres interverties, là MC*! J'aurais dû faire attention! En plus, comme un c... j'ai grossi l'panneau parce que "ça" s'voyait pas assez      J'devrais faire comme le menuisier! j'devrais faire gaffe c'que j'fais d'mes copeaux avant d'envoyer mes créations... J'f'rai mieux la prochain'fois! Promis! * MC = Mea culpa.Allez, même si c'est pas la bonne police, on y va qdM: juste pour le feûne: | |
|   | | Vilko

Messages : 3567
Date d'inscription : 10/07/2008
Localisation : Neuf-trois
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 27 Fév 2010 - 11:18 Sam 27 Fév 2010 - 11:18 | |
| J'ai téléchargé l'image du hangar et celle de l'inscription. Il faut absolument que j'apprenne à faire ce genre de choses pour mon site... | |
|   | | Nemszev
Admin

Messages : 5559
Date d'inscription : 06/03/2008
Localisation : Bruxelles, Belgique
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  Sam 27 Fév 2010 - 12:41 Sam 27 Fév 2010 - 12:41 | |
| - Vilko a écrit:
- L'inscription est en alphabet Deseret (mormon), j'ai réalisé un équivalent de l'inscription sur Paint avec la police "Huneybee"...

Certaines lettres ressemblent à celles de mon alphabet ba gai dun (exemple en signature)...
_________________
Le grand maître admin-fondateur est de retour. - Bedal
Original, bien justifié, et différent du sambahsa et de l'uropi. - Velonzio Noeudefée
Nemszev m'a fait une remarque l'autre jour, et j'y ai beaucoup réfléchi depuis. - Djino
J'ai beaucoup de tendresse pour ta flexion verbale. - Doj-Pater
Pourquoi t'essaies de réinventer le sambahsa ? - Olivier Simon
Oupses ! - Anoev
| |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien Sujet: Re: Comment Vincent apprit le dibadien  | |
| |
|   | | | | Comment Vincent apprit le dibadien |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
